




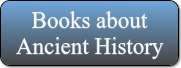
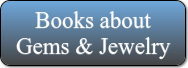
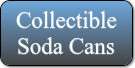







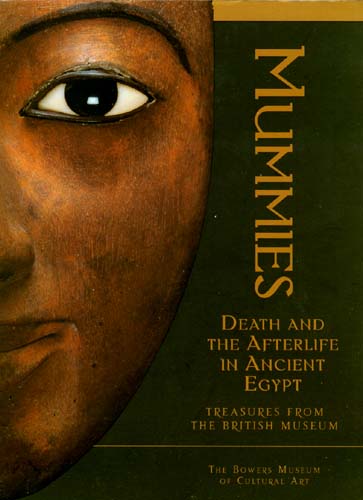
"Momies : la mort et l'au-delà dans l'Égypte ancienne (trésors du British Museum)" par John H. Taylor, Nigel C. Strudwick et le Bowers Museum of Cultural Art.
NOTE: Nous avons 75 000 livres dans notre bibliothèque, soit près de 10 000 titres différents. Il y a de fortes chances que nous ayons d'autres exemplaires de ce même titre dans des conditions variables, certaines moins chères, d'autres en meilleur état. Nous pouvons également avoir différentes éditions (certaines en livre de poche, d'autres à couverture rigide, souvent des éditions internationales). Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, veuillez nous contacter et demander. Nous sommes heureux de vous envoyer un résumé des différentes conditions et prix que nous pouvons avoir pour le même titre.
DESCRIPTION: Couverture souple. Éditeur: Musée Bowers (2005). Pages: 244. Taille: 12x9x1 pouces; 3¼ livres. Résumé: Parmi les peuples du monde antique, les Égyptiens occupaient une position unique en raison de leur approche de la mort et de la possibilité d’une résurrection. « Momies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt – Treasures from the British Museum » présente la collection la plus grande et la plus complète de matériel funéraire égyptien ancien du British Museum de renommée mondiale. Cette exposition complète présente 140 objets, dont 14 momies et/ou cercueils, et constitue la plus grande exposition de ce type présentée par le British Museum en dehors de la Grande-Bretagne.
 CONDITION: NOUVEAU. ÉNORME nouvelle couverture souple. Musée Bowers (2005) 244 pages. Sans défaut, à l'exception de légères traces de bords et d'étagères d'angle sur les couvertures. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. L'usure des étagères se présente principalement sous la forme de légers « froissements » sur le talon du dos de la couverture, ainsi que sur les « pointes » de la couverture (les quatre coins ouverts des couvertures, haut et bas, avant et arrière). L'état est tout à fait cohérent avec un nouveau stock provenant d'un environnement de librairie dans lequel les nouveaux livres peuvent montrer de légers signes d'usure en rayon, conséquence d'une manipulation de routine et du simple fait d'être mis sur les étagères et remis en rayon. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE TRÈS REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Descriptions soignées et précises ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #9038h.
CONDITION: NOUVEAU. ÉNORME nouvelle couverture souple. Musée Bowers (2005) 244 pages. Sans défaut, à l'exception de légères traces de bords et d'étagères d'angle sur les couvertures. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. L'usure des étagères se présente principalement sous la forme de légers « froissements » sur le talon du dos de la couverture, ainsi que sur les « pointes » de la couverture (les quatre coins ouverts des couvertures, haut et bas, avant et arrière). L'état est tout à fait cohérent avec un nouveau stock provenant d'un environnement de librairie dans lequel les nouveaux livres peuvent montrer de légers signes d'usure en rayon, conséquence d'une manipulation de routine et du simple fait d'être mis sur les étagères et remis en rayon. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE TRÈS REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Descriptions soignées et précises ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #9038h.
VEUILLEZ VOIR LES DESCRIPTIONS ET LES IMAGES CI-DESSOUS POUR DES EXAMENS DÉTAILLÉS ET POUR LES PAGES DE PHOTOS DE L’INTÉRIEUR DU LIVRE.
VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS DES ÉDITEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES LECTEURS CI-DESSOUS.
AVIS DES ÉDITEURS:
AVIS: Catalogue de l'exposition organisée par le British Museum, Londres. Comprend des références bibliographiques.
AVIS: Le Bowers Museum of Cultural Art de Santa Ana, en Californie, a exposé une série sur l'art et la culture égyptiens anciens. Ce volume, publié en 2005, est une couverture rigide surdimensionnée remplie de photos, de descriptions et d'un historique des œuvres exposées.
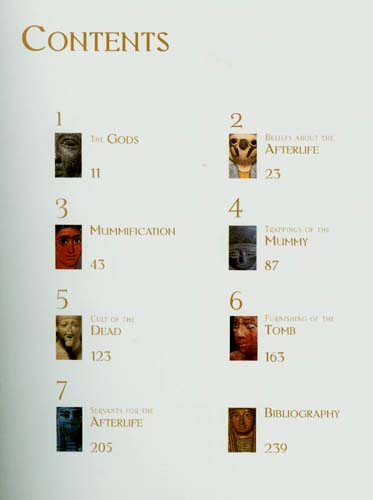 AVIS: Ceci est le catalogue de l'exposition La mort et l'au-delà dans l'Égypte ancienne, une vitrine des Trésors du British Museum.
AVIS: Ceci est le catalogue de l'exposition La mort et l'au-delà dans l'Égypte ancienne, une vitrine des Trésors du British Museum.
AVIS: Le Bowers Museum of Cultural Art de Santa Ana, en Californie, a exposé une série sur l'art et la culture égyptiens anciens. Ce volume, publié en 2005, est un catalogue à couverture souple surdimensionné rempli de photos, de descriptions et de l'historique des œuvres exposées.
AVIS: Catalogue d'exposition pour La mort et l'au-delà dans l'Egypte ancienne : Momies du British Museum.
AVIS: John H. Taylor est conservateur au British Museum spécialisé dans l'archéologie funéraire de l'Égypte ancienne. John Taylor est responsable de la conservation des antiquités funéraires, des amulettes et des bijoux égyptiens anciens. Il assure également la supervision de la conservation du programme de prêts départemental. Son expertise porte sur les objets funéraires de la période pharaonique (notamment les cercueils), les momies et la momification, la statuaire métallique du premier millennium avant JC, la Troisième Période Intermédiaire (vers 1069-664 avant JC) et l'histoire de l'égyptologie. Il est l'auteur de "Egyptian Coffins", "Unwrapping a Mummy" et "Egypt and Nubia".
AVIS: Nigel Strudwick est un expert de premier plan en archéologie des tombeaux thébains, ayant travaillé dans les tombeaux privés de Thèbes depuis 1984 et a publié de nombreux articles sur le sujet et la région. Il a travaillé comme conservateur au British Museum et comme professeur invité à l'Université de Memphis.
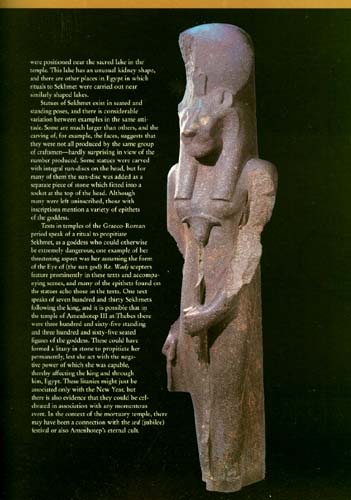 TABLE DES MATIÈRES:
TABLE DES MATIÈRES:
Les dieux.
Croyances sur l'au-delà.
Momification.
Les attributs de la momie.
Culte des morts.
Mobilier du tombeau.
Serviteurs de l'au-delà.
Bibliographie.
AVIS PROFESSIONNELS:
AVIS: Momies du British Museum du Bowers Museum. "Mummies: Death and the Afterlife in Ancient Egypt" présente la plus grande collection de momies et de cercueils jamais sortie du British Museum et illustre l'histoire fascinante de la façon dont les Égyptiens préparaient et envoyaient les morts dans l'au-delà. Parmi les peuples du monde antique, les Égyptiens occupent une position unique avec leur approche de la mort et de la possibilité de résurrection, d'autant plus qu'une grande partie des preuves qui ont survécu au fil des milliers d'années proviennent d'un contexte funéraire.
La collection la plus grande et la plus complète de matériel funéraire égyptien ancien en dehors du Caire se trouve au British Museum. Dans le cadre de sa coentreprise avec le British Museum, le Bowers Museum s'est appuyé sur cette collection mondialement connue de momies et d'objets funéraires pour présenter « Momies : La mort et l'au-delà dans l'Egypte ancienne… Trésors du British Museum ». La vaste exposition présente 140 objets, dont 14 momies et/ou cercueils, et constitue la plus grande exposition de ce type présentée par le British Museum en dehors de la Grande-Bretagne.
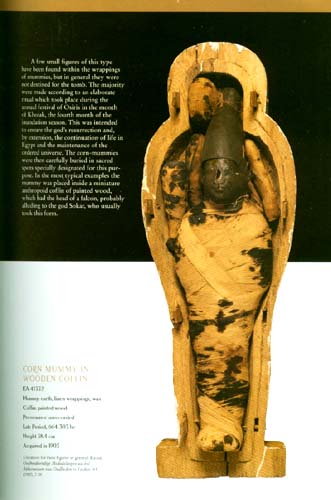 « Momies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt » se concentre sur l'embaumement, les cercueils, les sarcophages, les figures shabti, la magie et les rituels, les amulettes, les papyrus, ainsi que le processus de momification. L'exposition illustre en profondeur l'histoire du fascinant rituel égyptien consistant à préparer et à envoyer les morts dans l'au-delà, avec des meubles créés spécifiquement pour le cercueil d'un individu, tels que des bijoux en or spectaculaires et un bateau en bois pour transporter les morts dans le monde souterrain. Selon l'un des commissaires de l'exposition, le conservateur adjoint des antiquités du British Museum, le Dr John Taylor, les momies et les cercueils égyptiens de cette exposition sont de la plus haute qualité et les momies du British Museum n'ont pas été exposées depuis de nombreuses années.
« Momies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt » se concentre sur l'embaumement, les cercueils, les sarcophages, les figures shabti, la magie et les rituels, les amulettes, les papyrus, ainsi que le processus de momification. L'exposition illustre en profondeur l'histoire du fascinant rituel égyptien consistant à préparer et à envoyer les morts dans l'au-delà, avec des meubles créés spécifiquement pour le cercueil d'un individu, tels que des bijoux en or spectaculaires et un bateau en bois pour transporter les morts dans le monde souterrain. Selon l'un des commissaires de l'exposition, le conservateur adjoint des antiquités du British Museum, le Dr John Taylor, les momies et les cercueils égyptiens de cette exposition sont de la plus haute qualité et les momies du British Museum n'ont pas été exposées depuis de nombreuses années.
"Cette exposition offrira un aperçu ultime du monde de la momification", a déclaré le Dr Taylor. "Nous parlons de la mort comme d'un des grands rites de passage de l'existence humaine. Que nous croyions que la vie continue au-delà de la mort, ou qu'elle se termine à ce moment-là, ou que nous admettions que nous ne le savons pas, la mort est une porte par laquelle nous devons tous passer. »
« Momies : la mort et l'au-delà dans l'Égypte ancienne » est divisé en sept sections :
-Les Dieux présentent des statues grandeur nature et des bustes en pierre des dieux de l'au-delà, dont Sekhmet et Osiris.
-Les croyances sur l'au-delà se concentrent sur les textes sur papyrus et autres inscriptions concernant l'au-delà.
-La momification est le cœur de l'exposition avec des momies, des cercueils et des canopes pour les organes internes. Les momies constituent l’un des aspects les plus caractéristiques de la culture égyptienne antique. La préservation du corps était un élément essentiel de la croyance et de la pratique funéraire égyptienne. La momification présente deux des pièces les plus spectaculaires de l'exposition : une momie d'enfant de la période gréco-romaine avec un portrait réaliste et un masque de momie en cartonnage doré datant de la période gréco-romaine (fin du 1er siècle avant JC-début du 1er siècle après JC).
-Les accessoires des momies comprennent des vêtements, des bijoux, des amulettes de toutes sortes et un sceptre en papyrus - des objets nécessaires pour préparer les morts à l'au-delà. Les amulettes sont principalement en or avec du genévrier rouge et une glaçure bleue connue sous le nom de Faïence.
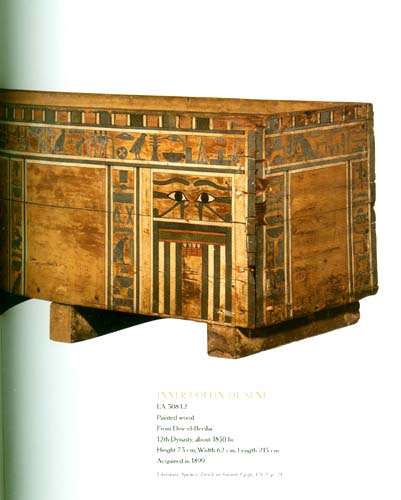 -Le Culte des Morts propose des tables et des statues, dont une tablette d'albâtre inscrite pour les huiles sacrées.
-Le Culte des Morts propose des tables et des statues, dont une tablette d'albâtre inscrite pour les huiles sacrées.
- L'ameublement du tombeau comprend tous les objets qui seraient placés dans un tombeau égyptien pour accompagner les morts dans l'au-delà, notamment des bijoux en or spectaculaires, un bateau en bois pour transporter les morts aux enfers, des bols, des bocaux, un vase en verre et un appui-tête.
-Shabtis : Serviteurs de l'au-delà. Les figures Shabti ont été développées à partir des figures de serviteurs courantes dans les tombes de l'Empire du Milieu. Ils sont représentés momifiés comme le défunt, avec leur propre cercueil, et portent un sortilège leur permettant de fournir de la nourriture à leur maître ou maîtresse dans l'au-delà.
"Cette exposition est particulièrement intéressante car elle n'a jamais été présentée auparavant", a déclaré le Dr Taylor. Tous les objets de l'exposition seront publiés dans le catalogue de 256 pages richement illustré du Bowers Museum qui accompagnera l'exposition. [Institut polytechnique de Virginie et Université d'État].
AVIS: Parmi les peuples du monde antique, les Égyptiens occupent une position unique avec leur approche de la mort et de la possibilité de résurrection, d'autant plus qu'une grande partie des preuves qui ont survécu au fil des milliers d'années proviennent d'un contexte funéraire. La collection la plus grande et la plus complète de matériel funéraire égyptien ancien en dehors du Caire se trouve au British Museum. Dans le cadre de sa joint-venture avec le British Museum, le Bowers Museum s'est appuyé sur cette collection mondialement connue de momies et d'objets funéraires pour présenter « Momies : Mort et au-delà dans l'Egypte ancienne… Trésors du British Museum ».
La vaste exposition et le catalogue qui l'accompagne présentent 140 objets, dont 14 momies et/ou cercueils, et constitue la plus grande exposition de ce type présentée par le British Museum en dehors de la Grande-Bretagne. « Momies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt » se concentre sur l'embaumement, les cercueils, les sarcophages, les figures shabti, la magie et les rituels, les amulettes, les papyrus, ainsi que le processus de momification. L'exposition illustre en profondeur l'histoire du fascinant rituel égyptien consistant à préparer et à envoyer les morts dans l'au-delà, avec des meubles créés spécifiquement pour le cercueil d'un individu, tels que des bijoux en or spectaculaires et un bateau en bois pour transporter les morts dans le monde souterrain.
 Selon l'un des commissaires de l'exposition, le conservateur adjoint des antiquités du British Museum, le Dr John Taylor, les momies et les cercueils égyptiens de cette exposition sont de la plus haute qualité et n'ont pas été exposés depuis de nombreuses années. "Cette exposition offrira un aperçu ultime du monde de la momification", a déclaré le Dr Taylor. « Nous parlons de la mort comme d’un des grands rites de passage de l’existence humaine. Que nous croyions que la vie continue au-delà de la mort, ou qu'elle se termine à ce moment-là, ou que nous admettions que nous ne le savons pas, la mort est une porte par laquelle nous devons tous passer. [Art Quotidien].
Selon l'un des commissaires de l'exposition, le conservateur adjoint des antiquités du British Museum, le Dr John Taylor, les momies et les cercueils égyptiens de cette exposition sont de la plus haute qualité et n'ont pas été exposés depuis de nombreuses années. "Cette exposition offrira un aperçu ultime du monde de la momification", a déclaré le Dr Taylor. « Nous parlons de la mort comme d’un des grands rites de passage de l’existence humaine. Que nous croyions que la vie continue au-delà de la mort, ou qu'elle se termine à ce moment-là, ou que nous admettions que nous ne le savons pas, la mort est une porte par laquelle nous devons tous passer. [Art Quotidien].
AVIS: Peut-être que rien n'illustre mieux le dicton « Tout ce qui est vieux est à nouveau nouveau » que la mystique des momies de l'Égypte ancienne. Génération après génération s'est évanouie à la vue des trésors des pharaons, qui restent inégalés trois millénaires plus tard. Le culte égyptien des morts a trouvé l’immortalité dans l’imaginaire des Occidentaux qui ont transmué ses symboles en opéra, films, meubles, bijoux, théières, serviettes et bien plus encore. Et maintenant, une nouvelle vague de momies est sur le point de se déchaîner dans le sud de la Californie avec une exposition phénoménale : « Momies : La mort et l'au-delà dans l'Egypte ancienne... Trésors du British Museum", qui a ouvert ses portes dimanche au Bowers Museum of Cultural Art de Santa Ana. [Los Angeles Times].
AVIS: En mai 2003, le British Museum a signé un accord de collaboration historique de cinq ans avec le Bowers Museum de Santa Ana, en Californie, pour présenter ses incroyables collections et fournir un service aux visiteurs et en particulier aux étudiants qui ne peuvent pas se déplacer. Grande-Bretagne. En avril 2005, le Bowers Museum présentait ainsi « Mummies : Death and the Afterlife in Ancient Egypt » présentant une collection spectaculaire de 140 objets du British Museum.
Le British Museum de Londres, en Angleterre, possède la collection la plus grande et la plus complète de documents égyptiens anciens en dehors du Caire. Sa spectaculaire collection compte plus de 100 000 objets. Les expositions comprennent une galerie de sculptures monumentales et la collection de momies et de cercueils de renommée internationale. Les objets égyptiens font partie des collections du British Museum depuis ses débuts. À l'origine, le musée devait abriter les objets laissés à la nation par Sir Hans Sloane à sa mort en 1753, dont environ 150 provenaient de
L'intérêt européen pour l'Égypte a commencé à croître sérieusement après l'invasion de Napoléon Bonaparte en 1798, d'autant plus que Napoléon avait inclus dans son expédition des érudits qui ont beaucoup écrit sur ce pays ancien et mystérieux. Après la défaite des Français en 1801, de nombreuses antiquités que les Français avaient rassemblées furent confisquées par l'armée britannique et présentées au British Museum au nom du roi George III en 1803. La plus célèbre d’entre elles était la pierre de Rosette. Après Napoléon, l’Égypte passe sous le contrôle de Mohammed Ali, déterminé à ouvrir le pays aux étrangers. En conséquence, les fonctionnaires européens résidant en Égypte ont commencé à collectionner des antiquités. Le consul de Grande-Bretagne était Henry Salt, qui rassembla deux collections qui formèrent finalement un noyau important de la collection du British Museum et furent complétées par l'achat d'un certain nombre de papyrus.
Des antiquités provenant de fouilles sont également entrées dans le musée à la fin des années 1800 grâce au travail du Fonds d'exploration égyptien (aujourd'hui la Société). Une source majeure d'antiquités provenait des efforts de EA Wallis Budge (Keeper 1886-1924), qui visitait régulièrement l'Égypte et constituait une vaste collection de papyrus et de matériel funéraire. Les momies constituent l’un des aspects les plus caractéristiques de la culture égyptienne antique. La préservation du corps était un élément essentiel de la croyance et de la pratique funéraire égyptienne.
La momification semble avoir ses origines à la fin de la période prédynastique (avant 3000 avant JC) lorsque des parties spécifiques du corps étaient enveloppées, comme le visage et les mains. Il a été suggéré que le processus s'est développé pour reproduire les effets desséchants (séchant) du sable chaud et sec sur un corps enfoui à l'intérieur. Le meilleur récit littéraire du processus de momification est celui de l’historien grec Hérodote, qui affirme que l’ensemble du processus a duré 70 jours. Les organes internes, à l'exception du cœur et des reins, ont été retirés via une coupure sur le côté gauche. Les organes étaient séchés et enveloppés, puis placés dans des pots à canope, ou ensuite replacés à l'intérieur du corps.
Le cerveau était retiré, souvent par le nez, et jeté. Des sacs de natron ou de sel étaient emballés à l'intérieur et à l'extérieur du corps et laissés pendant quarante jours jusqu'à ce que toute l'humidité ait été éliminée. Le corps était ensuite nettoyé avec des huiles et des résines aromatiques et enveloppé de bandages, souvent du linge de maison déchiré en lanières. Ces derniers temps, l’analyse scientifique des momies, par rayons X, tomodensitométrie, endoscopie et autres procédés, a révélé une mine d’informations sur la façon dont les individus vivaient et mouraient. Il a été possible d'identifier des pathologies telles que le cancer du poumon, l'arthrose et la tuberculose, ainsi que des troubles parasitaires tels que la schistosomiase (bilharziose).
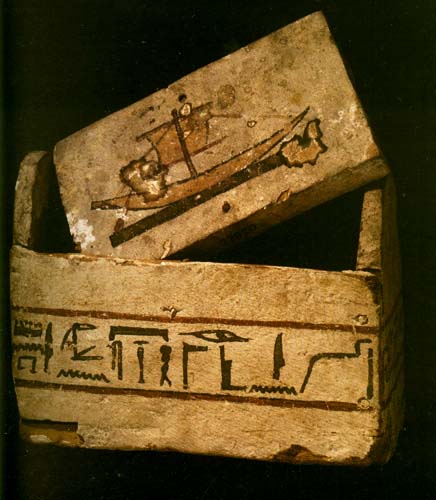 Les premiers Égyptiens enterraient leurs morts dans de petites fosses situées dans le désert. La chaleur et la sécheresse du sable ont rapidement déshydraté les corps, créant des « momies » réalistes et naturelles, comme le montre l'exposition. Plus tard, les anciens Égyptiens ont commencé à enterrer leurs morts dans des cercueils pour les protéger des animaux sauvages du désert. Cependant, ils se sont rendu compte que les corps placés dans des cercueils se décomposaient parce qu’ils n’étaient pas exposés au sable chaud et sec du désert. Pendant de nombreux siècles, les anciens Égyptiens ont développé une méthode pour préserver les corps afin qu’ils restent vivants. Le processus comprenait l'embaumement des corps et les envelopper dans des bandes de lin. Aujourd’hui, nous appelons ce processus la momification.
Les premiers Égyptiens enterraient leurs morts dans de petites fosses situées dans le désert. La chaleur et la sécheresse du sable ont rapidement déshydraté les corps, créant des « momies » réalistes et naturelles, comme le montre l'exposition. Plus tard, les anciens Égyptiens ont commencé à enterrer leurs morts dans des cercueils pour les protéger des animaux sauvages du désert. Cependant, ils se sont rendu compte que les corps placés dans des cercueils se décomposaient parce qu’ils n’étaient pas exposés au sable chaud et sec du désert. Pendant de nombreux siècles, les anciens Égyptiens ont développé une méthode pour préserver les corps afin qu’ils restent vivants. Le processus comprenait l'embaumement des corps et les envelopper dans des bandes de lin. Aujourd’hui, nous appelons ce processus la momification.
Les amulettes égyptiennes (amulettes ornementales) étaient portées à la fois par les vivants et les morts. Certains protégeaient celui qui les portait contre des dangers spécifiques et d'autres le dotaient de caractéristiques particulières, comme la force ou la férocité. Les amulettes avaient souvent la forme d'animaux, de plantes, d'objets sacrés ou de symboles hiéroglyphiques. La combinaison de forme, de couleur et de matériau était importante pour l’efficacité d’une amulette. Les papyrus (rouleaux égyptiens) montrent que les amulettes étaient utilisées en médecine, souvent en conjonction avec des cataplasmes (un pansement médicamenteux, souvent appliqué chaud) ou d'autres préparations, et pour la récitation de sorts. Parfois, les papyrus sur lesquels les sorts étaient écrits pouvaient également faire office d'amulettes et étaient pliés et portés par leur propriétaire.
L’une des amulettes protectrices les plus utilisées était l’œil oudjat : l’œil restauré d’Horus. Il était porté par les vivants et apparaissait souvent sur des bagues et comme élément de colliers. Il était également placé sur le corps du défunt lors du processus de momification pour protéger l'incision par laquelle les organes internes étaient retirés. Plusieurs sorts du Livre des Morts étaient destinés à être prononcés sur des amulettes spécifiques, qui étaient ensuite placées à des endroits particuliers sur le corps du défunt. Le scarabée (coléoptère) était une amulette funéraire importante, associée à la renaissance, et l'amulette scarabée du cœur empêchait le cœur de dénoncer le défunt.
Les anciens Égyptiens croyaient en de nombreux dieux et déesses différents, chacun ayant son propre rôle à jouer dans le maintien de la paix et de l'harmonie à travers le pays. Certains dieux et déesses ont participé à la création, certains ont provoqué le déluge chaque année, certains ont offert leur protection et certains ont pris soin des gens après leur mort. D'autres étaient soit des dieux locaux qui représentaient les villes, soit des dieux mineurs qui représentaient des plantes ou des animaux. Les anciens Égyptiens croyaient qu’il était important de reconnaître et d’adorer ces dieux et déesses afin que la vie se poursuive sans heurts.
 Les figures Shabti se sont développées à partir des figures de serviteurs communes dans les tombes de l'Empire du Milieu (environ 2040-1782 avant JC). Ils étaient représentés momifiés comme le défunt, avec leur propre cercueil, et portaient un sortilège leur permettant de fournir de la nourriture à leur maître ou maîtresse dans l'au-delà. À partir du Nouvel Empire (environ 1550-1070 av. J.-C.), le défunt était censé participer à l'entretien du « Champ des Roseaux », où il vivrait pour l'éternité. Cela signifiait entreprendre des travaux agricoles, tels que labourer, semer et récolter les récoltes.
Les figures Shabti se sont développées à partir des figures de serviteurs communes dans les tombes de l'Empire du Milieu (environ 2040-1782 avant JC). Ils étaient représentés momifiés comme le défunt, avec leur propre cercueil, et portaient un sortilège leur permettant de fournir de la nourriture à leur maître ou maîtresse dans l'au-delà. À partir du Nouvel Empire (environ 1550-1070 av. J.-C.), le défunt était censé participer à l'entretien du « Champ des Roseaux », où il vivrait pour l'éternité. Cela signifiait entreprendre des travaux agricoles, tels que labourer, semer et récolter les récoltes.
La figure shabti est devenue considérée comme une figure de serviteur qui effectuait de gros travaux au nom du défunt. Les personnages étaient encore momiformes (en forme de momies), mais tenaient désormais des outils agricoles tels que des houes. Ils portaient un sortilège qui les faisait répondre lorsque le défunt était appelé au travail. Le nom « shabti » signifie « répondeur ». Dès la fin du Nouvel Empire, quiconque en avait les moyens disposait d'un ouvrier pour chaque jour de l'année, ainsi que d'un surveillant pour chaque équipe de dix ouvriers. Cela donnait un total de 401 figurines, bien que de nombreux individus possédaient plusieurs ensembles. Ces vastes collections de figures étaient souvent de très mauvaise qualité, sans inscription et constituées de boue plutôt que de faïence qui avait été populaire au Nouvel Empire. [HistoryPlace.Com].
AVIS DES LECTEURS:
AVIS: J'ai acheté ce livre lorsque je suis allé voir l'exposition au Bowers Museum. C'était l'une des meilleures expositions sur l'Égypte ancienne à laquelle j'ai assisté et j'ai pris le livre pour me rappeler tous les beaux objets que j'ai vus. Le livre est tout aussi fabuleux !
AVIS: Superbe catalogue d'exposition. Des momies exquises et des artefacts associés, des photographies magnifiques et une narration érudite donnent un contexte captivant.
CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE:
AVIS: La momification dans l'Egypte ancienne. La pratique de momification des morts a commencé dans l'Égypte ancienne vers 3500 avant JC. Le mot anglais momie vient du latin mumia qui dérive du persan mum signifiant « cire » et fait référence à un cadavre embaumé ressemblant à de la cire. L'idée de momifier les morts a peut-être été suggérée par la qualité de la conservation des cadavres dans les sables arides du pays. Les premières tombes de la période badarienne (environ 5 000 avant JC) contenaient des offrandes de nourriture et des objets funéraires, suggérant une croyance en une vie après la mort, mais les cadavres n'étaient pas momifiés.
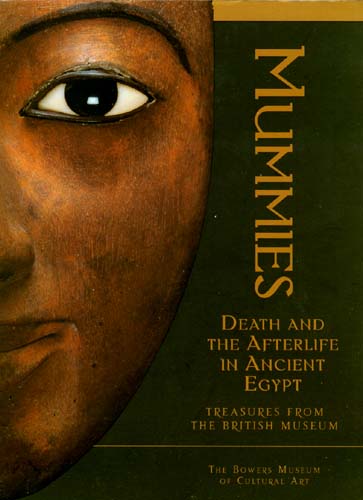 Ces tombes étaient des rectangles ou des ovales peu profonds dans lesquels un cadavre était placé sur son côté gauche, souvent en position fœtale. Ils étaient considérés comme le lieu de repos final du défunt et étaient souvent, comme en Mésopotamie, situés dans ou à proximité de la maison familiale. Les tombes ont évolué au cours des époques suivantes jusqu'à ce que, au début de la période dynastique en Égypte (vers 3150 - 2613 av. J.-C.), le tombeau mastaba ait remplacé la simple tombe et les cimetières sont devenus courants. Les mastabas n'étaient pas considérés comme un lieu de repos final mais comme une demeure éternelle pour le corps.
Ces tombes étaient des rectangles ou des ovales peu profonds dans lesquels un cadavre était placé sur son côté gauche, souvent en position fœtale. Ils étaient considérés comme le lieu de repos final du défunt et étaient souvent, comme en Mésopotamie, situés dans ou à proximité de la maison familiale. Les tombes ont évolué au cours des époques suivantes jusqu'à ce que, au début de la période dynastique en Égypte (vers 3150 - 2613 av. J.-C.), le tombeau mastaba ait remplacé la simple tombe et les cimetières sont devenus courants. Les mastabas n'étaient pas considérés comme un lieu de repos final mais comme une demeure éternelle pour le corps.
Le tombeau était désormais considéré comme un lieu de transformation dans lequel l'âme quittait le corps pour aller dans l'au-delà. On pensait pourtant que le corps devait rester intact pour que l’âme puisse poursuivre son voyage. Une fois libérée du corps, l’âme aurait besoin de s’orienter par ce qui lui était familier. Pour cette raison, les tombes étaient peintes avec des histoires et des sortilèges du Livre des Morts, pour rappeler à l'âme ce qui se passait et à quoi s'attendre, ainsi qu'avec des inscriptions connues sous le nom de Textes des Pyramides et Textes du Cercueil qui racontaient les événements de la la vie d'une personne décédée.
Pour les Égyptiens, la mort n’était pas la fin de la vie mais simplement une transition d’un état à un autre. Pour cela, le corps devait être soigneusement préparé afin d'être reconnaissable par l'âme dès son réveil dans le tombeau et aussi plus tard.
À l'époque de l'Ancien Empire égyptien (vers 2613-2181 avant JC), la momification était devenue une pratique courante dans le traitement des défunts et des rituels mortuaires se développaient autour de la mort, de l'agonie et de la momification. Ces rituels et leurs symboles étaient en grande partie issus du culte d'Osiris qui était déjà devenu un dieu populaire. Osiris et sa sœur-épouse Isis furent les premiers dirigeants mythiques de l'Égypte, qui reçurent le pays peu après la création du monde. Ils régnaient sur un royaume de paix et de tranquillité, enseignant au peuple les arts de l’agriculture et de la civilisation et accordant aux hommes et aux femmes des droits égaux pour vivre ensemble dans l’équilibre et l’harmonie.
Le frère d'Osiris, Set, devint cependant jaloux du pouvoir et du succès de son frère et l'assassina ainsi ; d'abord en le scellant dans un cercueil et en l'envoyant sur le Nil, puis en découpant son corps en morceaux et en les dispersant à travers l'Égypte. Isis a récupéré les pièces d'Osiris, l'a remonté puis, avec l'aide de sa sœur Nephthys, l'a ramené à la vie. Osiris était cependant incomplet - il lui manquait son pénis mangé par un poisson - et ne pouvait donc plus régner sur terre. Il descendit aux enfers où il devint Seigneur des Morts. Avant son départ, cependant, Isis s'était accouplée avec lui sous la forme d'un cerf-volant et lui avait donné un fils, Horus, qui grandirait pour venger son père, récupérer le royaume et rétablir l'ordre et l'équilibre dans le pays.
 Ce mythe est devenu si incroyablement populaire qu'il a imprégné la culture et assimilé des dieux et des mythes antérieurs pour créer une croyance centrale en une vie après la mort et la possibilité d'une résurrection des morts. Osiris était souvent représenté comme un souverain momifié et régulièrement représenté avec une peau verte ou noire symbolisant à la fois la mort et la résurrection. L'égyptologue Margaret Bunson écrit : « Le culte d'Osiris a commencé à exercer une influence sur les rituels mortuaires et les idéaux de contemplation de la mort comme « une porte vers l'éternité ». Cette divinité, ayant assumé les pouvoirs de culte et les rituels d'autres dieux des nécropoles ou des cimetières, offrit aux êtres humains le salut, la résurrection et le bonheur éternel.
Ce mythe est devenu si incroyablement populaire qu'il a imprégné la culture et assimilé des dieux et des mythes antérieurs pour créer une croyance centrale en une vie après la mort et la possibilité d'une résurrection des morts. Osiris était souvent représenté comme un souverain momifié et régulièrement représenté avec une peau verte ou noire symbolisant à la fois la mort et la résurrection. L'égyptologue Margaret Bunson écrit : « Le culte d'Osiris a commencé à exercer une influence sur les rituels mortuaires et les idéaux de contemplation de la mort comme « une porte vers l'éternité ». Cette divinité, ayant assumé les pouvoirs de culte et les rituels d'autres dieux des nécropoles ou des cimetières, offrit aux êtres humains le salut, la résurrection et le bonheur éternel.
Mais la vie éternelle n’était possible que si le corps restait intact. Le nom d'une personne, son identité, représentait son âme immortelle, et cette identité était liée à sa forme physique. Parties de l'âme. On pensait que l'âme était composée de neuf parties distinctes : 1. Le Khat était le corps physique ; 2. La double forme du Ka (le moi astral) ; 3. Le Ba était un aspect d'oiseau à tête humaine qui pouvait se déplacer entre la terre et les cieux (en particulier entre l'au-delà et le corps) ; 4.Le Shuyet était le moi de l'ombre ; 5. L'Akh était le moi immortel et transformé après la mort ; 6.Le Sahu était un aspect de l'Akh ; 7. Le Sechem était un autre aspect de l'Akh ; 8. L'Ab était le cœur, la source du bien et du mal, détenteur du caractère ; 9.Le Ren était le nom secret de quelqu'un.
Le Khat devait exister pour que le Ka et le Ba se reconnaissent et puissent fonctionner correctement. Une fois libérés du corps, ces différents aspects seraient confus et auraient d'abord besoin de se centrer sous une forme familière. Lorsqu'une personne mourait, elle était amenée chez les embaumeurs qui offraient trois types de services. Selon Hérodote : « On dit que le type le meilleur et le plus cher représente [Osiris], le deuxième meilleur est quelque peu inférieur et moins cher, tandis que le troisième est le moins cher de tous ». Il a été demandé à la famille en deuil de choisir le service qu'elle préférait, et sa réponse était extrêmement importante non seulement pour le défunt mais pour elle-même. La pratique funéraire et les rituels mortuaires dans l’Égypte ancienne étaient pris si au sérieux en raison de la croyance selon laquelle la mort n’était pas la fin de la vie.
Évidemment, le meilleur service serait le plus cher, mais si la famille pouvait se le permettre et choisissait pourtant de ne pas l'acheter, elle courait le risque d'être hantée. La personne décédée saurait qu’elle a reçu un service moins cher que ce qu’elle méritait et ne pourrait pas continuer paisiblement dans l’au-delà ; au lieu de cela, ils revenaient rendre la vie de leurs proches misérable jusqu'à ce que le tort soit réparé. La pratique funéraire et les rituels mortuaires dans l’Égypte ancienne étaient pris si au sérieux en raison de la croyance selon laquelle la mort n’était pas la fin de la vie. L'individu décédé pouvait encore voir et entendre, et s'il était lésé, les dieux l'autoriseraient à se venger.
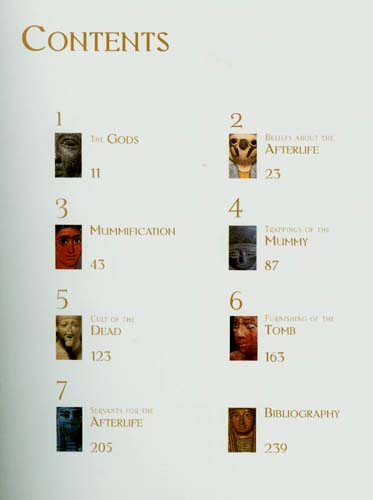 Il semblerait cependant que les gens choisissent toujours le niveau de service qu’ils peuvent se permettre le plus facilement. Une fois choisi, ce niveau déterminait le type de cercueil dans lequel on serait enterré, les rites funéraires disponibles et le traitement du corps. L'égyptologue Salima Ikram, professeur d'égyptologie à l'Université américaine du Caire, a étudié la momification en profondeur et fournit ce qui suit : « L'ingrédient clé de la momification était le natron, ou netjry, le sel divin. Il s'agit d'un mélange de bicarbonate de sodium, de carbonate de sodium, de sulfate de sodium et de chlorure de sodium, présent naturellement en Égypte, le plus souvent dans le Wadi Natrun, à environ soixante-quatre kilomètres au nord-ouest du Caire. Il a des propriétés desséchantes et dégraissantes et était le dessicant préféré, bien que le sel commun ait également été utilisé dans des enterrements plus économiques.
Il semblerait cependant que les gens choisissent toujours le niveau de service qu’ils peuvent se permettre le plus facilement. Une fois choisi, ce niveau déterminait le type de cercueil dans lequel on serait enterré, les rites funéraires disponibles et le traitement du corps. L'égyptologue Salima Ikram, professeur d'égyptologie à l'Université américaine du Caire, a étudié la momification en profondeur et fournit ce qui suit : « L'ingrédient clé de la momification était le natron, ou netjry, le sel divin. Il s'agit d'un mélange de bicarbonate de sodium, de carbonate de sodium, de sulfate de sodium et de chlorure de sodium, présent naturellement en Égypte, le plus souvent dans le Wadi Natrun, à environ soixante-quatre kilomètres au nord-ouest du Caire. Il a des propriétés desséchantes et dégraissantes et était le dessicant préféré, bien que le sel commun ait également été utilisé dans des enterrements plus économiques.
Dans le type de service funéraire le plus coûteux, le corps était disposé sur une table et lavé. Les embaumeurs commençaient alors leur travail par la tête : « Le cerveau était retiré par les narines avec un crochet de fer, et ce qui ne pouvait être atteint avec le crochet était lavé avec des médicaments ; ensuite le flanc était ouvert avec un couteau en silex et l'ensemble le contenu de l'abdomen est retiré ; la cavité est ensuite soigneusement nettoyée et lavée, d'abord avec du vin de palme, puis à nouveau avec une infusion d'épices moulues.
Après cela, il est rempli de myrrhe pure, de cassia et de toute autre substance aromatique, à l'exception de l'encens, et recousu, après quoi le corps est placé dans le natron, entièrement recouvert pendant soixante-dix jours – jamais plus. Cette période passée, le corps est lavé puis enveloppé de la tête aux pieds dans du lin coupé en bandes et enduit sur le dessous de gomme, qui est couramment utilisée par les Égyptiens à la place de la colle. Dans cet état, le corps est restitué à la famille qui fait fabriquer une caisse en bois, en forme de figure humaine, dans laquelle il est placé.
Dans la deuxième inhumation la plus coûteuse, moins de soins ont été apportés au corps : « Aucune incision n'est pratiquée et les intestins ne sont pas retirés, mais de l'huile de cèdre est injectée avec une seringue dans le corps par l'anus qui est ensuite bouché pour empêcher le liquide de s'échapper. Le corps est ensuite guéri au natron pendant le nombre de jours prescrit, au cours duquel l'huile est évacuée. L'effet est si puissant qu'en quittant le corps, il entraîne avec lui les viscères à l'état liquide et, comme la chair a été dissoute par le natron, il ne reste plus rien du corps à part la peau et les os. Après ce traitement, il est restitué à la famille sans autre attention.
La troisième méthode d'embaumement, la moins chère, consistait « simplement à laver les intestins et à garder le corps pendant soixante-dix jours dans le natron ». Les organes internes ont été prélevés afin de contribuer à la préservation du cadavre, mais comme on pensait que le défunt en aurait encore besoin, les viscères ont été placés dans des canopes pour être scellés dans la tombe. Seul le cœur était laissé à l’intérieur du corps car on pensait qu’il contenait l’aspect Ab de l’âme. Les embaumeurs ont retiré les organes de l'abdomen par une longue incision pratiquée dans le côté gauche. En retirant le cerveau, comme le note Ikram, ils inséraient un outil chirurgical accroché dans le nez de la personne décédée et retiraient le cerveau en morceaux, mais il existe également des preuves d'embaumeurs cassant le nez pour agrandir l'espace et extraire le cerveau plus facilement. .
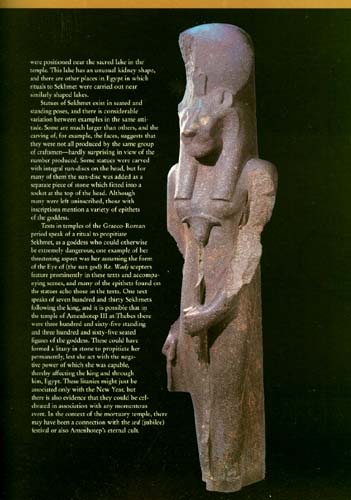 Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. Ce processus a été suivi aussi bien chez les animaux que chez les humains. Les Égyptiens momifiaient régulièrement leurs chats, chiens, gazelles, poissons, oiseaux, babouins, mais aussi le taureau Apis, considéré comme une incarnation du divin. L’ablation des organes et du cerveau avait pour seul but d’assécher le corps. Le seul organe qu'ils ont laissé en place, à la plupart des époques, était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité et du caractère de la personne. Le sang était drainé et les organes prélevés pour éviter la décomposition, le corps était à nouveau lavé et le pansement (enveloppement en lin) était appliqué.
Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. Ce processus a été suivi aussi bien chez les animaux que chez les humains. Les Égyptiens momifiaient régulièrement leurs chats, chiens, gazelles, poissons, oiseaux, babouins, mais aussi le taureau Apis, considéré comme une incarnation du divin. L’ablation des organes et du cerveau avait pour seul but d’assécher le corps. Le seul organe qu'ils ont laissé en place, à la plupart des époques, était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité et du caractère de la personne. Le sang était drainé et les organes prélevés pour éviter la décomposition, le corps était à nouveau lavé et le pansement (enveloppement en lin) était appliqué.
Bien que les processus ci-dessus soient la norme observée tout au long de la majeure partie de l’histoire de l’Égypte, il y a eu des écarts à certaines époques. Bunson note : « Chaque période de l’Égypte ancienne a été témoin d’une altération des différents organes conservés. Le cœur, par exemple, a été conservé à certaines époques et, sous les dynasties ramessides, les organes génitaux étaient chirurgicalement retirés et placés dans un cercueil spécial en forme du dieu Osiris. Cela était peut-être célébré en commémoration de la perte par le dieu de ses propres organes génitaux ou comme cérémonie mystique. Cependant, tout au long de l'histoire de la nation, les jarres canopes étaient sous la protection des Mesu Heru, les quatre fils d'Horus. Ces jarres et leur contenu, les organes imbibés de résine, étaient conservés à proximité du sarcophage dans des conteneurs spéciaux.
Une fois les organes prélevés et le corps lavé, le cadavre était enveloppé dans du linge - soit par les embaumeurs, si l'on avait choisi le service le plus coûteux (qui inclurait également des amulettes magiques et des charmes de protection dans l'emballage), soit par le famille - et placé dans un sarcophage ou un simple cercueil. Cet emballage était connu sous le nom de « linge d'hier » car, au départ, les pauvres donnaient leurs vieux vêtements aux embaumeurs pour qu'ils enveloppent le cadavre. Cette pratique a finalement conduit à n’importe quel tissu de lin utilisé pour l’embaumement connu sous le même nom.
Les funérailles étaient une affaire publique au cours de laquelle, si l'on pouvait se le permettre, des femmes étaient embauchées comme pleureuses professionnelles. Ces femmes étaient connues sous le nom de « Cerfs-volants de Nephthys » et encourageaient les gens à exprimer leur chagrin par leurs propres cris et lamentations. Ils faisaient référence à la brièveté de la vie et à la soudaineté de la mort, mais donnaient également l'assurance de l'aspect éternel de l'âme et la confiance que le défunt passerait par l'épreuve de la pesée du cœur dans l'au-delà par Osiris pour passer au paradis. au Champ des Roseaux.
Les objets funéraires, aussi riches ou modestes soient-ils, seraient placés dans le tombeau ou la tombe. Il s'agirait notamment de poupées shabti qui, dans l'au-delà, pourraient être réveillées grâce à un sort et assumer les tâches de la personne décédée. Puisque la vie après la mort était considérée comme une version éternelle et parfaite de la vie sur terre, on pensait qu'il y avait du travail là-bas, tout comme dans la vie mortelle. Le shabti accomplissait ces tâches afin que l'âme puisse se détendre et s'amuser. Les poupées Shabti sont des indicateurs importants pour les archéologues modernes sur la richesse et le statut de l'individu enterré dans une certaine tombe ; plus il y a de poupées shabti, plus la richesse est grande.
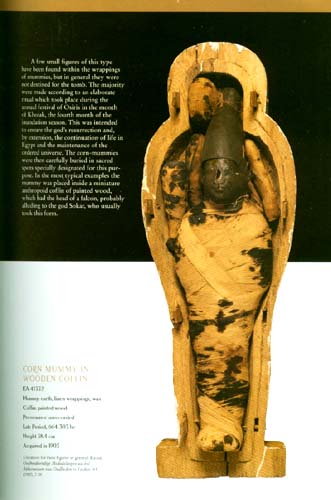 Outre le shabti, la personne serait enterrée avec des objets jugés nécessaires dans l'au-delà : des peignes, des bijoux, de la bière, du pain, des vêtements, ses armes, un objet préféré, voire ses animaux de compagnie. Tous ces éléments apparaîtraient à l’âme dans l’au-delà et elle pourrait les utiliser. Avant que le tombeau ne soit scellé, un rituel était célébré, considéré comme vital pour la poursuite du voyage de l'âme : la cérémonie d'ouverture de la bouche. Dans ce rite, un prêtre invoquait Isis et Nephthys (qui avaient ramené Osiris à la vie) en touchant la momie avec différents objets (herminettes, ciseaux, couteaux) à différents endroits tout en oignant le corps. Ce faisant, il a redonné l’usage des oreilles, des yeux, de la bouche et du nez au défunt.
Outre le shabti, la personne serait enterrée avec des objets jugés nécessaires dans l'au-delà : des peignes, des bijoux, de la bière, du pain, des vêtements, ses armes, un objet préféré, voire ses animaux de compagnie. Tous ces éléments apparaîtraient à l’âme dans l’au-delà et elle pourrait les utiliser. Avant que le tombeau ne soit scellé, un rituel était célébré, considéré comme vital pour la poursuite du voyage de l'âme : la cérémonie d'ouverture de la bouche. Dans ce rite, un prêtre invoquait Isis et Nephthys (qui avaient ramené Osiris à la vie) en touchant la momie avec différents objets (herminettes, ciseaux, couteaux) à différents endroits tout en oignant le corps. Ce faisant, il a redonné l’usage des oreilles, des yeux, de la bouche et du nez au défunt.
Le fils et héritier du défunt assumait souvent le rôle du prêtre, reliant ainsi davantage le rite à l'histoire d'Horus et de son père Osiris. Le défunt pouvait désormais entendre, voir et parler et était prêt à continuer le voyage. La momie serait enfermée dans le sarcophage ou le cercueil, qui serait enterré dans une tombe ou déposé dans une tombe avec les objets funéraires, et les funérailles se termineraient. Les vivants retournaient alors à leurs affaires, et les morts étaient alors censés accéder à la vie éternelle. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Rituels mortuaires égyptiens antiques. Depuis que les archéologues européens ont commencé à fouiller en Égypte aux XVIIIe et XIXe siècles après J.-C., la culture ancienne a été largement associée à la mort. Même au milieu du XXe siècle, des érudits réputés écrivaient encore sur les Égyptiens obsédés par la mort et dont la vie manquait de jeu et de joie. Les momies dans des tombeaux sombres et labyrinthiques, d'étranges rituels exécutés par des prêtres austères et les tombeaux pyramidaux des rois restent les images les plus marquantes de l'Égypte ancienne dans l'esprit de nombreuses personnes, même de nos jours, et un éventail de plus de 2 000 divinités - dont beaucoup uniquement associé à l'au-delà - semble simplement s'ajouter à la vision établie des anciens Égyptiens obsédés par la mort. En réalité, cependant, ils étaient pleinement engagés dans la vie, à tel point que leur vie après la mort était considérée comme une continuation éternelle de leur séjour sur terre.
Lorsqu'une personne mourait dans l'Egypte ancienne, les funérailles étaient un événement public qui permettait aux vivants de pleurer le décès d'un membre de la communauté et permettait au défunt de passer du plan terrestre à l'éternel. Même s’il y avait des effusions de chagrin et un profond deuil suite à la perte d’un être cher, ils ne croyaient pas que la personne décédée avait cessé d’exister ; ils avaient simplement quitté la terre pour un autre royaume. Afin de s'assurer qu'ils atteignent leur destination en toute sécurité, les Égyptiens ont développé des rituels mortuaires élaborés pour préserver le corps, libérer l'âme et la laisser partir. Ces rituels encourageaient l'expression saine du chagrin parmi les vivants mais se terminaient par une fête célébrant la vie du défunt et son départ, soulignant que la mort n'était pas la fin mais seulement une continuation. L'égyptologue Helen Strudwick note que « pour les Égyptiens épris de vie, la garantie de continuer à vivre dans le monde souterrain était extrêmement importante ». Les rituels mortuaires offraient précisément ce genre de garantie aux gens.
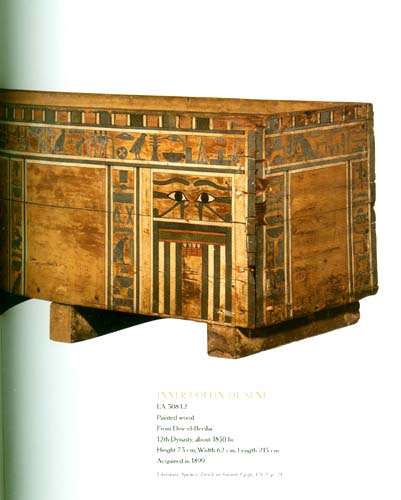 Les premières sépultures de l'Égypte ancienne étaient de simples tombes dans lesquelles le défunt était placé, sur le côté gauche, accompagné de quelques objets funéraires. Il est clair qu'il existait déjà une croyance en une sorte de vie après la mort avant environ 3 500 avant JC, lorsque la momification a commencé à être pratiquée, mais aucune trace écrite de la forme que prenait cette croyance. Les tombes simples de la période prédynastique en Égypte (vers 6000 - 3150 avant JC) ont évolué vers les tombes mastaba du début de la période dynastique (vers 3150 - 2613 avant JC), qui sont ensuite devenues les grandes pyramides de l'Ancien Empire (vers 2613-2181 avant JC). Toutes ces périodes croyaient à une vie après la mort et se livraient à des rituels mortuaires, mais celles de l'Ancien Empire sont les plus connues grâce aux images sur les tombes. Bien que l’on pense généralement que tout le monde en Égypte était momifié après sa mort, cette pratique était coûteuse et seules la classe supérieure et la noblesse pouvaient se le permettre.
Les premières sépultures de l'Égypte ancienne étaient de simples tombes dans lesquelles le défunt était placé, sur le côté gauche, accompagné de quelques objets funéraires. Il est clair qu'il existait déjà une croyance en une sorte de vie après la mort avant environ 3 500 avant JC, lorsque la momification a commencé à être pratiquée, mais aucune trace écrite de la forme que prenait cette croyance. Les tombes simples de la période prédynastique en Égypte (vers 6000 - 3150 avant JC) ont évolué vers les tombes mastaba du début de la période dynastique (vers 3150 - 2613 avant JC), qui sont ensuite devenues les grandes pyramides de l'Ancien Empire (vers 2613-2181 avant JC). Toutes ces périodes croyaient à une vie après la mort et se livraient à des rituels mortuaires, mais celles de l'Ancien Empire sont les plus connues grâce aux images sur les tombes. Bien que l’on pense généralement que tout le monde en Égypte était momifié après sa mort, cette pratique était coûteuse et seules la classe supérieure et la noblesse pouvaient se le permettre.
À l’époque de l’Ancien Empire égyptien, la culture avait une compréhension claire du fonctionnement de l’univers et de la place de l’humanité dans celui-ci. Les dieux avaient créé le monde et ses habitants grâce à la magie (heka) et l'avaient également soutenu grâce à la magie. Le monde entier était imprégné de la vie mystique générée par les dieux qui accueilleraient l'âme lorsqu'elle quitterait finalement la terre pour l'au-delà. Pour que l’âme puisse faire ce voyage, le corps qu’elle laissait derrière elle devait être soigneusement préservé, et c’est pourquoi la momification est devenue une partie intégrante des rituels mortuaires. Bien que l’on pense généralement que tout le monde en Égypte était momifié après sa mort, cette pratique était coûteuse et seules les classes supérieures et la noblesse pouvaient se le permettre.
Dans l'Ancien Empire, les rois étaient enterrés dans leurs tombeaux pyramidaux, mais à partir de la Première Période Intermédiaire de l'Égypte (2181-2040 av. J.-C.), les rois et les nobles préféraient les tombeaux creusés dans la roche ou dans la terre. À l'époque du Nouvel Empire (vers 1570-1069 av. J.-C.), les tombes et les rituels menant à l'inhumation avaient atteint leur plus haut état de développement. Il y avait trois méthodes d'embaumement/rituel funéraire disponibles : la plus chère et la plus élaborée, une deuxième option, moins chère, qui permettait encore une grande partie de la première, et une troisième qui était encore moins chère et accordait peu d'attention aux détails de la première. Les rituels et méthodes d'embaumement suivants décrits sont ceux de la première option, la plus élaborée, qui était pratiquée pour la royauté et les rituels spécifiques sont ceux observés dans le Nouvel Empire d'Égypte.
Après la mort, le corps était amené aux embaumeurs où les prêtres le lavaient et le purifiaient. Le prêtre de la morgue prélevait ensuite les organes qui se dégraderaient le plus rapidement et détruiraient le corps. Au début de la momification, les organes de l'abdomen et du cerveau étaient placés dans des bocaux canopes que l'on pensait être surveillés par les dieux gardiens connus sous le nom de Les Quatre Fils d'Horus. Plus tard, les organes étaient retirés, traités, enveloppés et replacés dans le corps, mais des jarres canopes étaient toujours placées dans les tombes et on pensait toujours que les Quatre Fils d'Horus surveillaient les organes.
 Les embaumeurs prélevaient les organes de l'abdomen par une longue incision pratiquée dans le côté gauche ; pour le cerveau, ils inséraient un outil chirurgical accroché dans le nez de la personne décédée et retiraient le cerveau en morceaux. Il existe également des preuves d'embaumeurs cassant le nez pour agrandir l'espace et faire sortir le cerveau plus facilement. Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. L'ablation des organes et du cerveau visait à assécher le corps. Le seul organe laissé en place était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité de la personne. Tout cela a été fait parce que l'âme avait besoin d'être libérée du corps pour continuer son voyage éternel dans l'au-delà et, pour ce faire, elle avait besoin d'avoir une « maison » intacte à laisser derrière elle et qu'elle reconnaîtrait si elle le souhaitait. revenir visiter.
Les embaumeurs prélevaient les organes de l'abdomen par une longue incision pratiquée dans le côté gauche ; pour le cerveau, ils inséraient un outil chirurgical accroché dans le nez de la personne décédée et retiraient le cerveau en morceaux. Il existe également des preuves d'embaumeurs cassant le nez pour agrandir l'espace et faire sortir le cerveau plus facilement. Se casser le nez n'était cependant pas la méthode privilégiée, car cela pouvait défigurer le visage du défunt et le but principal de la momification était de garder le corps intact et préservé aussi fidèlement que possible. L'ablation des organes et du cerveau visait à assécher le corps. Le seul organe laissé en place était le cœur, car on pensait que c'était le siège de l'identité de la personne. Tout cela a été fait parce que l'âme avait besoin d'être libérée du corps pour continuer son voyage éternel dans l'au-delà et, pour ce faire, elle avait besoin d'avoir une « maison » intacte à laisser derrière elle et qu'elle reconnaîtrait si elle le souhaitait. revenir visiter.
Après le prélèvement des organes, le corps a été trempé dans du natron pendant 70 jours puis lavé et purifié à nouveau. Il était ensuite soigneusement enveloppé dans du lin ; un processus qui pourrait prendre jusqu’à deux semaines. L'égyptologue Margaret Bunson explique : « C'était un aspect important du processus mortuaire, accompagné d'incantations, d'hymnes et de cérémonies rituelles. Dans certains cas, les draps provenant des sanctuaires et des temples étaient fournis aux défunts riches ou aristocratiques, croyant que ces matériaux avaient des grâces spéciales et des pouvoirs magiques. Une momie individuelle nécessiterait environ 445 mètres carrés de matériau. Tout au long des emballages, des pierres semi-précieuses et des amulettes étaient placées à des positions stratégiques, chacune garantissant la protection d'une certaine région de l'anatomie humaine dans l'au-delà. »
Parmi ces amulettes les plus importantes se trouvait celle qui était placée sur le cœur. Cela avait pour but d'empêcher le cœur de témoigner contre le défunt au moment du jugement. Puisque le cœur était le siège du caractère individuel et qu'il était évident que les gens faisaient souvent des déclarations qu'ils regrettaient plus tard, il était important d'avoir un charme pour empêcher cette possibilité. Les embaumeurs rendraient ensuite la momie à la famille qui ferait confectionner un cercueil ou un sarcophage.
Le cadavre ne serait cependant pas encore placé dans le cercueil, mais serait déposé sur une cercueil puis transporté vers un bateau en attente sur le Nil. C'était le début du service funéraire qui commençait tôt le matin, généralement au départ soit d'un temple du roi, soit du centre de l'embaumeur. Les serviteurs et les parents les plus pauvres du défunt étaient en tête du cortège portant des fleurs et des offrandes de nourriture. Ils étaient suivis par d'autres transportant des objets funéraires tels que des vêtements et des poupées shabti, les biens favoris du défunt et d'autres objets qui seraient nécessaires dans l'au-delà.
 Directement devant le cadavre se trouvaient des pleureuses professionnelles, des femmes connues sous le nom de Cerfs-volants de Nephthys, dont le but était d'encourager les autres à exprimer leur chagrin. Les cerfs-volants hurlaient bruyamment, se frappaient la poitrine, se cognaient la tête contre le sol et hurlaient de douleur. Ces femmes étaient habillées de la couleur du deuil et du chagrin, un bleu-gris, et se couvraient le visage et les cheveux de poussière et de terre. Il s'agissait d'un poste rémunéré, et plus le défunt était riche, plus il y avait de cerfs-volants présents dans le cortège. Une scène du tombeau du pharaon Horemheb (1320-1292 av. J.-C.) du Nouvel Empire représente de manière vivante les cerfs-volants de Nephthys au travail alors qu'ils gémissent et se jettent à terre.
Directement devant le cadavre se trouvaient des pleureuses professionnelles, des femmes connues sous le nom de Cerfs-volants de Nephthys, dont le but était d'encourager les autres à exprimer leur chagrin. Les cerfs-volants hurlaient bruyamment, se frappaient la poitrine, se cognaient la tête contre le sol et hurlaient de douleur. Ces femmes étaient habillées de la couleur du deuil et du chagrin, un bleu-gris, et se couvraient le visage et les cheveux de poussière et de terre. Il s'agissait d'un poste rémunéré, et plus le défunt était riche, plus il y avait de cerfs-volants présents dans le cortège. Une scène du tombeau du pharaon Horemheb (1320-1292 av. J.-C.) du Nouvel Empire représente de manière vivante les cerfs-volants de Nephthys au travail alors qu'ils gémissent et se jettent à terre.
Au début de la période dynastique en Égypte, les serviteurs auraient été tués en arrivant au tombeau afin de pouvoir continuer à servir le défunt dans l'au-delà. Au Nouvel Empire, cette pratique avait été abandonnée depuis longtemps et une effigie remplaçait désormais les serviteurs connus sous le nom de tekenu. Comme les poupées shabti, qu'on animerait magiquement dans l'au-delà pour accomplir un travail, les tekenu prendraient vie plus tard, de la même manière, pour servir l'âme au paradis.
Le cadavre et le tekenu étaient suivis par des prêtres, et lorsqu'ils atteignirent la rive orientale du Nil, les tekenu et les bœufs qui avaient tiré le cadavre furent rituellement sacrifiés et brûlés. Le cadavre a ensuite été déposé sur un bateau mortuaire avec deux femmes symbolisant les déesses Isis et Nephthys. C'était en référence au mythe d'Osiris dans lequel Osiris est tué par son frère Set et ramené à la vie par sa sœur-épouse Isis et sa sœur Nephthys. Dans sa vie, le roi était associé au fils d'Osiris et d'Isis, Horus, mais dans sa mort, au Seigneur des morts, Osiris. Les femmes s'adressaient au roi mort comme aux déesses parlant à Osiris.
Le bateau a navigué du côté est (représentant la vie) vers l'ouest (le pays des morts) où il a accosté et le corps a ensuite été déplacé vers une autre tombe et transporté jusqu'à sa tombe. Un prêtre aurait déjà fait installer le cercueil ou le sarcophage à l'entrée du tombeau, et à ce stade, le cadavre était placé à l'intérieur. Le prêtre effectuait ensuite la cérémonie d'ouverture de la bouche au cours de laquelle il touchait le cadavre à divers endroits du corps afin de restaurer les sens afin que le défunt puisse à nouveau voir, entendre, sentir, goûter et parler.
Au cours de cette cérémonie, les deux femmes représentant Isis et Nephthys récitaient Les Lamentations d'Isis et Nephthys, l'incantation d'appel et de réponse qui recréait le moment où Osiris avait été ramené à la vie par les sœurs. Le couvercle était ensuite fixé sur le cercueil et celui-ci était transporté dans le tombeau. Le tombeau contiendrait le nom du défunt, des statues et des photos de lui dans la vie, ainsi que des inscriptions sur le mur (textes des pyramides) racontant l'histoire de sa vie et fournissant des instructions pour l'au-delà. Des prières seraient faites pour l'âme du défunt et des objets funéraires seraient disposés autour du cercueil ; après cela, le tombeau serait scellé.
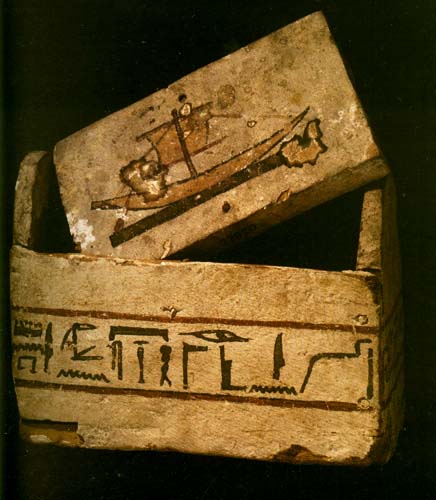 La famille était censée assurer la survie des défunts en leur apportant des offrandes de nourriture et de boissons et en se souvenant de leur nom. Si une famille trouvait cela trop pénible, elle engageait un prêtre (connu sous le nom de Ka-Servant) pour accomplir les tâches et les rituels. Des listes de nourriture et de boissons à apporter étaient inscrites sur la tombe (Listes d'Offrandes) ainsi qu'une autobiographie des défunts afin qu'on se souvienne d'eux. L'âme continuerait à exister paisiblement dans la vie suivante (après justification) tant que ces offrandes seraient faites.
La famille était censée assurer la survie des défunts en leur apportant des offrandes de nourriture et de boissons et en se souvenant de leur nom. Si une famille trouvait cela trop pénible, elle engageait un prêtre (connu sous le nom de Ka-Servant) pour accomplir les tâches et les rituels. Des listes de nourriture et de boissons à apporter étaient inscrites sur la tombe (Listes d'Offrandes) ainsi qu'une autobiographie des défunts afin qu'on se souvienne d'eux. L'âme continuerait à exister paisiblement dans la vie suivante (après justification) tant que ces offrandes seraient faites.

Les prêtres, la famille et les invités s'asseyaient ensuite pour un festin célébrant la vie du défunt et son voyage vers le paradis. Cette célébration avait lieu à l'extérieur du tombeau, sous une tente dressée à cet effet. La nourriture, la bière et le vin auraient été apportés plus tôt et étaient désormais servis sous forme de banquet pique-nique élaboré. Le défunt serait honoré du genre de festival qu’il aurait connu et apprécié dans sa vie. Une fois la fête terminée, les invités rentraient chez eux et continuaient leur vie.
Mais pour l’âme du défunt, une nouvelle vie venait de commencer. Suite aux rituels mortuaires et à la fermeture du tombeau, on pensait que l'âme se réveillait dans le corps et se sentait désorientée. Des inscriptions sur le mur du tombeau, comme dans les Textes des Pyramides, ou dans le cercueil, comme dans le cas des Textes du Cercueil, rappelleraient à l'âme sa vie sur terre et lui ordonneraient de quitter le corps et d'avancer. Ces textes furent remplacés au Nouvel Empire d'Égypte par le Livre des Morts. L'un des dieux, le plus souvent Anubis, semblait conduire l'âme vers la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle des Deux Vérités) où elle serait jugée.
Les représentations du jugement montrent fréquemment une longue file d'âmes attendant leur moment pour comparaître devant Osiris et celles-ci sont soignées par des divinités comme Qebhet, qui leur a fourni de l'eau fraîche et rafraîchissante. Des déesses familières comme Nephthys, Isis, Neith et Serket seraient également là pour réconforter et encourager l'âme. Le moment venu, on avançait là où Osiris, Anubis et Thot se tenaient près de la balance de la justice et récitaient les confessions négatives, une liste rituelle de péchés dont on pouvait honnêtement dire qu'on n'avait pas commis. À ce stade, le cœur de chacun était pesé dans la balance contre la plume blanche de la vérité ; si le cœur était plus léger que la plume, on était justifié, et sinon, le cœur tombait au sol où il était mangé par le monstre Amut et l'âme cesserait alors d'exister.
 Si l'on avait été justifié par la pesée du cœur, Osiris, Thot et Anubis conféreraient avec les quarante-deux juges et permettraient ensuite à l'individu de passer vers le paradis. Cette suite du voyage prend différentes formes selon les différents textes et époques. Dans certaines versions, l'âme doit encore éviter les pièges, les démons et les dangers, et a besoin de l'aide d'un guide tel que Le Livre égyptien des morts. Dans d'autres représentations, une fois justifiée, on se rendait sur les rives du lac Lily où il fallait passer un test final.
Si l'on avait été justifié par la pesée du cœur, Osiris, Thot et Anubis conféreraient avec les quarante-deux juges et permettraient ensuite à l'individu de passer vers le paradis. Cette suite du voyage prend différentes formes selon les différents textes et époques. Dans certaines versions, l'âme doit encore éviter les pièges, les démons et les dangers, et a besoin de l'aide d'un guide tel que Le Livre égyptien des morts. Dans d'autres représentations, une fois justifiée, on se rendait sur les rives du lac Lily où il fallait passer un test final.
Le passeur était un homme éternellement désagréable nommé Hraf-hef, envers qui l'âme devait être bonne et gracieuse. Si l'on réussissait ce test final, on traversait le lac à la rame jusqu'au paradis dans le Champ des Roseaux. Ici, l'âme trouverait tout et chacun pensait être perdu à cause de la mort. Ceux qui étaient décédés auparavant attendraient ainsi que leurs animaux de compagnie préférés. La maison que l'âme avait aimée de son vivant, le quartier, les amis, tout l'attendrait et l'âme jouirait éternellement de cette vie sans menace de perte et en compagnie des dieux immortels. Ce paradis final n'était cependant possible que si la famille sur terre avait accompli complètement les rituels mortuaires et si elle continuait à honorer et à se souvenir de l'âme du défunt. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Enterrement égyptien antique. L'enterrement égyptien est le terme commun désignant les anciens rituels funéraires égyptiens concernant la mort et le voyage de l'âme vers l'au-delà. L'éternité, selon l'historien Bunson, « était la destination commune de chaque homme, femme et enfant en Égypte », mais pas « l'éternité » comme dans une vie après la mort au-dessus des nuages, mais plutôt une Égypte éternelle qui reflétait la vie de chacun sur terre. Pour les anciens Égyptiens, l’au-delà était le champ de roseaux, reflet parfait de la vie vécue sur terre. Les rites funéraires égyptiens étaient pratiqués dès 4000 avant JC et reflètent cette vision de l'éternité.
Le corps le plus ancien conservé d'une tombe est celui de ce qu'on appelle « Gingembre », découvert à Gebelein, en Égypte, et daté de 3400 avant JC. Les rites funéraires ont changé au fil du temps entre environ 4000 avant JC et 30 avant JC, mais l'accent constant était mis sur la vie éternelle et le certitude d'une existence personnelle au-delà de la mort. Cette croyance est devenue bien connue dans le monde antique grâce à la transmission culturelle à travers le commerce (notamment via la Route de la Soie) et a fini par influencer d’autres civilisations et religions. On pense qu’il a inspiré la vision chrétienne de la vie éternelle et qu’il a eu une influence majeure sur les pratiques funéraires dans d’autres cultures.
Selon Hérodote (484-425/413 avant JC), les rites égyptiens concernant l'enterrement étaient très dramatiques dans le deuil des morts, même si l'on espérait que le défunt trouverait le bonheur dans une terre éternelle au-delà de la tombe. Il écrit : « En ce qui concerne le deuil et les funérailles, lorsqu'un homme distingué meurt, toutes les femmes de la maison se plâtrent la tête et le visage avec de la boue, puis, laissant le corps à l'intérieur, parcourent la ville avec les parents du mort, leurs robes fermées avec une ceinture et frappèrent leurs seins nus. Les hommes eux aussi suivent le même procédé, portant une ceinture et se battant comme les femmes. La cérémonie terminée, ils emmènent le corps pour le momifier."
La momification était pratiquée en Égypte dès 3 500 avant JC et aurait été suggérée par la préservation des cadavres enterrés dans le sable aride. Le concept égyptien de l’âme – qui s’est peut-être développé assez tôt – dictait qu’il fallait un corps préservé sur terre pour que l’âme puisse espérer une vie éternelle. On pensait que l'âme était composée de neuf parties distinctes : le Khat était le corps physique ; la double forme du Ka un ; le Ba, un aspect d'oiseau à tête humaine qui pouvait se déplacer entre la terre et le ciel ; Shuyet était le moi de l'ombre ; Akh le moi immortel et transformé, les aspects Sahu et Sechem de l'Akh ; Ab était le cœur, la source du bien et du mal ; Ren était son nom secret. Le Khat devait exister pour que le Ka et le Ba se reconnaissent et le corps devait donc être préservé aussi intact que possible.
Après le décès d'une personne, la famille apportait le corps du défunt chez les embaumeurs où les professionnels « produisaient des modèles spécimens en bois, classés en qualité. Ils demandent lequel des trois est requis, et la famille du défunt, après s'être mise d'accord sur un prix, laisse les embaumeurs à leur tâche ». Il y avait trois niveaux de qualité et de prix correspondant dans les enterrements égyptiens et les embaumeurs professionnels offraient les trois choix aux personnes endeuillées. Selon Hérodote : « On dit que le type le meilleur et le plus cher représente [Osiris], le meilleur suivant est quelque peu inférieur et moins cher, tandis que le troisième est le moins cher de tous ».
Ces trois choix d'inhumation dictaient le type de cercueil dans lequel on serait enterré, les rites funéraires disponibles et, également, le traitement du corps. Selon l'historien Ikram, « L'ingrédient clé de la momification était le natron, ou netjry, le sel divin. Il s'agit d'un mélange de bicarbonate de sodium, de carbonate de sodium, de sulfate de sodium et de chlorure de sodium, présent naturellement en Égypte, le plus souvent dans le Wadi Natrun, à environ soixante-quatre kilomètres au nord-ouest du Caire. Il possède des propriétés desséchantes et dégraissantes et était le dessicant préféré, bien que le sel commun ait également été utilisé dans des enterrements plus économiques.
Le corps du défunt, dans le type d'enterrement le plus coûteux, était disposé sur une table et le cerveau était retiré par les narines avec un crochet en fer, et ce qui ne pouvait pas être atteint avec le crochet était lavé avec des médicaments ; Ensuite, le flanc est ouvert avec un couteau en silex et tout le contenu de l'abdomen est retiré ; la cavité est ensuite soigneusement nettoyée et lavée, d'abord avec du vin de palme, puis à nouveau avec une infusion d'épices moulues. Après cela, il est rempli de myrrhe pure, de cassia et de toute autre substance aromatique, à l'exception de l'encens, et recousu, après quoi le corps est placé dans le natron, entièrement recouvert pendant soixante-dix jours – jamais plus. Cette période passée, le corps est lavé puis enveloppé de la tête aux pieds dans du lin coupé en bandes et enduit sur le dessous de gomme, qui est couramment utilisée par les Égyptiens à la place de la colle. Dans cet état, le corps est rendu à la famille qui fait fabriquer une caisse en bois, en forme de figure humaine, dans laquelle il est placé.
Le deuxième enterrement le plus cher différait du premier dans la mesure où moins de soins ont été donnés au corps. Aucune incision n'est faite et les intestins ne sont pas enlevés, mais de l'huile de cèdre est injectée avec une seringue dans le corps par l'anus qui est ensuite bouché pour empêcher le liquide de s'échapper. Le corps est ensuite guéri au natron pendant le nombre de jours prescrit, au cours duquel l'huile est évacuée. L'effet est si puissant qu'en quittant le corps, il entraîne avec lui les viscères à l'état liquide et, comme la chair a été dissoute par le natron, il ne reste plus rien du corps à part la peau et les os. Après ce traitement, il est restitué à la famille sans autre attention.
La troisième méthode d'embaumement, et la moins chère, consistait « simplement à laver les intestins et à garder le corps pendant soixante-dix jours dans du natron ». Les organes internes ont été retirés afin d'aider à préserver le cadavre, mais parce que l'on pensait que le défunt en aurait encore besoin. eux, les viscères étaient placés dans des canopes pour être scellés dans le tombeau. Seul le cœur était laissé à l’intérieur du corps car on pensait qu’il contenait l’aspect Ab de l’âme. Même les Égyptiens les plus pauvres étaient soumis à une sorte de cérémonie, car on pensait que si le défunt n'était pas enterré correctement, l'âme reviendrait sous la forme d'un fantôme pour hanter les vivants. Comme la momification pouvait coûter très cher, les pauvres donnaient leurs vêtements usagés aux embaumeurs pour qu'ils les utilisent pour envelopper le cadavre.
D’où l’expression « Le linge d’hier » faisant allusion à la mort. « Les pauvres ne pouvaient pas se permettre de nouveaux draps et enveloppaient donc leurs cadavres bien-aimés dans ceux d'hier ». Avec le temps, l'expression a été appliquée à toute personne décédée et employée par les Cerfs-volants de Nephthys (les pleureuses professionnelles lors des funérailles). « Le défunt est traité par ces personnes en deuil comme quelqu'un qui s'habillait de fin lin mais qui dort désormais dans le « linge d'hier ». Cette image faisait allusion au fait que la vie sur terre était devenue « hier » pour les morts » (Bunson, 146). Les bandages en lin étaient également connus sous le nom de Tresses de Nephthys, après que cette déesse, la sœur jumelle d'Isis, fut associée à la mort et à l'au-delà. Les pauvres étaient enterrés dans des tombes simples avec les objets dont ils avaient profité dans la vie ou tout autre objet dont la famille pouvait se permettre de se séparer.
Chaque tombe contenait une sorte de provision pour l’au-delà. Les tombes en Égypte étaient à l'origine de simples tombes creusées dans la terre, qui se sont ensuite développées en mastabas rectangulaires, des tombes plus ornées construites en briques crues. Les mastabas ont finalement évolué en forme pour devenir des structures connues sous le nom de « pyramides à degrés » et celles-ci sont ensuite devenues de « véritables pyramides ». Ces tombes sont devenues de plus en plus importantes à mesure que la civilisation égyptienne progressait, dans la mesure où elles seraient le lieu de repos éternel du Khat et que sa forme physique devait être protégée des pilleurs de tombes et des éléments. Le cercueil, ou sarcophage, était également construit en toute sécurité dans un but de protection à la fois symbolique et pratique du cadavre. La ligne de hiéroglyphes qui descend verticalement à l'arrière d'un sarcophage représente l'épine dorsale du défunt et était censée donner à la momie la force de se lever pour manger et boire.
Bien entendu, l'approvisionnement de la tombe dépendait de la richesse personnelle de chacun et, parmi les artefacts inclus, il y avait des poupées Shabti. Dans la vie, les Égyptiens étaient appelés à consacrer chaque année une certaine partie de leur temps à des projets de construction publique. Si l'on était malade ou si l'on n'avait pas les moyens d'y consacrer du temps, on pouvait envoyer un travailleur de remplacement. On ne pouvait le faire qu'une fois par an, sous peine d'être puni pour manquement au devoir civique. Dans la mort, pensait-on, les gens devraient encore accomplir ce même type de service (puisque l'au-delà était simplement une continuation de la vie terrestre) et c'est pourquoi les poupées Shabti étaient placées dans la tombe pour servir de travailleur de remplacement lorsque les personnes y faisaient appel. le dieu Osiris pour le service. Plus il y a de poupées Shabti trouvées dans une tombe, plus celle qui y est enterrée est riche. Comme sur terre, chaque Shabti ne pouvait être utilisé qu'une seule fois en remplacement et il fallait donc désirer plus de poupées que moins et cette demande a créé une industrie dédiée à leur création.
Une fois le cadavre momifié et la tombe préparée, les funérailles ont eu lieu au cours desquelles la vie du défunt a été honorée et la perte a été pleurée. Même si le défunt avait été populaire et que les personnes en deuil ne manquaient pas, le cortège funèbre et l'enterrement étaient accompagnés de cerfs-volants de Nephthys (toujours des femmes) qui étaient payés pour se lamenter bruyamment tout au long de la cérémonie. Ils ont chanté La Lamentation d'Isis et Nephthys, qui tire son origine du mythe des deux sœurs pleurant la mort d'Osiris, et était censé inspirer aux autres personnes lors des funérailles une démonstration d'émotion. Comme dans d'autres cultures anciennes, le souvenir des morts garantissait leur existence continue dans l'au-delà et on pensait qu'une grande manifestation de chagrin lors d'un enterrement avait des échos dans la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle d'Osiris) où l'âme du le parti se dirigeait.
À partir de la période de l’Ancien Empire, la cérémonie d’ouverture de la bouche était célébrée soit avant le cortège funèbre, soit juste avant la mise au tombeau de la momie. Cette cérémonie souligne une fois de plus l'importance du corps physique dans la mesure où elle était menée afin de réanimer le cadavre pour une utilisation continue par l'âme. Un prêtre récitait des sorts en utilisant une lame de cérémonie pour toucher la bouche du cadavre (afin qu'il puisse à nouveau respirer, manger et boire) ainsi que les bras et les jambes pour qu'il puisse se déplacer dans la tombe. Une fois le corps enterré et le tombeau scellé, d'autres sorts et prières, tels que Les Litanies d'Osiris (ou, dans le cas d'un pharaon, les sorts connus sous le nom de Textes des Pyramides) étaient récités et le défunt était ensuite laissé à l'abandon. commencer le voyage vers l’au-delà. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: La mort dans l'Egypte ancienne. Pour les anciens Égyptiens, la mort n’était pas la fin de la vie mais seulement une transition vers un autre plan de réalité. Une fois que l'âme avait passé avec succès le jugement du dieu Osiris, elle se dirigeait vers un paradis éternel, le Champ des Roseaux, où tout ce qui avait été perdu à la mort était restitué et où l'on vivrait vraiment heureux pour toujours. Même si la vision égyptienne de l’au-delà était la plus réconfortante de toutes les civilisations anciennes, les gens craignaient toujours la mort. Même dans les périodes de gouvernement central fort, lorsque le roi et les prêtres détenaient le pouvoir absolu et que leur vision du paradis après la mort était largement acceptée, les gens avaient toujours peur de mourir.
Les rituels concernant le deuil des morts n'ont jamais radicalement changé dans toute l'histoire de l'Égypte et sont très similaires à la façon dont les gens react à la mort aujourd'hui. On pourrait penser que savoir que l’être cher était en voyage vers le bonheur éternel ou qu’il vivait au paradis aurait permis aux anciens Égyptiens de se sentir plus en paix avec la mort, mais ce n’est clairement pas le cas. Les inscriptions pleurant la mort d'une épouse, d'un mari ou d'un enfant bien-aimé - ou d'un animal de compagnie - expriment toutes le chagrin de la perte, combien celui qui est décédé leur manque, comment ils espèrent le revoir un jour au paradis - mais n'expriment pas le souhait de mourir. et rejoignez-les bientôt. Il existe des textes qui expriment le désir de mourir, mais il s'agit de mettre fin aux souffrances de la vie présente et non d'échanger son existence mortelle contre l'espoir du paradis éternel.
Le sentiment dominant parmi les anciens Égyptiens est en fait parfaitement résumé par Hamlet dans la célèbre pièce de Shakespeare : « Le pays inconnu, d'où est né / Aucun voyageur ne revient, intrigue la volonté / Et nous fait plutôt supporter les maux que nous avons / Que voler vers d'autres que nous ignorons". Les Égyptiens aimaient la vie, la célébraient tout au long de l’année et n’étaient pas pressés de la quitter, même pour le genre de paradis promis par leur religion. Une œuvre littéraire célèbre sur ce sujet est connue sous le titre Discours entre un homme et son Ba (également traduit par Discours entre un homme et son âme et L'homme qui était las de la vie). Cette œuvre, datée de l'Empire du Milieu égyptien (2040-1782 av. J.-C.), est un dialogue entre un homme déprimé qui ne trouve aucune joie dans la vie et son âme qui l'encourage à essayer de s'amuser et de prendre les choses plus facilement. L'homme, à plusieurs reprises, se plaint du fait qu'il devrait simplement abandonner et mourir - mais à aucun moment il ne semble penser qu'il trouvera une existence meilleure de « l'autre côté » - il veut simplement mettre fin à la misère qu'il est. sentiment en ce moment.
Le dialogue est souvent qualifié de premier ouvrage écrit débattant des bienfaits du suicide, mais l'érudit William Kelly Simpson n'est pas d'accord, écrivant : « Ce qui est présenté dans ce texte n'est pas un débat mais une image psychologique d'un homme déprimé par le mal de la vie. au point de se sentir incapable d’accepter la bonté innée de l’existence. Son moi intérieur est pour ainsi dire incapable de s’intégrer et de se sentir en paix. Son dilemme est présenté dans ce qui semble être un monologue dramatique qui illustre ses brusques changements d'humeur, son hésitation entre l'espoir et le désespoir et un effort presque héroïque pour trouver la force de faire face à la vie. Ce n’est pas tant la vie elle-même qui fatigue celui qui parle, mais plutôt ses propres efforts pour parvenir à un moyen de faire face aux difficultés de la vie. »
Alors que l’orateur s’efforce de parvenir à une conclusion satisfaisante, son âme tente de le guider dans la bonne direction, en rendant grâce pour sa vie et en acceptant les bonnes choses que le monde a à offrir. Son âme l'encourage à exprimer sa gratitude pour les bonnes choses qu'il a dans cette vie et à arrêter de penser à la mort car aucun bien ne peut en résulter. Pour les anciens Égyptiens, l'ingratitude était le « péché d'entrée » qui permettait à tous les autres péchés d'entrer dans la vie. Pour les anciens Égyptiens, l'ingratitude était le « péché d'entrée » qui permettait à tous les autres péchés d'entrer dans la vie. Si l’on était reconnaissant, alors on appréciait tout ce qu’on avait et on rendait grâce aux dieux ; si l'on se permettait de se sentir ingrat, alors cela nous entraînait dans une spirale vers tous les autres péchés d'amertume, de dépression, d'égoïsme, d'orgueil et de pensée négative.
Le message de l'âme à l'homme est similaire à celui de l'orateur du livre biblique de l'Ecclésiaste lorsqu'il dit : « Dieu est au ciel et toi sur la terre ; que tes paroles soient donc peu nombreuses ». L'homme, après avoir souhaité que la mort l'emporte, semble considérer sérieusement les paroles de l'âme. Vers la fin de la pièce, l'homme dit : "Celui qui est là-bas sera sûrement un dieu vivant/Ayant purgé le mal qui l'avait affligé... Celui qui est là-bas sera sûrement celui qui connaît toutes choses". L’âme a le dernier mot dans la pièce, assurant à l’homme que la mort viendra naturellement avec le temps et que la vie doit être embrassée et aimée dans le présent.
Un autre texte de l’Empire du Milieu, Le Lai du Harpiste, résonne également sur le même thème. L’Empire du Milieu est la période de l’histoire égyptienne où la vision d’un paradis éternel après la mort a été le plus sérieusement remise en question dans les œuvres littéraires. Bien que certains aient avancé que cela était dû à un cynisme persistant suite au chaos et à la confusion culturelle de la Première Période Intermédiaire, cette affirmation est intenable. La Première Période Intermédiaire de l’Égypte (2181-2040 avant JC) était simplement une époque dépourvue d’un gouvernement central fort, mais cela ne signifie pas que la civilisation s’est effondrée avec la désintégration de l’Ancien Empire, mais simplement que le pays a connu les changements naturels de gouvernement et de société. qui font partie de toute civilisation vivante.
Le Lai du Harpiste est encore plus comparable à celui de l'Ecclésiaste dans le ton et l'expression, comme le montre clairement le refrain : « Profitez de moments agréables/Et ne vous en lassez pas/Voici, il n'est donné à aucun homme d'emporter ses affaires avec lui/ Voici, il n’y a aucun défunt qui revienne » (Simpson, 333). L'affirmation selon laquelle on ne peut pas emporter ses biens avec la mort est une réfutation directe de la tradition selon laquelle les morts sont enterrés avec des objets funéraires : tous ces objets dont on a profité et utilisé dans la vie et qui seraient nécessaires dans l'autre monde.
Il est tout à fait possible, bien sûr, que ces points de vue soient simplement des procédés littéraires visant à faire valoir qu’il faut tirer le meilleur parti de la vie au lieu d’espérer un bonheur éternel au-delà de la mort. Néanmoins, le fait que ces sentiments ne trouvent ce type d’expression que dans l’Empire du Milieu suggère un changement important d’orientation culturelle. La cause la plus probable en est une classe supérieure plus « cosmopolite » au cours de cette période, rendue possible précisément par la Première Période Intermédiaire, que les études des XIXe et XXe siècles de notre ère ont tant fait pour vilipender. L’effondrement de l’Ancien Empire égyptien a donné davantage de pouvoir aux gouverneurs régionaux et a conduit à une plus grande liberté d’expression dans différentes régions du pays au lieu de se conformer à une vision unique du roi.
Le cynisme et la vision lassée du monde de la religion et de l'au-delà disparaissent après cette période et la littérature du Nouvel Empire (vers 1570-1069 av. J.-C.) se concentre à nouveau sur un paradis éternel qui attend au-delà de la mort. La popularité du Livre de la sortie de jour (mieux connu sous le nom de Livre égyptien des morts) au cours de cette période est l'une des meilleures preuves de cette croyance. Le Livre des Morts est un manuel d'instructions pour l'âme après la mort, un guide vers l'au-delà, dont une âme aurait besoin pour atteindre le Champ des Roseaux.
La réputation qu’a acquise l’Égypte ancienne d’être « obsédée par la mort » est en réalité imméritée ; la culture était obsédée par l’idée de vivre pleinement la vie. Les rituels mortuaires si soigneusement observés n'avaient pas pour but de glorifier la mort mais de célébrer la vie et d'assurer sa pérennité. Les morts étaient enterrés avec leurs biens dans des tombes magnifiques et selon des rituels élaborés, car l'âme vivrait éternellement une fois qu'elle aurait franchi les portes de la mort. Pendant que l'on vivait, on était censé profiter au maximum de son temps et s'amuser autant que l'on pouvait. Une chanson d'amour du Nouvel Empire égyptien, l'une des soi-disant chansons du verger, exprime parfaitement la vision égyptienne de la vie.
Dans les lignes qui suivent, un sycomore du verger s'adresse à l'une des jeunes femmes qui l'ont planté lorsqu'elle était petite : « Faites attention ! Faites-les venir avec leur équipement ; Apporter toutes sortes de bières, toutes sortes de pains en abondance ; Les légumes, boisson forte d'hier et d'aujourd'hui ; Et toutes sortes de fruits pour le plaisir ; Venez passer la journée dans le bonheur ; Demain et après-demain ; Même pendant trois jours, assis à mon ombre. »
Bien que l'on trouve des expressions de ressentiment et de malheur dans la vie - comme dans le Discours entre un homme et son âme - les Égyptiens, pour la plupart, aimaient la vie et l'embrassaient pleinement. Ils n’attendaient pas avec impatience la mort – même si on leur promettait l’au-delà le plus idéal – parce qu’ils avaient le sentiment de vivre déjà dans le monde le plus parfait. Une vie éternelle ne valait la peine d’être imaginée qu’en raison de la joie que les gens trouvaient dans leur existence terrestre. Les anciens Égyptiens cultivaient une civilisation qui élevait chaque jour une expérience de gratitude et de transcendance divine et une vie dans un voyage éternel dont le temps passé dans le corps n'était qu'un bref intermède. Loin d'attendre ou d'espérer la mort, les Égyptiens ont pleinement embrassé le temps qu'ils ont connu sur terre et ont pleuré le décès de ceux qui ne participaient plus à la grande fête de la vie. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: L'au-delà égyptien - Le champ des roseaux. Les anciens Égyptiens croyaient que la vie sur terre n’était qu’une partie d’un voyage éternel qui se terminait non pas par la mort, mais par une joie éternelle. L'une est née sur Terre par la bienveillance des dieux et des divinités connues sous le nom de sept hathores a alors décrété son sort après la naissance; L'âme a ensuite vécu une vie aussi bonne que possible dans le corps qu'elle avait été donnée pendant un certain temps. Lorsque la mort survenait, ce n'était qu'une transition vers un autre royaume où, si l'on était justifié par les dieux, on vivrait éternellement dans un paradis connu sous le nom de Champ des Roseaux. Le champ de roseaux (parfois appelé champ d'offrandes), connu des Égyptiens sous le nom d'A'aru, était une image miroir de la vie d'une personne sur terre. Le but de chaque Égyptien ancien était de faire en sorte que cette vie vaille la peine d’être vécue éternellement et, autant que les archives l’indiquent, ils ont fait de leur mieux pour y parvenir.
L’Égypte est synonyme de tombes et de momies depuis la fin du XVIIIe, du XIXe et du début du XXe siècle après JC, lorsque les explorateurs, archéologues, entrepreneurs, forains et escrocs occidentaux ont commencé à enquêter et à exploiter cette culture. Le premier film sensationnaliste sur les momies, Le Tombeau de Cléopâtre, a été produit en 1899 après JC par George Melies. Le film est maintenant perdu mais aurait raconté l'histoire de la momie de Cléopâtre qui a été découverte, découpée en morceaux, puis ressuscitée pour faire des ravages parmi les vivants. 1911 après JC a vu la sortie de "La Momie" par Thanhouser Company dans lequel la momie d'une princesse égyptienne est réanimée grâce à des charges de courant électrique et, à la fin, le scientifique qui la ramène à la vie l'épouse.
La découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 après JC a fait l'actualité mondiale et l'histoire de la malédiction du roi Toutankhamon qui a suivi a fasciné les gens autant que les photos de l'immense trésor extraites de la tombe. L’Égypte est devenue associée à la mort dans l’imaginaire populaire et des films ultérieurs tels que La Momie (1932) ont capitalisé sur cet intérêt. Dans le film de 1932, Boris Karloff incarne Imhotep, un ancien prêtre enterré vivant, ainsi qu'Imhotep ressuscité qui s'appelle Ardath Bey. Bey tente d'assassiner la belle Helen Grosvenor (jouée par Zita Johann) qui est la réincarnation du grand amour d'Imhotep, Ankesenamun. En fin de compte, les plans de Bey visant à assassiner, momifier, puis ressusciter Helen alors que son incarnation passée de la princesse égyptienne sont contrecarrés et Bey est réduit en poussière.
L'immense succès de ce film au box-office garantissait des suites produites tout au long des années 1940 (La Main de la Momie, Le Tombeau de la Momie, Le Fantôme de la Momie et La Malédiction de la Momie, 1940-1944) usurpées dans les années 1950 (Abbot et Costello rencontrent la Momie, 1955). ), se poursuivit dans les années 1960 (La Malédiction du Tombeau de la Momie en 1964 et Le Linceul de la Momie en 1967), et jusqu'en 1971, Blood From the Mummy's Tomb. Le genre de l'horreur des momies a été relancé avec le remake de La Momie en 1999 qui a été tout aussi populaire que le film de 1932, inspirant la suite Le Retour de la Momie en 2001 et les films sur le Roi Scorpion (2002-2012) qui ont été tout aussi bien accueillis. La récente parution Gods of Egypt (2015) déplace l'attention des momies et des rois vers les dieux égyptiens et l'au-delà, mais promeut toujours l'association de l'Égypte avec la mort et les ténèbres à travers son intrigue excessivement violente et sa représentation du monde souterrain comme la demeure des démons.
Les momies, les malédictions, les dieux mystiques et les rites sont un élément essentiel des représentations populaires de la culture égyptienne dans les livres et les films depuis près de 200 ans maintenant, tous promouvant le « fait » apparemment évident que les anciens Égyptiens étaient obsédés par la mort. Cette compréhension est alimentée par les travaux des premiers écrivains sur l'Égypte ancienne qui ont interprété à tort la vision égyptienne de la vie éternelle comme étant une obsession pour la fin de son séjour sur terre. Même au 20ème siècle après JC, alors que les érudits avaient une meilleure compréhension de la culture égyptienne, l'historienne réputée Edith Hamilton , généralement assez fiable, écrivait en 1930 après JC : « En Égypte, le centre d'intérêt était les morts... D'innombrables êtres humains Pendant d'innombrables siècles, les êtres ont considéré la mort comme ce qui leur était le plus proche et le plus familier. [Les Égyptiens étaient] des gens misérables, des gens qui travaillent dur, [qui] ne jouent pas. Rien de tel que les jeux grecs n’est concevable en Egypte. Si le plaisir et le sport avaient joué un rôle réel dans la vie des Égyptiens, ils figureraient sous une forme ou une autre dans les archives archéologiques. Mais les Egyptiens n'ont pas joué. »
En fait, il existe de nombreuses preuves que les Égyptiens ont beaucoup joué. Sports qui étaient régulièrement pratiqués dans l'Egypte ancienne comprennent le hockey, le handball, le tir à l'arc, la natation, le tir à la corde, la gymnastique, l'aviron et un sport connu sous le nom de « joute nautique » qui était une bataille navale jouée dans de petits bateaux sur le Nil dans laquelle un « Le jouteur a tenté de faire tomber l'autre jouteur de son bateau pendant qu'un deuxième membre de l'équipe manœuvrait l'engin. Les enfants apprenaient à nager dès leur plus jeune âge et la natation faisait partie des sports les plus populaires qui donnaient naissance à d'autres jeux aquatiques. Le jeu de société Senet était extrêmement populaire, représentant le voyage de la vie vers l'éternité. La musique, la danse et la gymnastique soigneusement chorégraphiée faisaient partie des grandes fêtes et l'un des principaux concepts appréciés par les Égyptiens était la gratitude pour la vie qui leur avait été donnée et tout ce qu'elle contenait.
Les dieux étaient considérés comme des amis proches et des bienfaiteurs qui donnaient un sens à chaque jour. Hathor était toujours à portée de main en tant que Dame du Sycomore, une déesse des arbres, qui fournissait ombre et confort mais présidait en même temps au Nil céleste, à la Milky Way en tant que force cosmique et, en tant que Dame de la Nécropole, a ouvert la porte à l'âme du défunt vers l'au-delà. Elle était également présente à chaque festival, mariage et funérailles en tant que Dame de l'Ivresse qui encourageait les gens à alléger leur cœur en buvant de la bière.
Les autres dieux et déesses d’Égypte sont également décrits comme étant intimement concernés par la vie et le bien-être des êtres humains. Au cours du voyage terrestre, ils pourvoyaient aux vivants tous leurs besoins et, après la mort, ils semblaient réconforter et guider l'âme. Des déesses comme Selket, Nephthys et Qebhet guidaient et protégeaient les âmes nouvellement arrivées dans l'au-delà ; Qebhet leur apporta même de l’eau fraîche et rafraîchissante. Anubis, Thot et Osiris les ont traduits en jugement et les ont récompensés ou punis. L’image populaire des Égyptiens obsédés par la mort ne pourrait être plus fausse ; Au contraire, les anciens Égyptiens étaient obsédés par la vie et la vivaient abondamment. L'érudit James F. Romano note : « En examinant les preuves qui subsistent de l'Antiquité, nous avons l'impression générale que la plupart des Égyptiens aimaient la vie et étaient prêts à ignorer ses difficultés. En effet, l’au-delà parfait n’était qu’une version idéale de leur existence terrestre. Seuls les tracas et les petits ennuis qui les ont dérangés au cours de leur vie manqueraient dans l'au-delà ; tout le reste, espéraient-ils, serait comme sur terre.
L’au-delà égyptien était le reflet de la vie sur terre. Pour les Égyptiens, leur pays était le monde le plus béni et le plus parfait. Dans la littérature grecque antique, on trouve les célèbres récits de l'Iliade et de l'Odyssée, qui décrivent de grandes batailles dans un pays étranger et des aventures au cours du voyage de retour ; mais de telles œuvres n'existent pas dans la littérature égyptienne parce qu'ils n'étaient pas très intéressés à quitter leur foyer ou leur terre. L'œuvre égyptienne Le Conte du marin naufragé ne peut être comparée aux œuvres d'Homère car les personnages n'ont rien en commun et les thèmes sont complètement différents. Le marin n'avait aucune envie d'aventure ou de gloire, il ne faisait que vaquer aux affaires de son maître et, contrairement à Ulysse, le marin n'est pas du tout tenté par l'île magique avec toutes les bonnes choses qu'elle contient car il sait que les seules choses qu'il veut sont de retour chez moi en Egypte.
L’au-delà égyptien était le reflet de la vie sur terre. Pour les Égyptiens, leur pays était le monde le plus béni et le plus parfait. Les fêtes égyptiennes encourageaient à vivre pleinement la vie et à apprécier les moments passés en famille et entre amis. La maison, aussi modeste soit-elle, était profondément appréciée, tout comme les membres de la famille et de la communauté dans son ensemble. Les Égyptiens aimaient autant les animaux de compagnie qu’aujourd’hui et étaient conservés dans des œuvres d’art, des inscriptions et des écrits, souvent par leur nom. Étant donné que la vie dans l’Égypte ancienne était si appréciée, il est logique qu’ils aient imaginé une vie après la mort qui la reflétait fidèlement.
La mort n’était qu’une transition, pas un achèvement, et ouvrait la voie à la possibilité du bonheur éternel. Lorsqu'une personne mourait, on pensait que l'âme était piégée dans le corps parce qu'elle était habituée à cette demeure mortelle. Des sorts et des images peintes sur les murs des tombes (connus sous le nom de textes de cercueil, de textes de pyramide et de livre égyptien des morts) et des amulettes attachées au corps étaient fournis pour rappeler à l'âme son voyage continu, pour la calmer et la diriger vers quittez le corps et continuez. L'âme se dirigeait vers la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle des Deux Vérités) en compagnie d'Anubis, le guide des morts, où elle faisait la queue avec d'autres pour le jugement d'Osiris. Il existe différentes versions de ce qui se passerait ensuite, mais, dans l'histoire la plus populaire, l'âme ferait des confessions négatives devant Osiris, Thot, Anubis et les quarante-deux juges.
Les confessions négatives sont une liste de 42 péchés contre soi-même, contre les autres ou contre les dieux dans lesquels on pourrait honnêtement dire qu'on ne s'était jamais engagé. L'historienne Margaret Bunson note comment « les confessions devaient être récitées pour établir la vertu morale du défunt et son droit au bonheur éternel » (187). Les Confessions incluraient des déclarations telles que : « Je n'ai pas volé, je n'ai pas volé la propriété d'un dieu, je n'ai pas dit de mensonges, je n'ai fait pleurer personne, je n'ai pas bavardé, je n'ai donné faim à personne. » et plein d'autres. Il peut sembler exceptionnellement dur de s'attendre à ce qu'une âme traverse la vie et ne « fasse jamais pleurer personne », mais on pense que des phrases comme celle-ci ou « Je n'ai mis personne en colère » sont censées être comprises avec réserve ; comme dans "Je n'ai fait pleurer personne injustement" ou "Je n'ai mis personne en colère sans raison".
Après les confessions négatives, Osiris, Thot, Anubis et les quarante-deux juges se concertaient. Si la confession d'une personne était jugée acceptable, alors l'âme présenterait son cœur à Osiris pour qu'il soit pesé dans la balance d'or contre la plume blanche de la vérité. Si le cœur était plus léger que la plume, on passait à la phase suivante mais, si le cœur était plus lourd, il était jeté au sol où il était mangé par Ammut « la dévoreuse des morts ». Cela a abouti à « la Grande Mort » qui était la non-existence. Il n’y avait pas « d’enfer » dans l’au-delà égyptien ; la non-existence était un sort bien pire que n’importe quelle damnation éternelle.
Si l'âme passait par la Pesée du Cœur, elle se dirigeait vers un chemin qui menait au Lac Lily (également connu sous le nom de Lac des Fleurs). Il existe, encore une fois, un certain nombre de versions de ce qui pourrait arriver sur ce chemin où, dans certains cas, on trouve des dangers à éviter et des dieux pour aider et guider tandis que, dans d'autres, il s'agit d'une marche facile sur le genre de chemin que l'on suivrait. que j'ai connu chez moi. Au bord du lac Lily, l'âme rencontrait le divin passeur, Hraf-hef (Celui-qui-regarde-derrière-lui), qui était perpétuellement désagréable. L'âme devrait trouver un moyen d'être courtoise envers Hraf-hef, quelles que soient les remarques méchantes ou cruelles qu'il ferait, et se montrer digne de continuer le voyage.
Si l'âme passait par la pesée du cœur, elle se dirigeait vers un chemin qui menait au lac Lily. Après avoir réussi ce test, l'âme fut amenée à travers les eaux jusqu'au Champ des Roseaux. Ici, on retrouverait les êtres chers décédés auparavant, ses chiens ou chats préférés, ses gazelles ou ses singes, ou tout autre animal de compagnie que l'on avait perdu. Sa maison serait là, jusqu'à la pelouse telle qu'elle avait été laissée, son arbre préféré, même le ruisseau qui coulait derrière la maison. Ici, on pouvait profiter d'une éternité de la vie qu'on avait laissée sur terre en présence de ses personnes, animaux et biens les plus aimés ; et tout cela en présence immédiate des dieux.
Le sort 110 du Livre égyptien des morts doit être prononcé par le défunt pour revendiquer le droit d'entrer dans ce paradis. La « Dame de l'Air » référencée est très probablement Ma'at mais pourrait être Hathor : « J'acquiers ce domaine que tu aimes, ô Dame de l'Air. J'y mange et je fais la fête, j'y bois et laboure, j'y récolte, j'y copule, j'y fais l'amour, je n'y péris pas, car ma magie y est puissante. " Versions de ce point de vue a changé au fil du temps avec certains détails ajoutés et d'autres omis, mais la vision quasi constante était celle d'une vie après la mort qui reflétait directement la vie que l'on avait connue sur terre.
Bunson explique : « L'éternité elle-même n'était pas un concept vague. Les Égyptiens, pragmatiques et déterminés à ce que tout soit expliqué en termes concrets, croyaient vivre au paradis dans des zones ornées de lacs et de jardins. Là, ils mangeaient les « gâteaux d'Osiris » et flottaient sur le Lac des Fleurs. Les royaumes éternels variaient selon les époques et les croyances cultuelles, mais tous étaient situés au bord de l'eau qui coule et bénéficiant de brises, un attribut jugé nécessaire au confort. Le jardin d'A'aru était l'une de ces oasis de bonheur éternel. Une autre était Ma'ati, une terre éternelle où le défunt enterrait une flamme de feu et un sceptre de cristal - des rituels dont le sens est perdu. La déesse Ma'at, personnification de l'ordre cosmique, de la justice, de la bonté et de la foi, était la protectrice des défunts dans ce royaume enchanté, appelé Hehtt à certaines époques. Seuls les cœurs purs, les uabt, pouvaient voir Maât.
La note de Bunson sur la façon dont la vision de l'au-delà a changé en fonction du temps et des croyances se reflète dans certaines visions de l'au-delà qui nient sa permanence et sa beauté. Ces interprétations n'appartiennent pas à une période particulière mais semblent surgir périodiquement tout au long de l'histoire ultérieure de l'Égypte. Ils sont particulièrement importants, cependant, dans la période de l’Empire du Milieu (2040-1782 av. J.-C.), exprimés dans des textes connus sous le nom de Le Lai du Harpiste (ou Chants du Harpiste) et La Dispute entre un homme et son Ba (âme). Le Lai du Harpiste est ainsi appelé parce que les inscriptions incluent toujours l'image d'un harpiste. Il s'agit d'un recueil de chansons qui réfléchissent sur la mort et le sens de la vie. Dispute Between a Man and his Ba provient de la collection de textes connus sous le nom de littérature de sagesse qui sont souvent sceptiques quant à l'au-delà.
Certains des textes qui composent The Lay of the Harper affirment clairement la vie après la mort tandis que d'autres la remettent en question et certains la nient complètement. Un exemple datant d'environ 2000 avant JC de la stèle d'Intef dit, en partie, « cœurs au repos/N'entendez pas le cri des personnes en deuil au tombeau/Qui n'ont aucune signification pour les morts silencieux ». Dans Dispute entre un homme et son Ba, l'homme se plaint à son âme que la vie est misère mais il craint la mort et ce qui l'attend de l'autre côté. Dans ces versions, l'au-delà est présenté soit comme un mythe auquel les gens s'accrochent, soit comme tout aussi incertain et ténu que la vie d'une personne. L'érudite Geraldine Pinch commente : « L'âme pouvait expérimenter la vie dans le Champ des Roseaux, un paradis semblable à l'Égypte, mais ce n'était pas un état permanent. Lorsque le soleil nocturne disparut, les ténèbres et la mort revinrent. Les esprits des étoiles étaient détruits à l'aube et renaissaient chaque nuit. Même les morts maléfiques, les Ennemis de Ra, revenaient continuellement à la vie comme Apophis afin qu'ils puissent être torturés et tués à nouveau.
Dans une autre version encore, les morts justifiés servaient de Ra comme équipage de sa barge solaire alors qu'elle traversait le ciel nocturne et aidait à défendre le dieu solaire du serpent Apophis. Dans cette version, les âmes justes sont les collaborateurs des dieux de l’au-delà qui aident à faire lever à nouveau le soleil pour ceux qui sont encore sur terre. Leurs amis et parents encore en vie saluaient le lever du soleil avec gratitude pour leurs efforts et pensaient à eux chaque matin. Comme dans toutes les cultures anciennes, le souvenir des morts était une valeur culturelle importante pour les Égyptiens et cette version de l’au-delà le reflète. Même dans les versions où l'âme arrive au paradis, elle pourrait encore être invoquée par l'homme, le Bateau des Millions, la barge solaire, pour aider les dieux à protéger la lumière des forces des ténèbres.
Cependant, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'Égypte, une certaine version du paradis du Champ des Roseaux, atteint après le jugement d'un dieu puissant, a prévalu. Une peinture murale de la tombe de l'artisan Sennedjem de la 19e dynastie (1292-1186 av. J.-C.) représente le voyage de l'âme de la vie terrestre au bonheur éternel. Sennedjem est vu rencontrer les dieux qui lui accordent l'autorisation de passer au paradis et est ensuite représenté avec sa femme, Iyneferti, profitant de leur temps ensemble dans le champ de roseaux où ils récoltent du blé, vont travailler, labourent leur champ et récoltent des fruits. de leurs arbres, tout comme ils le faisaient sur le plan terrestre. L'érudite Clare Gibson écrit : « Le Champ de Roseaux était une version presque inimaginablement idéale de l'Égypte où les cultures atteignaient des hauteurs extraordinaires, les arbres portaient des fruits succulents et où les âmes transfigurées (qui semblaient toutes physiquement parfaites et dans la fleur de l'âge) voulaient rien en termes de subsistance, de luxe et même d'amour".
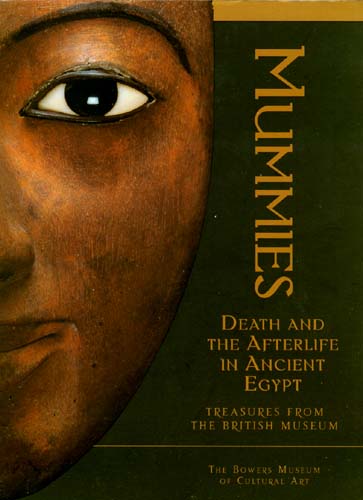
Si une âme n’était pas intéressée à labourer les champs ou à récolter des céréales dans l’au-delà, elle pouvait faire appel à une poupée shabti pour faire le travail à la place. Les poupées Shabti étaient des figures funéraires en bois, en pierre ou en faïence qui étaient placées dans les tombeaux ou les tombes avec les morts. Dans l'au-delà, on pensait que l'on pouvait faire appel à ces shabtis pour faire son travail tout en se relaxant et en s'amusant. Le sort 472 des textes du cercueil et le sort six du Livre égyptien des morts sont tous deux des instructions pour que l'âme appelle le shabti à la vie dans le champ des roseaux.
Une fois le shabti parti au travail, l'âme pouvait alors retourner se détendre sous un arbre préféré avec un bon livre ou se promener au bord d'un agréable ruisseau avec son chien. L’au-delà égyptien était parfait parce que l’âme retrouvait tout ce qui avait été perdu. Le meilleur ami, le mari, la femme, la mère, le père, le fils, la fille, le chat chéri ou le chien le plus aimé étaient là à notre arrivée ou, du moins, le seraient éventuellement ; et là, les âmes des morts vivraient pour toujours au paradis et n'auraient plus jamais à se séparer. Dans tout le monde antique, aucune autre culture n’a jamais imaginé une vie après la mort plus réconfortante. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: L'au-delà égyptien et La plume de la vérité. Est-il possible d’avoir un cœur plus léger qu’une plume ? Pour les anciens Égyptiens, c’était non seulement possible, mais hautement souhaitable. L'au-delà des anciens Égyptiens était connu sous le nom de Champ des Roseaux et était une terre très semblable à la vie sur terre, sauf qu'il n'y avait pas de maladie, pas de déception et, bien sûr, pas de mort. On vivait éternellement au bord des ruisseaux et sous les arbres qu'on avait si bien aimés dans sa vie sur terre. Une inscription sur une tombe égyptienne datant de 1400 avant JC, concernant l'au-delà, dit : « Puissé-je marcher chaque jour sans cesse au bord de mon eau, que mon âme se repose sur les branches des arbres que j'ai plantés, que je me rafraîchisse à l'ombre. de mon sycomore." Mais pour accéder au paradis éternel du Champ des Roseaux, il fallait passer par le procès d'Osiris, le juge des morts, dans la salle de vérité.
Dans le Livre égyptien des Morts, il est rapporté que l'âme était conduite devant le dieu Osiris et récitait les 42 confessions négatives commençant par la prière "Je n'ai pas appris les choses qui ne sont pas", ce qui signifie que l'âme s'est efforcée dans la vie de se consacrer à des questions d'importance durable plutôt qu'aux questions insignifiantes de la vie quotidienne. Les 42 déclarations négatives qui suivirent la prière d'ouverture allèrent assurer Osiris de la pureté de l'âme et se terminèrent en effet par la déclaration : « Je suis pur » répétée à plusieurs reprises. Ce n'est cependant pas la prétention de l'âme à la pureté qui gagnera Osiris, mais plutôt le poids du cœur de l'âme.
Le « cœur » de l'âme fut remis à Osiris qui le plaça sur une grande balance dorée en équilibre avec la plume blanche de Maât, la plume de la vérité, de l'harmonie, de l'autre côté. Si le cœur de l'âme était plus léger que la plume, alors l'âme était librement admise dans le bonheur du Champ de Roseaux. Cependant, si le cœur s'avérait plus lourd, il était jeté au sol de la salle de la vérité où il était dévoré par Amenti (un dieu avec une face de crocodile, un devant de léopard et un dos de rhinocéros) et l'âme individuelle. puis cessa d'exister. Il n’y avait pas d’« enfer » pour les anciens Égyptiens ; leur « sort pire que la mort » était la non-existence.
C’est une idée fausse populaire selon laquelle les anciens Égyptiens étaient obsédés par la mort alors qu’en réalité ils étaient amoureux de la vie et souhaitaient donc naturellement qu’elle continue après la mort corporelle. Les Égyptiens aimaient chanter, danser, faire du bateau, chasser, pêcher et se réunir en famille, tout comme les gens les apprécient aujourd'hui. Les rites funéraires élaborés, la momification, le placement de poupées Shabti (des poupées en argile ou en bois qui feraient le travail pour une personne dans l'au-delà) n'étaient pas destinés à rendre hommage à la finalité de la vie mais à sa continuité et à l'espoir que l'âme gagnerait l'admission au Champ des Roseaux lorsque viendrait le temps de se tenir devant la balance d'Osiris. Cependant, toutes les prières, ni tous les espoirs, ni les rites les plus élaborés ne pouvaient aider cette âme dont le cœur était plus lourd que la plume blanche de la Vérité. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: L'âme dans l'Egypte ancienne. Au début des temps, le dieu Atoum se tenait sur le monticule primordial au milieu des eaux du chaos et créa le monde. Le pouvoir qui a permis cet acte était heka (magie) personnifié dans le dieu Heka, la force invisible derrière les dieux. La terre et tout ce qui s’y trouve était donc imprégné de magie, y compris naturellement les êtres humains. L'humanité avait été créée par les dieux, et l'on vivait et se déplaçait grâce à la force magique qui l'animait : l'âme.
La vie d'un individu sur terre n'était considérée que comme une partie d'un voyage éternel. La personnalité était créée au moment de la naissance, mais l'âme était une entité immortelle habitant un vaisseau mortel. Lorsque ce vaisseau tombait en panne et que le corps de la personne mourait, l'âme partait vers un autre plan d'existence où, si elle était justifiée par les dieux, elle vivrait pour toujours dans un paradis qui était le reflet de son existence terrestre.
Cependant, cette âme n'était pas seulement le caractère d'une personne, mais un être composite composé de différentes entités, chacune ayant son propre rôle à jouer dans le voyage de la vie et de l'au-delà. Les rituels mortuaires qui constituaient un aspect si important de la culture égyptienne étaient si soigneusement observés car chaque aspect de l'âme devait être abordé pour que la personne puisse continuer son chemin vers l'éternité. On pensait que l’âme était composée de neuf parties distinctes qui étaient intégrées dans un tout individu mais avaient des aspects très distincts.
L'égyptologue Rosalie David explique : « Les Égyptiens croyaient que la personnalité humaine avait de nombreuses facettes – un concept qui s'est probablement développé au début de l'Ancien Empire. Dans la vie, le preson était une entité complète, mais s'il avait mené une vie vertueuse, il pouvait aussi avoir accès à une multiplicité de formes qui pourraient être utilisées dans l'autre monde. Dans certains cas, ces formes pouvaient être utilisées pour aider ceux que le défunt souhaitait soutenir ou, alternativement, pour se venger de ses ennemis.
Pour que ces aspects de l’âme fonctionnent, le corps devait rester intact, et c’est pourquoi la momification est devenue une partie intégrante des rituels mortuaires et de la culture. À certaines époques, on pensait que l'âme était composée de cinq parties et à d'autres de sept, mais, en général, elle était de neuf : "l'âme n'était pas seulement le caractère de l'individu mais un être composé de différentes entités, chacune ayant son propre rôle". jouer dans le voyage de la vie et de l'au-delà.
Le Khat était le corps physique qui, lorsqu'il devenait cadavre, assurait le lien entre l'âme et la vie terrestre. L'âme aurait besoin d'être nourrie après la mort, tout comme elle devait l'être sur terre, et ainsi des offrandes de nourriture et de boisson étaient apportées au tombeau et déposées sur une table d'offrandes. L'égyptologue Helen Strudwick observe que « l'un des sujets les plus courants pour les peintures et sculptures funéraires était le défunt assis à une table d'offrandes chargée de nourriture ». On ne pensait pas que le cadavre mangeait réellement cette nourriture mais qu’il absorbait ses nutriments de manière surnaturelle. Des peintures et des statues du défunt étaient également placées dans la tombe afin que, si quelque chose arrivait qui endommageait le corps, la statue ou le tableau assumerait son rôle.
Le Ka était la double forme ou le moi astral et correspond à ce que la plupart des gens considèrent aujourd'hui comme une « âme ». C'était « la source vitale qui permettait à une personne de continuer à recevoir des offrandes dans l'autre monde ». Le ka a été créé au moment de la naissance pour l'individu et reflétait ainsi sa personnalité, mais l'essence a toujours existé et a été « transmise à travers les générations successives, portant la force spirituelle de la première création ». Le ka n'était pas seulement la personnalité de chacun, mais aussi un guide et un protecteur, imprégné de l'étincelle du divin. C'était le ka qui absorberait le pouvoir des offrandes de nourriture laissées dans la tombe, et celles-ci le maintiendraient dans l'au-delà. Tous les êtres vivants avaient un ka - des plantes aux animaux et jusqu'aux dieux - ce qui était évident dans le sens où ils étaient simplement vivants.
Le Ba est le plus souvent traduit par « âme » et était un aspect d'oiseau à tête humaine qui pouvait se déplacer entre la terre et les cieux et, plus précisément, entre l'au-delà et le cadavre. Chaque ba était lié à un corps particulier, et le ba planait au-dessus du cadavre après la mort, mais pouvait également voyager dans l'au-delà, rendre visite aux dieux ou retourner sur terre dans les endroits que la personne avait aimés dans sa vie. Le cadavre devait retrouver le ka chaque nuit pour que le ka reçoive de la nourriture, et c'était le travail du ba d'accomplir cela. Les dieux avaient un ba ainsi qu'un ka. Des exemples en sont le taureau Apis qui était le ba d'Osiris et le Phénix, le ba de Ra.
Le Shuyet était l’ombre du moi, ce qui signifie qu’il était essentiellement l’ombre de l’âme. L'ombre en Égypte représentait le confort et la protection, et les sites sacrés d'Amarna étaient connus sous le nom d'Ombre de Ra pour cette raison. Le fonctionnement exact du shuyet n'est pas clair, mais il était considéré comme extrêmement important et fonctionnait comme une entité protectrice et guidante pour l'âme dans l'au-delà. Le Livre égyptien des Morts comprend un sortilège dans lequel l'âme déclare : « Mon ombre ne sera pas vaincue » en affirmant sa capacité à traverser l'au-delà vers le paradis.
L’Akh était le moi immortel et transformé qui était une union magique du ba et du ka. Strudwick écrit : « Une fois que l'akh a été créé par cette union, il a survécu en tant qu'« esprit éclairé », durable et inchangé pour l'éternité » (178). Akh est généralement traduit par « esprit » et était la forme supérieure de l'âme. Le sort 474 des Textes des Pyramides déclare : « l'akh appartient au ciel, le cadavre à la terre », et c'est l'akh qui jouirait de l'éternité parmi les stars avec les dieux. L'akh pouvait cependant revenir sur terre, et c'était un aspect de l'akh qui reviendrait sous forme de fantôme pour hanter les vivants si un mal avait été commis ou qui reviendrait dans les rêves pour aider quelqu'un qui leur était cher.
Le Sahu était l'aspect de l'Akh qui apparaissait comme un fantôme ou dans les rêves. Elle se sépare des autres aspects de l'âme une fois que l'individu est justifié par Osiris et jugé digne d'une existence éternelle. Le Sechem était un autre aspect de l'Akh qui lui permettait de maîtriser les circonstances. C'était l'énergie vitale de l'individu qui se manifestait par le pouvoir de contrôler son environnement et ses résultats.
L'Ab était le cœur, la source du bien et du mal, qui définissait le caractère d'une personne. C'était le cœur spirituel qui naissait du cœur physique (chapeau) qui était laissé dans le corps momifié du défunt pour cette raison : c'était le siège de l'individualité de la personne et l'enregistrement de ses pensées et de ses actes pendant son séjour sur terre. C'était l'ab qui était pesé dans la balance contre la plume blanche de la vérité par Osiris et, s'il était trouvé plus lourd que la plume, il était jeté au sol où il était dévoré par le monstre Amut. Une fois le cœur mangé, l’âme a cessé d’exister. Si le cœur était plus léger que la plume, l’âme était justifiée et pouvait avancer vers le paradis. Une amulette spéciale était incluse dans la momification du cadavre et placée sur le cœur comme un charme protecteur pour empêcher le cœur de témoigner contre l'âme et éventuellement de la condamner à tort.
Le Ren était un nom secret. Cela a été donné à la naissance par les dieux, et seuls les dieux le savaient. L'érudit Nicholaus B. Pumphrey écrit : « La seule manière dont le destin peut changer est si une créature de puissance supérieure change de nom. Tant que le nom de l’être existe, l’être existera pour l’éternité en tant que partie intégrante du tissu de l’ordre divin » (6-7). Le ren était le nom par lequel les dieux connaissaient l'âme individuelle et comment on l'appellerait dans l'au-delà.
Les rituels mortuaires étaient observés pour aborder chaque aspect de l'âme et assurer aux vivants que le défunt vivrait après la mort. La momification était pratiquée pour préserver le corps, des amulettes et des textes magiques étaient inclus pour aborder les autres facettes spirituelles qui constituaient un individu. Les morts n’étaient pas oubliés une fois déposés dans leur tombeau. Des rituels étaient alors observés quotidiennement en leur honneur et pour leur survie. Rosalie David écrit : « Afin d'assurer le maintien du lien entre les vivants et les morts, afin que l'immortalité de la personne soit assurée, il fallait pourvoir à tous les besoins matériels du défunt et accomplir les rites funéraires corrects. On s'attendait à ce que l'héritier d'une personne apporte les offrandes quotidiennes au tombeau pour soutenir le ka du propriétaire.
Si la famille n'était pas en mesure d'accomplir cette tâche, elle pouvait embaucher un « serviteur du Ka », un prêtre spécialement formé aux rituels. Une tombe ne pouvait pas être négligée, sinon l'esprit de la personne souffrirait dans l'au-delà et pourrait alors revenir pour se venger. C'est en fait l'intrigue de l'une des histoires de fantômes égyptiennes les plus connues, Khonsemhab et le fantôme, dans laquelle l'esprit de Nebusemekh revient pour demander de l'aide à Khonesmhab, le grand prêtre d'Amon. Le tombeau de Nebusemekh a été négligé au point que personne ne se souvient même de l'endroit où il se trouve et personne ne vient le visiter ou apporter les offrandes nécessaires. Khonsemhab envoie ses serviteurs localiser, réparer et remettre à neuf le tombeau, puis promet de fournir des offrandes quotidiennes au ka de Nebusemekh.
Ces offrandes seraient déposées sur une table d'autel dans la chapelle des offrandes de ces tombes suffisamment élaborées pour en avoir une ou sur la table d'offrandes dans la tombe. Le ka du défunt entrerait dans le tombeau par la fausse porte prévue et habiterait le corps ou une statue et se nourrirait des offrandes fournies. En cas de retard, quelle qu'en soit la raison, une quantité importante de nourriture et de boissons était enterrée avec ceux qui en avaient les moyens. Strudwick note comment « les besoins immédiats du défunt ont été satisfaits en inhumant un véritable festin – viande, légumes, fruits, pain et cruches de vin, d'eau et de bière – avec la momie » (186). Cela garantirait que les défunts soient pris en charge, mais n'annulerait pas l'obligation des vivants de se souvenir et de prendre soin des morts.
Des listes d'offrandes, qui stipulaient quels types de nourriture devaient être apportées et en quelle quantité, étaient inscrites sur les tombes afin que le serviteur du Ka ou un autre prêtre puisse à l'avenir continuer à s'approvisionner, même longtemps après la mort de la famille. Des autobiographies accompagnaient les listes d'offrandes pour célébrer la vie de la personne et fournir un moyen de se souvenir durablement. Pour la plupart, les gens prenaient au sérieux l'entretien des tombes de leur famille et les offrandes en l'honneur des défunts, sachant qu'un jour, ils auraient besoin du même genre d'attention pour la subsistance de leur propre âme. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Le Livre égyptien des Morts est une collection de sortilèges qui permettent à l'âme du défunt de naviguer dans l'au-delà. Ce titre célèbre a été donné à l'ouvrage par des érudits occidentaux ; le titre réel se traduirait par Le Livre de la sortie de jour ou des sorts pour sortir de jour et une traduction plus appropriée en anglais serait Le Livre égyptien de la vie. Bien que l'ouvrage soit souvent appelé « la Bible égyptienne antique », il n'en est rien, même si les deux ouvrages partagent la similitude d'être d'anciennes compilations de textes écrits à des époques différentes, finalement rassemblés sous forme de livre. Le Livre des Morts n’a jamais été codifié et il n’existe pas deux exemplaires identiques. Ils ont été créés spécifiquement pour chaque personne qui pouvait se permettre d’en acheter un, comme une sorte de manuel pour l’aider après sa mort.
L'égyptologue Geralidine Pinch explique : « Le Livre égyptien des morts est un terme inventé au XIXe siècle après JC pour désigner un ensemble de textes connus des anciens Égyptiens sous le nom de Sortilèges pour sortir de jour. Après que le Livre des Morts ait été traduit pour la première fois par les égyptologues, il a gagné une place dans l’imaginaire populaire sous le nom de Bible des anciens Égyptiens. La comparaison est très inappropriée. Le Livre des Morts n’était pas le livre sacré central de la religion égyptienne. Ce n'était que l'un d'une série de manuels composés pour aider les esprits des morts d'élite à atteindre et à maintenir une vie après la mort complète.
La vie après la mort était considérée comme une continuation de la vie sur terre et, après avoir traversé diverses difficultés et jugements dans la Salle de la Vérité, un paradis qui était le reflet parfait de notre vie sur terre. Après que l'âme eut été justifiée dans la Salle de la Vérité, elle traversa le Lac Lily pour se reposer dans le Champ des Roseaux où l'on retrouverait tout ce qu'on avait perdu dans la vie et pourrait en profiter éternellement. Mais pour atteindre ce paradis, il fallait savoir où aller, comment s'adresser à certains dieux, que dire à certaines heures, et comment se comporter au pays des morts ; c’est pourquoi on trouverait un manuel sur l’au-delà extrêmement utile. Avoir un Livre des Morts dans sa tombe équivaudrait à un étudiant des temps modernes mettant la main sur toutes les réponses aux tests dont il aurait besoin.
Le Livre des Morts tire son origine de concepts représentés dans des peintures funéraires et des inscriptions datant de la Troisième Dynastie égyptienne (vers 2670 - 2613 av. J.-C.). À la 12e dynastie (1991 - 1802 avant JC), ces sorts, accompagnés d'illustrations, étaient écrits sur du papyrus et placés dans les tombeaux et les tombes avec les morts. Leur objectif, comme l'explique l'historienne Margaret Bunson, « était d'enseigner aux défunts comment surmonter les dangers de l'au-delà en leur permettant de prendre la forme de plusieurs créatures mythiques et de leur donner les mots de passe nécessaires pour accéder à certaines étapes du monde souterrain. " (47). Mais ils servaient également à donner à l’âme une connaissance préalable de ce qui serait attendu à chaque étape. Avoir un Livre des Morts dans sa tombe équivaudrait à ce qu'un élève d'aujourd'hui mette la main sur toutes les réponses aux tests dont il aurait besoin dans chaque niveau d'école.
À un moment donné avant 1600 avant JC, les différents sorts avaient été divisés en chapitres et, à l'époque du Nouvel Empire (1570 - 1069 avant JC), le livre était extrêmement populaire. Des scribes experts en sortilèges étaient consultés pour créer des livres sur mesure pour un individu ou une famille. Bunson note : « Ces sorts et mots de passe ne faisaient pas partie d'un rituel mais étaient créés pour le défunt, afin d'être récités dans l'au-delà ». Si quelqu’un était malade et craignait de mourir, il s’adressait à un scribe et lui faisait rédiger un livre de sorts pour l’au-delà. Le scribe aurait besoin de savoir quel genre de vie la personne avait vécu afin de deviner le type de voyage auquel elle pourrait s'attendre après la mort ; alors les sorts appropriés seraient écrits spécifiquement pour cet individu.
Avant le Nouvel Empire, le Livre des Morts n’était accessible qu’à la royauté et à l’élite. La popularité du mythe d'Osiris à l'époque du Nouvel Empire faisait croire aux gens que les sorts étaient indispensables parce qu'Osiris figurait en bonne place dans le jugement de l'âme dans l'au-delà. Alors que de plus en plus de gens désiraient avoir leur propre Livre des Morts, les scribes les y obligeaient et le livre devint juste un autre produit destiné à la vente. De la même manière que les éditeurs proposent aujourd'hui des livres imprimés à la demande ou des ouvrages auto-publiés, les scribes proposaient différents « packages » aux clients parmi lesquels choisir. Ils pouvaient avoir autant de sorts dans leurs livres qu'ils pouvaient se le permettre. Bunson écrit : « L'individu pouvait décider du nombre de chapitres à inclure, des types d'illustrations et de la qualité du papyrus utilisé. L'individu n'était limité que par ses ressources financières").
Du Nouvel Empire à la dynastie ptolémaïque (323 - 30 avant JC) Le Livre des Morts a été réalisé de cette manière. Sa forme et sa taille ont continué à varier jusqu'à environ 650 avant JC, date à laquelle il a été fixé à 190 sorts uniformes, mais les gens pouvaient toujours ajouter ou soustraire ce qu'ils voulaient du texte. Un livre des morts de la dynastie ptolémaïque qui appartenait à une femme nommée Tentruty était accompagné du texte des Lamentations d'Isis et de Nephthys qui n'a jamais été inclus dans le livre des morts. D'autres exemplaires du livre ont continué à être produits avec plus ou moins de périodes en fonction de ce que l'acheteur pouvait se permettre. Cependant, le seul sort que chaque copie semble avoir eu était le sort 125.
Le Sort 125 est le plus connu de tous les textes du Livre des Morts. Les gens qui ne connaissent pas le livre, mais qui ont la moindre connaissance de la mythologie égyptienne, connaissent le sort sans même s'en rendre compte. Le sort 125 décrit le jugement du cœur du défunt par le dieu Osiris dans la salle de la vérité, l'une des images les plus connues de l'Égypte ancienne, même si le dieu avec sa balance n'est jamais réellement décrit dans le texte. Comme il était vital que l'âme réussisse l'épreuve de la pesée du cœur pour accéder au paradis, savoir quoi dire et comment agir devant Osiris, Thot, Anubis et les quarante-deux juges était considéré comme l'information la plus importante. le défunt pourrait arriver avec.
Lorsqu'une personne mourait, elle était guidée par Anubis vers la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle des Deux Vérités) où elle faisait la confession négative (également connue sous le nom de Déclaration d'innocence). Il s’agissait d’une liste de 42 péchés auxquels une personne pouvait honnêtement dire qu’elle ne s’était jamais livrée. Une fois la confession négative faite, Osiris, Thot, Anubis et les quarante-deux juges se concertaient et, si la confession était acceptée, le cœur du défunt était alors pesé dans la balance contre la plume blanche de Maât, le plume de vérité. Si le cœur se révélait plus léger que la plume, l'âme passait vers le paradis ; si le cœur était plus lourd, il était jeté sur le sol où il était dévoré par la déesse monstre Ammut et l'âme cesserait d'exister.
Le sort 125 commence par une introduction au lecteur (l'âme) : "Que faut-il dire en arrivant dans cette salle de justice, en purgeant _____[nom de la personne] de tout le mal qu'il a fait et en voyant les visages des dieux." Le sort commence alors très clairement en disant à l'âme exactement quoi dire lorsqu'elle rencontre Osiris : « Salut à toi, grand dieu, Seigneur de Justice ! Je suis venu vers toi, mon seigneur, pour que tu m'amènes afin que je puisse voir ta beauté car je te connais et je connais ton nom et je connais les noms des quarante-deux dieux de ceux qui sont avec toi dans cette salle. de Justice, qui vivent de ceux qui chérissent le mal et qui avalent leur sang en ce jour du jugement des personnages en présence de Wennefer [autre nom d'Osiris]. Voici le double fils des chanteuses ; Seigneur de Vérité est votre nom. Voici, je suis venu à toi, je t'ai apporté la vérité, j'ai repoussé pour toi le mensonge. Je n'ai pas commis de mensonge contre les hommes, je n'ai pas appauvri mes associés, je n'ai pas fait de mal dans la Place de la Vérité, je n'ai pas appris ce qui n'est pas..."
Après ce prologue, l'âme prononce alors la confession négative et est interrogée par les dieux et les quarante-deux juges. A ce stade, certaines informations très précises étaient nécessaires pour être justifiées par les dieux. Il fallait connaître les noms des différents dieux et de quoi ils étaient responsables, mais il fallait également connaître des détails tels que les noms des portes de la pièce et l'étage qu'il fallait traverser ; il fallait même connaître le nom de ses propres pieds. Lorsque l'âme répondait correctement à chaque divinité et objet, elle entendait la réponse : « Vous nous connaissez ; passez à côté de nous » et pouvait continuer.
À un moment donné, l'âme doit répondre à la parole concernant ses pieds :
"Je ne vous laisserai pas marcher sur moi", dit le parquet de cette salle de justice.
"Pourquoi pas? Je suis pur."
"Parce que je ne connais pas les noms de tes pieds avec lesquels tu me marcherais. Dis-les-moi."
"'Image secrète de Ha' est le nom de mon pied droit ; 'Fleur d'Hathor' est le nom de mon pied gauche."
"Vous nous connaissez, entrez par nous."
Le sort se termine par ce que l'âme devrait porter lorsqu'elle rencontre le jugement et comment on devrait réciter le sort : « La procédure correcte dans cette salle de justice : on doit prononcer ce sort pur et propre et vêtu de vêtements blancs et de sandales, peints de de la peinture noire pour les yeux et ointe de myrrhe. On lui offrira de la viande et de la volaille, de l'encens, du pain, de la bière et des herbes lorsque vous aurez déposé cette procédure écrite sur un sol propre d'ocre recouvert de terre sur lequel aucun porc ni petit bétail n'a foulé.
Suite à cela, le scribe qui a écrit le sort se félicite pour son travail bien fait et assure au lecteur que lui, le scribe, s'épanouira tout comme ses enfants pour sa part dans la création du sort. Il fera bien, dit-il, lorsqu'il viendra lui-même au jugement et qu'il « sera introduit avec les rois de Haute-Égypte et les rois de Basse-Égypte et il sera à la suite d'Osiris ». Une affaire un million de fois vraie." Pour avoir lancé le sort, le scribe était considéré comme faisant partie du fonctionnement interne de l'au-delà et était ainsi assuré d'un accueil favorable dans le monde souterrain et d'un passage au paradis.
Pour l’individu moyen, même pour le roi, l’expérience était beaucoup moins certaine. Si l'on répondait correctement à toutes ces questions, si l'on avait le cœur plus léger que la plume de la vérité, et si l'on parvenait à être gentil avec le passeur divin revêche qui ramait les âmes à travers le lac Lily, on se retrouverait au paradis. Le champ égyptien de roseaux (parfois appelé champ d’offrandes) était exactement ce que l’on avait laissé derrière soi dans la vie. Une fois sur place, l’âme a retrouvé ses proches perdus et même ses animaux de compagnie bien-aimés. L'âme vivrait dans une image de la maison qu'elle avait toujours connue avec exactement la même cour, les mêmes arbres, les mêmes oiseaux chantant le soir ou le matin, et cela serait apprécié pour l'éternité en présence des dieux.
Il y avait cependant un certain nombre d'erreurs que l'âme pouvait commettre entre l'arrivée au Hall de la Vérité et le voyage en bateau vers le paradis. Le Livre des Morts comprend des sorts pour tout type de circonstance, mais il ne semble pas que l'on soit assuré de survivre à ces rebondissements. L'Égypte a une longue histoire et, comme pour toute culture, les croyances ont changé dans le temps, ont changé et ont changé à nouveau. Tous les détails décrits ci-dessus n’ont pas été inclus dans la vision de chaque époque de l’histoire égyptienne. À certaines époques, les modifications sont mineures tandis que, à d’autres, l’au-delà est perçu comme un voyage périlleux vers un paradis qui n’est que temporaire. À certains moments de la culture, le chemin vers le paradis était très simple une fois que l'âme avait été justifiée par Osiris, tandis que dans d'autres, les crocodiles pouvaient contrecarrer l'âme ou les virages de la route s'avéraient dangereux ou encore les démons semblaient tromper ou même attaquer.
Dans ces cas-là, l’âme avait besoin de sorts pour survivre et atteindre le paradis. Les sorts inclus dans le livre incluent des titres tels que « Pour avoir repoussé un crocodile qui vient l'emporter », « Pour avoir chassé un serpent », « Pour ne pas avoir été mangé par un serpent dans le royaume des morts », « Pour ne plus mourir ». Dans le royaume des morts", "Pour avoir été transformé en faucon divin", "Pour avoir été transformé en lotus", "Pour avoir été transformé en phénix" et ainsi de suite. Les sorts de transformation sont devenus connus grâce à des allusions populaires au livre dans les productions télévisées et cinématographiques, ce qui a abouti à une compréhension erronée que le Livre des Morts est une sorte d'œuvre magique de type Harry Potter que les anciens Égyptiens utilisaient autrefois pour des rites mystiques. Le Livre des Morts, comme indiqué, n'a jamais été utilisé pour des transformations magiques sur terre ; les sorts n'ont fonctionné que dans l'au-delà. L'affirmation selon laquelle le Livre des Morts serait une sorte de texte de sorcier est aussi fausse et infondée que la comparaison avec la Bible.
Le Livre des Morts égyptien n’a rien à voir non plus avec le Livre des Morts tibétain, bien que ces deux ouvrages soient également souvent assimilés. Le Livre tibétain des morts (de son vrai nom Bardo Thodol, « Grande libération par l'audition ») est un recueil de textes à lire à une personne mourante ou récemment décédée et permettant à l'âme de savoir étape par étape ce qui se passe. étape. La similitude qu'il partage avec l'œuvre égyptienne est qu'elle est destinée à réconforter l'âme et à la conduire hors du corps et à l'au-delà. Le Livre des Morts tibétain, bien sûr, traite d'une cosmologie et d'un système de croyance totalement différents, mais la différence la plus significative est qu'il est conçu pour être lu par les vivants aux morts ; ce n'est pas un manuel que les morts peuvent réciter eux-mêmes. Les deux œuvres ont souffert du qualificatif de « Livre des Morts », qui soit attire l'attention de ceux qui les considèrent comme des clés de la connaissance éclairée, soit comme des œuvres du diable à éviter ; en réalité, ils ne le sont ni l’un ni l’autre. Les deux livres sont des constructions culturelles conçues pour faire de la mort une expérience plus gérable.
Les sortilèges du Livre des Morts, quelle que soit l'époque à laquelle les textes ont été écrits ou rassemblés, promettaient une continuation de l'existence après la mort. Tout comme dans la vie, il y avait des épreuves et des virages inattendus sur le chemin, des domaines et des expériences à éviter, des amis et des alliés à cultiver, mais finalement l'âme pouvait s'attendre à être récompensée pour avoir vécu une vie bonne et vertueuse. Pour ceux qui sont restés dans la vie, les sorts auraient été interprétés de la même manière que les gens d'aujourd'hui lisent les horoscopes. Les horoscopes ne sont pas écrits pour souligner les points négatifs d’une personne ni pour se sentir mal dans sa peau ; de la même manière, les sorts ont été construits pour que quelqu'un encore en vie puisse les lire, penser à son proche dans l'au-delà et avoir l'assurance qu'il a réussi à se frayer un chemin en toute sécurité jusqu'au Champ de Roseaux. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Les Quarante-Deux Juges étaient les êtres divins de l'au-delà égyptien qui présidaient la Salle de la Vérité où le grand dieu Osiris jugeait les morts. L'âme du défunt était appelée à renoncer à la confession des actes accomplis au cours de sa vie et à faire peser son cœur dans la balance de la justice contre la plume blanche de Maât, de vérité et d'équilibre harmonieux. Si le cœur du défunt était plus léger que la plume, il était admis à la vie éternelle au Champ des Roseaux ; si le cœur était trouvé plus lourd que la plume, il était jeté au sol où il était mangé par le monstre Amemait (également connu sous le nom d'Ammut, « le gobbler », en partie lion, en partie hippopotame et en partie crocodile) et l'âme de la personne puis cesser d'exister. La non-existence, plutôt qu’un monde de tourments, était la plus grande peur des anciens Égyptiens.
Bien qu'Osiris fût le principal juge des morts, les quarante-deux juges siégèrent en conseil avec lui pour déterminer si l'âme était digne de continuer à exister. Ils représentaient les quarante-deux provinces de la Haute et de la Basse-Égypte, et chaque juge était chargé de considérer un aspect particulier de la conscience du défunt. Parmi ceux-ci, il y avait neuf grands juges, Ra (dans son autre forme d'Atoum) Shu, Tefnout, Geb, Nut, Isis, Nephthys, Horus et Hathor. Parmi les autres juges, ils ont été décrits comme des êtres impressionnants et terribles portant des noms tels que Crusher of Bones, Eater of Entrails, Double Lion, Stinking Face et Eater of Shades, entre autres (Bunson). Cependant, les quarante-deux juges n'étaient pas tous horribles et terribles, mais ils sembleraient l'être à cette âme qui faisait face à une condamnation plutôt qu'à une récompense pour une vie bien vécue. On s'attendait à ce que l'âme soit capable de réciter la confession négative (également connue sous le nom de déclaration d'innocence) pour défendre sa vie afin d'être considérée comme digne d'être transmise au Champ des Roseaux.
La confession négative comprenait des déclarations telles que : « Je n'ai pas volé. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas volé la propriété d'un dieu. Je n'ai pas dit de mensonges. Je n’ai égaré personne. Je n'ai pas semé la terreur. Je n'ai donné faim à personne." Le Livre des Morts égyptien (le texte funéraire le plus célèbre de l'Egypte ancienne, composé vers 1550 avant JC) fournit l'image la plus complète des quarante-deux juges ainsi que des sortilèges et de l'incantation du Négatif. Confession. Selon l'érudit Ikram, « Comme pour les textes funéraires antérieurs, le Livre des Morts servait à approvisionner, protéger et guider le défunt vers l'Au-delà, qui était en grande partie situé dans le Champ des Roseaux, une Égypte idéalisée. Le chapitre 125 était une innovation, et peut-être l'un des sorts les plus importants ajoutés car il semble refléter un changement de moralité. Ce chapitre, accompagné d'une vignette, montre le défunt devant Osiris et quarante-deux juges, chacun représentant un aspect différent de la maât. Une partie du rituel consistait à nommer correctement chaque juge et à faire des aveux négatifs. »
Une fois la confession négative faite par l'âme du défunt (aidé par les sortilèges du Livre des Morts) et le cœur pesé dans la balance, les quarante-deux juges se réunirent en conférence avec Osiris, présidée par le Dieu de la sagesse, Thot, pour rendre le jugement final. Si l'âme était considérée comme digne, alors, selon certains récits, elle était dirigée hors de la salle vers la créature connue sous le nom de Hraf-haf (ce qui signifie Celui-qui-regarde-derrière-lui), qui était un passeur de mauvaise humeur et insultant que le Le défunt a dû trouver un moyen d'être gentil et cordial afin d'être ramé jusqu'aux rives du Champ de Roseaux et à la vie éternelle. Après avoir traversé la Salle de la Vérité et, finalement, s'être montrées dignes par leur gentillesse envers le méchant Hraf-Haf, les âmes trouveraient enfin la paix et jouiraient d'une éternité dans le bonheur. Le Champ de Roseaux reflétait parfaitement le monde dont on avait profité au cours de son existence terrestre, jusqu'aux arbres et aux fleurs qu'on avait plantés, sa maison et ses proches. Tout ce qu'un ancien Égyptien devait faire pour atteindre ce bonheur éternel était d'avoir vécu une vie digne de l'approbation d'Osiris et des quarante-deux juges. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Les textes des pyramides : Guide de l'au-delà. Les Textes des Pyramides sont les écrits religieux les plus anciens du monde et constituent la principale littérature funéraire de l’Egypte ancienne. Ils comprennent les textes inscrits sur les sarcophages et les murs des pyramides de Saqqarah sous les Ve et VIe dynasties de l'Ancien Empire (2613-2181 av. J.-C.). Les textes étaient réservés à l'âme du pharaon décédé par ses scribes et prêtres et constituaient une série de sortilèges et d'incantations destinés à libérer l'âme du pharaon du corps et à l'aider à monter vers les cieux. Ces textes sont considérés comme des sources principales sur la vie des pharaons pour lesquels ils ont été écrits et ont fourni aux égyptologues des informations sur le rôle joué par le pharaon dans la vie de la civilisation égyptienne, les réalisations spécifiques d'un dirigeant et même des détails sur la personnalité de l'individu. Les inscriptions relatent également des allusions mythiques, les noms des dieux, et des instructions pour le défunt concernant l'au-delà et le voyage du ka (l'âme) du corps à la vie éternelle parmi « les stars impérissables » où il vivrait avec les dieux.
Plus de deux cents dieux et déesses sont mentionnés dans les textes des pyramides, des divinités les plus célèbres (comme Osiris et Isis) aux divinités moins connues. Ces allusions, comme toutes les inscriptions, étaient destinées à aider l'âme du pharaon dans sa transition de la vie terrestre à l'au-delà (connu sous le nom de Champ des Roseaux) où il vivrait éternellement. Le Champ de Roseaux était une image miroir de la vie sur terre, mais sans maladie, déception ou – bien sûr – mort. On vivrait éternellement la vie dont on jouissait sur terre mais, d'abord, il fallait échapper aux esprits sombres qui pourraient nous égarer et passer par le jugement d'Osiris et des quarante-deux juges dans la salle de la vérité. Les dieux étaient clairement du côté du roi dans sa lutte pour se libérer de l’ancienne demeure de son corps et trouver le chemin de la joie éternelle. Ils sont invoqués comme alliés contre les forces des ténèbres et du chaos (mauvais esprits ou démons) et comme guides dans le royaume inconnu qui a suivi la vie sur terre.
Ces inscriptions ne racontent pas l'intégralité des mythes égyptiens mais font uniquement allusion à des événements mythologiques ou à des moments emblématiques qui symboliseraient des concepts tels que l'harmonie, la restauration, la stabilité et l'ordre. Des dieux puissants tels que Thot (dieu de la sagesse et de l'écriture) ou Horus (restaurateur de l'ordre) sont invoqués pour aider le roi et les allusions aux mythes (comme Les Conflits entre Horus et Seth dans lesquels l'ordre surmonte le chaos) rappelleraient au roi de la présence des dieux et de leur bonne volonté. Les textes des pyramides fournissent la première référence écrite au grand dieu Osiris, roi des morts, et au concept du jugement de l'âme dans la salle de la vérité et, ce faisant, tentent d'assurer au roi qu'il passera par cette salle. jugement en toute sécurité. Les textes des pyramides constituent la première référence écrite au grand dieu Osiris, roi des morts.
Les soi-disant « énoncés » sont des inscriptions destinées à être prononcées à voix haute (d'où leur désignation) et, de par la manière dont elles sont écrites, très probablement chantées. Selon la chercheuse Geraldine Pinch, « beaucoup ont été composées à la première personne et auraient été très dramatiques lorsqu'elles étaient prononcées ou chantées à haute voix ». Dans la déclaration qui détaille le voyage du pharaon décédé dans le ciel, par exemple, des verbes comme « vole », « se précipite », « embrassé » et « bondi » sont écrits pour être soulignés : « Celui qui vole, vole ! Il s'enfuit loin de vous, hommes. Il n'est plus sur terre. Il est dans le ciel. Il se précipite vers le ciel comme un héron. Il a embrassé le ciel comme un faucon. Il a bondi vers le ciel comme une sauterelle". Chaque énoncé correspond à un chapitre d'un livre ; un livre à lire à haute voix à l'âme du défunt. Mais ce « livre » était sans doute à l’origine une tradition orale qui, avec le temps, fut inscrite sur les murs des tombes.
On attribue la création de ces œuvres aux prêtres de l'Ancien Empire et des preuves intertextuelles suggèrent fortement qu'ils l'ont fait afin de fournir à l'âme du pharaon une connaissance détaillée de l'au-delà et de la manière d'y arriver en toute sécurité. Certaines paroles, qui appellent les dieux à les aider et à les guider, réconfortent également l'âme et lui assurent que ce passage du corps est naturel et ne doit pas être craint. D'autres paroles semblent assurer ceux qui vivent (et chantent les paroles) que l'âme est arrivée saine et sauve : « Il est monté dans le ciel et a trouvé Râ, qui se lève lorsqu'il s'approche de lui. Il s'assied à côté de lui, car Râ ne lui permet pas de s'asseoir par terre, sachant qu'il est plus grand que Râ. Il a pris position aux côtés de Ra".
Geraldine Pinch note : « Le but principal de rassembler ces textes et de les inscrire à l'intérieur des pyramides était d'aider le corps du roi décédé à échapper à l'horreur de la putréfaction et son esprit à monter vers le royaume céleste où il prendrait sa place parmi les dieux. . Certains textes ont probablement été récités lors des funérailles du roi ou dans le cadre du culte mortuaire qui s'est poursuivi après sa mort. D'autres peuvent avoir été destinés à être prononcés par le roi décédé alors qu'il entrait dans l'au-delà". L'âme du défunt pouvait voler ou courir ou marcher ou même ramer jusqu'au Champ de Roseaux dans un bateau comme l'indique ce passage : « Une rampe vers le ciel lui est construite pour qu'il puisse monter vers le ciel dessus. Il monte sur la fumée de la grande expiration. Il vole comme un oiseau et il s'installe comme un scarabée sur un siège vide sur le bateau de Ra… Il rame dans le ciel dans ton bateau, ô Ra ! Et il vient à terre dans ton bateau, ô Ra ! »
Le vol de l'âme, bien entendu, ne pouvait avoir lieu qu'après que le défunt ait subi le jugement d'Osiris dans la salle de la Vérité et que son cœur ait été pesé dans la balance d'or contre la plume blanche de la Vérité (la plume de Maât, déesse d'harmonie et d'équilibre). Bien que les textes des pyramides soient les premiers à mentionner le jugement d'Osiris, le concept sera pleinement développé par écrit plus tard dans le Livre de la sortie le jour, mieux connu sous le nom de Livre égyptien des morts, qui s'inspire des textes des pyramides.
Le vaisseau de Râ était étroitement associé au soleil et les textes indiquent que l'âme, après avoir passé par le jugement, voyagerait avec le vaisseau de Râ à travers le monde souterrain sombre mais, toujours, s'élèverait vers le zénith du ciel avec le matin et Continuez vers le Champ des Roseaux où l'on jouirait de la vie éternelle dans un pays très semblable à celui que l'esprit connaissait sur terre, toujours en présence bienveillante des grands dieux et déesses comme Osiris, Ra, Isis et Ma'at. Ce bateau, connu sous le nom de Navire d'un million d'âmes, était la barge solaire que les morts justifiés aideraient Ra à défendre contre le serpent Apep (également connu sous le nom d'Apophis) qui tentait de le détruire chaque nuit. Ceci n'est qu'une version de la vision de l'au-delà que présentent les textes, une autre étant le jugement le plus connu dans la salle de la vérité suivi d'un voyage sur l'eau à la rame par le batelier Hraf-haf ("Celui qui regarde derrière lui") qui a amené les âmes justifiées au Champ des Roseaux.
Les Égyptiens croyaient que leur voyage terrestre n’était qu’une partie d’une vie éternelle vécue en présence des dieux. Les dieux donnaient un sens à leur vie quotidienne et leur promettaient que la mort n’était pas la fin. Toute l'Égypte vivait de la présence de ces dieux et le peuple tenait si cher à cette terre qu'il craignait d'éviter les voyages prolongés ou les campagnes militaires qui les mèneraient au-delà de ses frontières, car ils croyaient que s'ils mouraient hors d'Égypte, ils auraient il sera plus difficile d'atteindre le Champ des Roseaux - voire de ne jamais l'atteindre du tout. Cependant, même pour ceux qui mouraient à l'intérieur des frontières du pays, il était reconnu que la transition vers l'au-delà constituerait un changement effrayant par rapport à ce à quoi on était habitué. Les textes des pyramides offraient l'assurance qu'en fin de compte, tout irait bien parce que les dieux étaient là dans la mort comme ils l'avaient été dans la vie, et qu'ils guideraient l'âme en toute sécurité vers sa demeure éternelle. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Les textes de cercueils (vers 2134-2040 avant JC) sont 1 185 sorts, incantations et autres formes d'écriture religieuse inscrits sur des cercueils pour aider le défunt à naviguer dans l'au-delà. Ils comprennent le texte connu sous le nom de Livre des Deux Voies, qui est le premier exemple de cosmographie dans l'Égypte ancienne, fournissant des cartes de l'au-delà et la meilleure façon d'éviter les dangers sur le chemin du paradis. L'égyptologue Geraldine Pinch note que « ces cartes, qui étaient généralement peintes sur le sol des cercueils, sont les plus anciennes cartes connues de n'importe quelle culture » et que le Livre des Deux Voies « n'était rien de moins qu'un guide illustré de l'au-delà » (15 ). Le Livre des Deux Voies n'était pas une œuvre à part, ni même un livre, mais des cartes détaillées qui correspondaient au reste du texte peint à l'intérieur du cercueil.
Les textes sont dérivés, en partie, des textes des pyramides antérieurs (vers 2400-2300 avant JC) et ont inspiré l'ouvrage ultérieur connu sous le nom de Livre égyptien des morts (vers 1550-1070 avant JC). Ils ont été écrits principalement au cours de la première période intermédiaire de l'Égypte (2181-2040 avant JC), bien qu'il existe des preuves qu'ils ont commencé à être composés vers la fin de l'Ancien Royaume (vers 2613-2181 BC) et se poursuivraient jusqu'au début du Royaume du Milieu (2040 (2040 -1782 avant JC). Au temps du Nouvel Empire (vers 1570-1069 avant JC), ils seront remplacés par le Livre des Morts qui figure parfois parmi les objets funéraires.
Les textes de cercueil sont significatifs à plusieurs niveaux, mais principalement parce qu'ils illustrent le changement culturel et religieux entre l'Ancien Empire et la première période intermédiaire de l'Égypte et clarifient le développement des croyances religieuses du peuple. L'Ancien Empire d'Égypte est bien connu sous le nom de « l'ère des bâtisseurs de pyramides ». Le roi Snéfrou (vers 2613-2589 avant JC) perfectionna l'art de la construction des pyramides et son fils Khéops (2589-2566 avant JC) créa la plus grande d'entre elles avec sa Grande Pyramide de Gizeh.
Khéops a été suivi par Khafré (2558-2532 avant JC) puis par Menkaure (2532-2503 avant JC), qui ont tous deux également érigé des pyramides sur le site. Ces trois monuments étaient entourés de complexes comprenant des temples tenus par le clergé et, en outre, des logements pour les fonctionnaires qui travaillaient sur le site. Bien que les pyramides soient aujourd’hui universellement admirées, peu de gens sont conscients de l’énorme coût de ces monuments. Tout au long de la période de l’Ancien Empire, les dirigeants devaient non seulement construire leurs propres tombes grandioses, mais également entretenir celles de leurs prédécesseurs. Gizeh était la nécropole royale des monarques de l'Ancien Empire, mais il y avait aussi le complexe pyramidal de Saqqarah, un autre à Abusir et d'autres entre les deux. Tous devaient être dirigés par des prêtres qui accomplissaient les rituels pour honorer les rois morts et les aider dans leur voyage dans l'au-delà.
Les prêtres recevaient du roi des dotations pour réciter les sorts et accomplir les rituels, mais étaient en outre exonérés du paiement des impôts. Comme les prêtres possédaient une grande quantité de terres, cela représentait une perte de revenus importante pour le roi. Sous la Ve dynastie, le roi Djedkarê Isesi (2414-2375 av. J.-C.) décentralisa le gouvernement et donna plus de pouvoir aux gouverneurs régionaux (nomarques), qui purent désormais s'enrichir aux dépens du gouvernement central. Ces facteurs ont contribué à l’effondrement de l’Ancien Empire vers la fin de la 6e dynastie et ont initié la Première Période Intermédiaire. Les textes de cercueil ont été développés pour répondre au besoin d'une nouvelle compréhension de l'au-delà et de la place des gens ordinaires dans celle-ci.
À cette époque, l'ancien paradigme d'un roi fort dirigeant un gouvernement central stable a été remplacé par des nomarques individuels régnant sur leurs provinces distinctes. Le roi était toujours respecté et les impôts étaient envoyés à la capitale, Memphis, mais les nomarques et le peuple en général disposaient d'une plus grande autonomie qu'auparavant. Ce changement de modèle de gouvernement a permis une plus grande liberté d'expression dans l'art, l'architecture et l'artisanat, car il n'y avait plus d'idéal imposé par l'État sur la façon dont les dieux, les rois ou les animaux devaient être représentés ; chaque région était libre de créer n'importe quel type d'art qui lui plaisait.
Le changement a également entraîné une démocratisation des biens et des services. Alors qu'auparavant seul le roi pouvait s'offrir certains luxes, ceux-ci étaient désormais accessibles à la petite noblesse, aux fonctionnaires de la cour, aux bureaucrates et aux gens ordinaires. La production de masse de biens tels que la statuaire et la céramique a commencé et ceux qui n'avaient pas pu s'offrir le luxe d'un beau tombeau avec des inscriptions au cours de l'Ancien Empire ont désormais découvert qu'ils le pouvaient. Tout comme le roi avait autrefois son tombeau orné des textes des pyramides, désormais n'importe qui pouvait avoir la même chose grâce aux textes du cercueil.
Les textes de cercueil ont été développés pour répondre au besoin d'une nouvelle compréhension de l'au-delà et de la place des gens ordinaires dans celle-ci. L'égyptologue Helen Strudwick explique leur objectif : « Les textes, un recueil de textes rituels, d'hymnes, de prières et de formules magiques, destinés à aider le défunt dans son voyage vers l'au-delà, provenaient des Textes des Pyramides, une séquence de textes pour la plupart obscurs. sorts gravés sur les murs intérieurs des pyramides de l'Ancien Empire. Les textes des pyramides étaient exclusivement destinés au roi et à sa famille, mais les textes du cercueil étaient principalement utilisés par la noblesse et les hauts fonctionnaires, ainsi que par les gens ordinaires qui pouvaient se permettre de les faire copier. Les textes du cercueil signifiaient que n'importe qui, quel que soit son rang et avec l'aide de divers sorts, pouvait désormais avoir accès à l'au-delà.
Durant l’Ancien Empire, seul le roi avait la garantie d’une existence continue dans l’autre monde. Cependant, à partir de la Première Période Intermédiaire, les individus ordinaires étaient désormais considérés comme tout aussi dignes de la vie éternelle que la royauté. Cette époque a toujours été présentée à tort comme une période de chaos et de conflits, mais en réalité, ce fut une période de croissance culturelle et artistique énorme. Les chercheurs qui prétendent qu'il s'agissait d'un « âge sombre » suite à un effondrement monumental du gouvernement citent souvent comme preuve le manque de projets de construction impressionnants et la moindre qualité des arts et de l'artisanat.
En fait, il n’y a pas eu de grandes pyramides ni de temples construits simplement parce qu’il n’y avait pas d’argent pour les construire et pas de gouvernement central fort pour les commander et les organiser, et la différence dans la qualité de l’artisanat est due à la pratique de la production de masse de biens. Il existe à cette époque de nombreuses preuves de tombes élaborées et de belles œuvres d'art qui montrent comment ceux qui étaient autrefois considérés comme des « gens ordinaires » pouvaient désormais s'offrir le luxe de la royauté et pouvaient également se rendre au paradis tout comme le roi le pouvait.
La démocratisation de l’au-delà est due en grande partie à la popularité du mythe d’Osiris. Osiris était le premier-né des dieux après l'acte de création, et avec sa sœur-épouse Isis, il fut le premier roi d'Égypte jusqu'à son assassinat par son frère jaloux Seth. Isis a réussi à ramener Osiris à la vie, mais il était incomplet et est donc descendu pour régner sur le monde souterrain en tant que Seigneur et Juge des Morts.
Le culte d'Osiris devint de plus en plus populaire au cours de la Première Période Intermédiaire, car il était considéré comme le « Premier des Occidentaux », le premier parmi les morts, qui promettait la vie éternelle à ceux qui croyaient en lui. Quand Isis l'a ramené d'entre les morts, elle a demandé l'aide de sa sœur, Nephthys, pour chanter les incantations magiques, et cette partie du mythe a été reconstituée lors des fêtes d'Osiris (et aussi lors des funérailles) à travers Les Lamentations de Isis et Nephthys, une performance d'appel et de réponse de deux femmes jouant le rôle des divinités pour appeler Osiris à l'événement. Le festival était une reconstitution rituelle de la résurrection et tous ceux qui y assisteraient participeraient spirituellement à cette renaissance.
Les sorts et incantations du texte du cercueil font référence à de nombreux dieux (notamment Amon-Ra, Shu, Tefnut et Thoth) mais s'appuient systématiquement sur le mythe d'Osiris. Le sort 74 (Un sort pour la renaissance d'Osiris) recrée la partie de l'histoire dans laquelle Isis et Nephthys ramènent Osiris à la vie : « Ah, impuissant ! Ah, impuissant, endormi ! Ah, impuissant dans cet endroit que vous ne connaissez pas ; pourtant je le sais ! Voici, je t'ai trouvé couché à tes côtés, le grand Apathique. « Ah, ma sœur ! dit Isis à Nephthys : "Voici notre frère, Viens, relevons sa tête, Viens, rejoignons ses os, Viens, remontons ses membres, Viens, mettons fin à tous ses malheurs, que, dans la mesure où nous pouvons l'aider, il ne se lassera plus.
Bien que ces paroles soient adressées à Osiris, on pensait désormais qu’elles s’appliquaient également à l’âme du défunt. Tout comme Osiris est revenu à la vie grâce aux incantations des sœurs, l'âme se réveillerait après la mort et continuerait, espérons-le, à être justifiée et autorisée à entrer au paradis. L'âme des morts a participé à la résurrection d'Osiris parce qu'Osiris avait fait partie du voyage de l'âme sur terre, lui avait insufflé la vie et faisait également partie de la terre, des récoltes, de la rivière, de la maison que la personne connaissait. vie. Le sort 330 déclare : « Que je vive ou que je meurs, je suis Osiris. J'entre et réapparaît à travers toi. Je me décompose en toi. Je grandis en toi... Je couvre la terre... Je ne suis pas détruit".
Renforcée par Osiris, l'âme pourrait commencer son voyage à travers l'au-delà. Cependant, comme pour tout voyage dans un pays jamais visité, une carte et des indications étaient considérées comme utiles. Le Livre des Deux Voies (ainsi appelé parce qu'il donnait deux itinéraires, par terre et par eau, vers l'au-delà) montrait des cartes, des rivières, des canaux et les meilleurs moyens à prendre pour éviter le Lac de Feu et d'autres pièges du voyage. Le chemin à travers le monde souterrain était périlleux et il serait difficile pour une âme nouvellement arrivée de savoir où aller. Les Textes du Cercueil assuraient à l’âme qu’elle pourrait atteindre sa destination en toute sécurité. Strudwick écrit : « La connaissance des sorts et la possession de la carte signifiaient que le défunt, comme les pharaons du passé, pouvait surmonter les dangers du monde souterrain et atteindre la vie éternelle ».
On s'attendait à ce que l'âme ait vécu une vie digne de continuité, sans péché, et qu'elle soit justifiée par Osiris. Les instructions tout au long du texte supposent que l'âme sera jugée digne et qu'elle reconnaîtra les amis ainsi que les menaces. Le sort 404 se lit comme suit : « Il (l'âme) arrivera par une autre porte. Il trouvera là les compagnes sœurs et elles lui diront : « Viens, nous souhaitons t'embrasser. » Et ils couperont le nez et les lèvres à quiconque ne connaît pas leurs noms. » Si l’âme ne parvenait pas à reconnaître Isis et Nephthys, alors cela n’avait clairement pas été justifié et elle subirait donc l’une des nombreuses punitions possibles. Le sort 404 fait référence à l'âme arrivant à une porte et il y en aurait beaucoup le long de son chemin ainsi que diverses divinités que l'on voudrait éviter ou apaiser.
Tout comme les textes eux-mêmes représentent la démocratisation de l’au-delà, les toiles sur lesquelles ils ont été peints le sont aussi. Les grands sarcophages de l'Ancien Empire furent généralement remplacés par des cercueils plus simples au cours de la Première Période Intermédiaire. Celles-ci seraient plus ou moins élaborées selon la richesse et le statut du défunt. L'égyptologue Rosalie David note : « Les premiers cercueils étaient faits de cartonnage (une sorte de papier mâché fabriqué à partir de papyrus et de gomme) ou de bois, mais, à l'Empire du Milieu, les cercueils en bois sont devenus de plus en plus courants. Plus tard, certains cercueils étaient en pierre ou en poterie et même (généralement pour la royauté) en or ou en argent.
Les scribes peignaient soigneusement ces cercueils avec le texte, y compris des illustrations de la vie de la personne sur terre. L’une des fonctions principales des textes des pyramides était de rappeler au roi qui il avait été de son vivant et ce qu’il avait accompli. Lorsque son âme se réveillerait dans le tombeau, il verrait ces images et le texte qui les accompagne et serait capable de se reconnaître ; ce même paradigme a été adopté dans les textes Coffin. Chaque espace disponible du cercueil était utilisé pour les textes, mais ce qui était écrit différait d'une personne à l'autre. Il y avait généralement, mais pas toujours, des illustrations représentant la vie d'une personne, des frises horizontales de diverses offrandes, des textes verticaux décrivant les objets nécessaires dans l'au-delà et des instructions sur la façon dont l'âme devait voyager.
Les textes ont été écrits à l'encre noire, mais le rouge a été utilisé pour mettre l'accent ou pour décrire les forces démoniaques et dangereuses. Geraldine Pinch décrit une partie de ce voyage : « Le défunt devait traverser la mystérieuse région de Rosetau où gisait le corps d'Osiris entouré de murs de flammes. Si l’homme ou la femme décédé s’en montrait digne, il pourrait se voir accorder une nouvelle vie au paradis. »
Dans les époques ultérieures, cette nouvelle vie serait accordée si l'on était justifié dans la Salle de la Vérité, mais lorsque les Textes du Cercueil furent écrits, il semble que l'on passa par un feu rédempteur autour du corps d'Osiris. Le culte d'Osiris est devenu le culte d'Isis à l'époque du Nouvel Empire d'Égypte et son rôle en tant que puissance derrière sa résurrection a été souligné. Le Livre des Morts égyptien a ensuite remplacé les textes du cercueil comme guide vers l'au-delà. Même si les tombes et les cercueils portaient encore des sorts, le Livre des Morts égyptien servirait à diriger l'âme vers le paradis pour le reste de l'histoire de l'Égypte. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: La confession négative (également connue sous le nom de déclaration d'innocence) est une liste de 42 péchés que l'âme du défunt peut honnêtement dire qu'elle n'a jamais commis lorsqu'elle est jugée dans l'au-delà. La liste la plus célèbre provient du Papyrus d'Ani, un texte du Livre des Morts égyptien, préparé pour le prêtre Ani de Thèbes (vers 1250 avant JC) et inclus parmi les objets funéraires de sa tombe. Il comprend un certain nombre de chapitres du Livre des Morts, mais pas tous. Ces omissions ne sont pas une erreur et des sections du manuscrit n'ont pas été perdues, mais sont le résultat d'une pratique courante consistant à créer un texte funéraire spécifiquement destiné à l'usage d'une certaine personne dans l'au-delà. La confession négative incluse dans ce texte suit ce même paradigme car elle aurait été écrite pour Ani, pas pour quelqu'un d'autre.
Bien que le Livre égyptien des morts soit souvent décrit comme « l’ancienne Bible égyptienne » ou comme un « livre occulte » effrayant, ce n’est en réalité ni l’un ni l’autre ; c'est un texte funéraire qui instruit l'âme dans l'au-delà. La traduction actuelle du titre de l'ouvrage est The Book of Coming Forth by Day. Étant donné que les anciens Égyptiens croyaient que l'âme était éternelle et que la vie sur terre n'était qu'un bref aspect d'un voyage éternel, il était considéré comme vital que l'âme dispose d'une sorte de guide pour naviguer dans la phase suivante de l'existence.
Sur terre, il était entendu que si l’on ne savait pas où l’on allait, on ne pouvait pas arriver à la destination souhaitée. Les Égyptiens, éminemment pratiques, pensaient que l’on aurait besoin d’un guide dans l’au-delà, tout comme sur terre. Le Livre des Morts égyptien est un tel guide et a été fourni à toute personne ayant les moyens de s'en faire fabriquer un. Les pauvres devaient se passer d'un texte ou d'un ouvrage rudimentaire mais quiconque en avait les moyens payait un scribe pour créer un guide personnalisé. La Confession est importante pour les égyptologues modernes dans la compréhension des valeurs culturelles égyptiennes anciennes du Nouvel Empire.
La confession négative apparaît dans le sort 125 qui est de loin le plus célèbre car il comprend la vignette qui l'accompagne de la pesée du cœur sur la balance contre la plume blanche de ma'at. Bien que le sort ne décrive pas le jugement dans la Salle des Deux Vérités, l'illustration est destinée à montrer à quoi l'âme pouvait s'attendre une fois arrivée là-bas et le texte fournissait à cette âme quoi dire et comment se comporter. La Confession est importante pour les égyptologues modernes dans la compréhension des valeurs culturelles égyptiennes antiques du Nouvel Empire (vers 1570-1069 av. J.-C.), mais au moment où elle a été écrite, elle aurait été considérée comme nécessaire pour pouvoir porter un jugement avant Osiris et le tribunal divin.
On pense que la Confession s'est développée à partir d'un rituel d'initiation au sacerdoce. Les prêtres, prétend-on, devraient réciter une sorte de liste formelle afin de prouver qu'ils sont rituellement purs et dignes de leur vocation. Bien que certaines preuves existent pour étayer cette affirmation, la confession négative telle qu'elle existe semble s'être développée dans le Nouvel Empire d'Égypte, lorsque le culte d'Osiris était pleinement intégré dans la culture égyptienne, comme moyen permettant au défunt de se justifier comme étant digne de le paradis dans l'au-delà.
Les textes funéraires étaient écrits en Égypte depuis l'époque de l'Ancien Empire (vers 2613-2181 avant JC), lorsque les textes des pyramides étaient inscrits sur les murs des tombes. Les textes de cercueil ont suivi plus tard dans la première période intermédiaire (2181-2040 avant JC) et ont été développés pour le Livre des Morts égyptien dans le Nouvel Empire. Le but de ces textes était d'orienter et de rassurer l'âme du défunt une fois réveillé dans son tombeau suite aux funérailles. L’âme ne serait pas habituée au monde extérieur au corps et aurait besoin de se rappeler qui elle avait été, ce qu’elle avait fait et ce qu’elle devrait faire ensuite.
Dans la plupart des représentations, l'âme serait conduite hors du tombeau par Anubis pour se présenter en jugement devant Osiris, Thot et les 42 juges. Les représentations de ce processus montrent les âmes des morts alignées, administrées par diverses divinités telles que Qebhet, Nephthys, Isis et Serket, pendant qu'elles attendent leur tour pour se présenter devant Osiris et ses écailles dorées. Quand son tour est venu, on se tenait devant les dieux et récitait la confession négative - chacun adressé à un juge spécifique - puis remet son cœur pour être pesé dans les soldes. C’est précisément pour cette raison que le cœur physique était toujours laissé dans le corps du cadavre pendant le processus d’embaumement et de momification. On pensait que le cœur contenait le caractère, la personnalité et l'intellect d'une personne et qu'il devrait être soumis aux dieux dans l'au-delà pour jugement.
Le cœur était placé sur la balance en balance avec la plume blanche de la vérité et, s'il se révélait plus léger, on s'en allait vers le paradis ; s'il était plus lourd, il tombait sur le sol où il était mangé par le monstre Amut et l'âme cessait alors d'exister. Avant ce jugement final et la récompense ou le châtiment de chacun, Osiris, Thot et Anubis s'entretiendraient avec les 42 juges. C'est à ce moment-là que des allocations pourraient être faites. Les 42 juges représentaient les aspects spirituels des 42 nomes (districts) de l'Égypte ancienne et on pense que chacune des confessions traitait d'un certain type de péché qui aurait été particulièrement offensant dans un nome spécifique. Si les juges estimaient qu'une personne avait été plus vertueuse qu'improbable, il était recommandé que l'âme soit justifiée et autorisée à mourir.
Les détails de ce qui s’est passé ensuite varient d’une époque à l’autre. Dans certaines périodes, l'âme devait affronter certains dangers et pièges pour atteindre le paradis tandis que, dans d'autres, on marchait simplement jusqu'au lac Lily après le jugement et, après une épreuve finale, on était emmené au paradis. Une fois là-bas, l'âme jouirait d'une éternité dans un monde qui reflétait parfaitement sa vie sur terre. Tout ce que l'on pensait perdu serait restitué, et les âmes vivraient en paix les unes avec les autres et avec les dieux, profitant de tous les meilleurs aspects de la vie pour l'éternité. Cependant, avant de pouvoir atteindre ce paradis, la confession négative devait être acceptée par les dieux, ce qui signifiait qu'il fallait être capable de penser sincèrement ce qui était dit.
Il n’existe pas de confession négative standard. La confession du Papyrus d'Ani est la plus connue uniquement parce que ce texte est si célèbre et si souvent reproduit. Comme indiqué, les scribes adaptaient un texte à chaque individu, et ainsi, bien qu'il y ait un nombre standard de 42 confessions, les péchés répertoriés variaient d'un texte à l'autre. Par exemple, dans le Papyrus d'Ani, la confession numéro 15 est : « Je ne suis pas un homme de tromperie », tandis qu'ailleurs, il est « Je n'ai pas ordonné de tuer », et dans un autre : « Je n'ai pas été querelleur en affaires ». Un officier militaire ne serait pas en mesure de prétendre honnêtement : « Je n'ai pas ordonné de tuer », pas plus qu'un juge ou un roi, et le « péché » serait donc omis de sa confession.
L'âme recevait une liste qu'elle pouvait dire honnêtement devant les dieux au lieu d'un inventaire standard des péchés que tout le monde devrait réciter. Il ne s'agissait pas tant de peser l'aveu en faveur du défunt que de s'assurer que l'on ne se condamne pas en parlant faussement. Après tout, le cœur serait toujours pesé dans la balance et toute tromperie serait connue. L’âme disposait donc d’une liste qu’elle pouvait dire honnêtement devant les dieux au lieu d’un inventaire standard des péchés que tout le monde devrait réciter.
Pourtant, il y a des péchés standards dans chaque liste, tels que « Je n'ai pas volé », « Je n'ai pas calomnié », « Je n'ai pas causé de douleur » et d'autres affirmations similaires. On pense également que ces déclarations contenaient dans de nombreux cas des stipulations tacites. Dans certains textes, la confession 10 dit : « Je n'ai fait pleurer personne », mais c'est une affirmation très difficile à faire car on n'a souvent aucune idée de la manière dont nos actions ont affecté les autres. On pense donc que l’intention de l’affirmation est « Je n’ai intentionnellement fait pleurer personne ». La même chose pourrait être dite pour une affirmation telle que « Je n’ai fait souffrir personne » et pour la même raison. Le but de la confession était de pouvoir honnêtement revendiquer l'innocence d'actions contraires au principe de ma'at, et donc, quels que soient les péchés spécifiques inclus, il fallait pouvoir dire qu'on était innocent d'avoir délibérément contesté le principe directeur de l’harmonie et de l’équilibre dans la vie.
Maât était la valeur culturelle centrale de l'Égypte ancienne qui permettait à l'univers de fonctionner comme il le faisait. En faisant cette confession, l’âme déclarait qu’elle avait adhéré à ce principe et que tout échec n’était pas intentionnel. Dans la confession suivante, Ani s'adresse à chacun des 42 juges dans l'espoir qu'ils reconnaîtront ses intentions dans la vie, même s'il n'a pas toujours choisi la bonne action au bon moment. Il n'était pas censé considérer les « péchés d'omission », mais seulement les « péchés de commission » poursuivis intentionnellement.
La traduction suivante est réalisée par EA Wallis Budge à partir de son travail original sur Le Livre égyptien des morts. Chaque aveu est précédé d'une salutation adressée à un juge spécifique et à la région dont il est originaire. Certaines de ces régions, cependant, ne se trouvent pas sur terre mais dans l’au-delà. Hraf-Haf, par exemple, salué dans le numéro 12, est le passeur divin de l'au-delà. Dans le cas d'Ani, les 42 nomes ne sont donc pas entièrement représentés (certains, en fait, sont mentionnés deux fois), mais le nombre standard de 42 est toujours respecté. Avant de commencer la confession, l'âme saluait Osiris, affirmait qu'elle connaissait les noms des 42 juges et proclamait son innocence de tout acte répréhensible, en terminant par la déclaration "Je n'ai pas appris ce qui ne l'est pas". Cela signifie que la personne n'a jamais perdu la foi ni entretenu une croyance contraire à la vérité de maât et à la volonté des dieux.
1. Salut, Usekh-nemmt, qui viens d'Anu, je n'ai pas commis de péché. 2. Hail, Hept-Khet, qui vient de Kher-Aha, je n'ai pas commis de vol avec violence. 3. Salut, Fenti, qui viens de Khemenu, je n'ai pas volé. 4. Salut, Am-khaibit, qui viens de Qernet, je n'ai tué ni hommes ni femmes. 5. Salut, Neha-her, qui vient de Rasta, je n'ai pas volé de grain. 6. Salut, Ruruti, qui viens du Ciel, je n'ai pas volé d'offrandes. 7. Salut, Arfi-em-khet, qui viens de Suat, je n'ai pas volé la propriété de Dieu. 8. Salut, Néba, qui va et vient, je n'ai pas menti. 9. Salut, Set-qesu, qui viens de Hensu, je n'ai pas emporté de nourriture. 10. Salut, Utu-nesert, qui viens de Het-ka-Ptah, je n'ai pas prononcé de malédictions.
11. Salut, Qerrti, qui viens d'Amentet, je n'ai pas commis d'adultère. 12. Salut, Hraf-haf, qui sors de ta caverne, je n'ai fait pleurer personne. 13. Salut, Basti, qui viens de Bast, je n'ai pas mangé le cœur. 14. Salut, Ta-retiu, qui sors de la nuit, je n'ai attaqué personne. 15. Salut, Unem-snef, qui sors de la chambre d'exécution, je ne suis pas un homme trompeur. 16. Salut, Unem-besek, qui viens de Mabit, je n'ai pas volé de terre cultivée. 17. Salut, Neb-Maat, qui vient de Maati, je n'ai pas été un indiscret. 18. Salut, Tenemiu, qui viens de Bast, je n'ai calomnié personne. 19. Salut, Sertiu, qui viens d'Anu, je ne me suis pas mis en colère sans juste cause. 20. Salut, Tutu, qui viens d'Ati, je n'ai débauché la femme d'aucun homme.
21. Salut, Uamenti, qui sors de la chambre de Khebt, je n'ai pas débauché les femmes des autres hommes. 22. Salut, Maa-antuf, qui sort de Per-Menu, je ne me suis pas pollué. 23. Salut, Her-uru, qui vient de Nehatu, je n'ai terrorisé personne. 24. Salut, Khemiu, qui viens de Kaui, je n'ai pas transgressé la loi. 25. Salut, Shet-kheru, qui viens d'Urit, je n'ai pas été en colère. 26. Salut, Nekhenu, qui viens de Heqat, je n'ai pas fermé mes oreilles aux paroles de vérité. 27. Salut, Kenemti, qui vient de Kenmet, je n'ai pas blasphémé. 28. Salut, An-hetep-f, qui vient de Sau, je ne suis pas un homme violent. 29. Salut, Sera-kheru, qui vient d'Unaset, je n'ai pas été un provocateur de conflits. 30. Salut, Neb-heru, qui vient de Netchfet, je n'ai pas agi avec une précipitation excessive.
31. Salut, Sekhriu, qui vient d'Uten, je ne me suis pas ingéré dans les affaires des autres. 32. Hail, Neb-Abui, qui découle de Sauti, je n'ai pas multiplié mes mots en parlant. 33. Salut, Nefer-Tem, qui viens de Het-ka-Ptah, je n'ai fait de tort à personne, je n'ai fait aucun mal. 34. Salut, Tem-Sepu, qui viens de Tetu, je n'ai pas pratiqué la sorcellerie contre le roi. 35. Salut, Ari-em-ab-f, qui vient de Tebu, je n'ai jamais arrêté l'écoulement de l'eau d'un voisin. 36. Salut, Ahi, qui viens de Nu, je n'ai jamais élevé la voix. 37. Salut, Uatch-rekhit, qui viens de Sau, je n'ai pas maudit Dieu. 38. Salut, Neheb-ka, qui sors de ta caverne, je n'ai pas agi avec arrogance. 39. Salut, Neheb-Nefert, qui sors de ta caverne, je n'ai pas volé le pain des dieux. 40. Salut, Tcheser-tep, qui sors du sanctuaire, je n'ai pas emporté les gâteaux de khenfu des esprits des morts. 41. Salut, An-af, qui viens de Maati, je n'ai pas arraché le pain de l'enfant, ni traité avec mépris le dieu de ma ville. 42. Salut, Hetch-abhu, qui viens de Ta-she, je n'ai pas tué le bétail appartenant au dieu.
Comme indiqué, bon nombre d'entre eux comporteraient la stipulation d'intention - telle que "Je n'ai jamais élevé la voix" - dans la mesure où une personne peut avoir effectivement élevé la voix, mais pas dans un contexte de colère injustifiée. On pourrait dire la même chose de « Je n'ai pas multiplié mes mots en parlant » qui ne renvoie pas nécessairement à la verbosité mais à la duplicité. Ani dit qu'il n'a pas essayé d'obscurcir sa signification par des jeux de mots. Cette même considération devrait être utilisée avec des affirmations comme le numéro 14 – « Je n’ai attaqué personne » – dans la mesure où la légitime défense était justifiée.
Des affirmations telles que 13 et 22 (« Je n'ai pas mangé le cœur » et « Je ne me suis pas pollué ») font référence à la pureté rituelle dans la mesure où l'on n'a participé à aucune activité interdite par les dieux. Cependant, le numéro 13 pourrait également être destiné à affirmer que l'on n'a pas caché ses sentiments ou prétendu être quelque chose que l'on n'était pas. Le numéro 22 est parfois traduit par « Je ne me suis pas pollué, je n'ai pas couché avec un homme » tout comme le numéro 11, traitant de l'adultère, ajoute parfois le même vers.
Ces lignes ont été citées comme une condamnation de l’homosexualité dans l’Égypte ancienne, mais de telles affirmations ignorent l’accent central de la confession négative sur l’individu. Il est peut-être mal pour Ani d’avoir des relations sexuelles avec un homme, mais pas pour quelqu’un d’autre de faire de même. L'ivresse était approuvée dans l'Égypte ancienne, tout comme les relations sexuelles avant le mariage, mais seulement sous certaines conditions : on pouvait se saouler autant qu'on le souhaitait lors d'un festival ou d'une fête, mais pas au travail, et on pouvait avoir autant de relations sexuelles avant le mariage qu'on le souhaitait, mais pas. avec une personne déjà mariée. Il en va peut-être de même pour les relations homosexuelles. Nulle part dans la littérature égyptienne ou dans les textes religieux l’homosexualité n’est condamnée
Les Égyptiens valorisaient l'individualité. Leurs rituels mortuaires et leur vision de l’au-delà reposaient sur ce concept même. Les inscriptions sur les tombes, les monuments, les autobiographies, la Grande Pyramide elle-même étaient autant d'expressions de la vie et des réalisations d'un individu. La confession négative a suivi ce même modèle car elle s'est adaptée au caractère, au style de vie et à la vocation de chaque personne. On espérait que tous ceux qui le méritaient seraient justifiés dans l'au-delà et qu'il serait reconnu, quels que soient leurs échecs personnels, qu'ils devraient être autorisés à poursuivre leur voyage vers le paradis. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Shabti Dolls (Ushabti) : La main-d'œuvre dans l'au-delà. Les Égyptiens croyaient que l’au-delà était le reflet de la vie sur terre. Lorsqu'une personne mourait, son voyage individuel ne prenait pas fin mais était simplement transféré du plan terrestre à l'éternel. L'âme se tenait en jugement dans la salle de la vérité devant le grand dieu Osiris et les quarante-deux juges et, lors de la pesée du cœur, si sa vie sur terre était jugée digne, cette âme passait au paradis du Champ de Roseaux.
L'âme fut emmenée avec d'autres qui avaient également été justifiés à travers le lac Lily (également connu sous le nom de lac des fleurs) jusqu'à un pays où l'on retrouvait tout ce qu'on croyait perdu. Là, on retrouverait sa maison, telle qu'on l'avait quittée, ainsi que tous les proches décédés plus tôt. Chaque détail dont on a profité au cours de son voyage terrestre, jusqu'à son arbre préféré ou son animal de compagnie le plus aimé, accueillerait l'âme à son arrivée. Il y avait de la nourriture et de la bière, des réunions entre amis et en famille, et chacun pouvait poursuivre tous les passe-temps qu'il avait appréciés dans la vie.
Conformément à ce concept d’image miroir, il y avait aussi du travail dans l’au-delà. Les anciens Égyptiens étaient très travailleurs et leur travail était très apprécié par la communauté. Les gens, bien sûr, occupaient un emploi pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, mais travaillaient également pour la communauté. Le service communautaire était obligatoire pour « redonner » à la société qui nous fournissait tout. La valeur religieuse et culturelle de ma'at (harmonie) dictait que chacun devait penser aux autres aussi haut qu'à soi-même et que chacun devait contribuer au bénéfice de l'ensemble.
Les grands projets de construction des rois, comme les pyramides, étaient construits par des artisans qualifiés, et non par des esclaves, qui étaient soit payés pour leurs compétences, soit donnaient de leur temps pour le bien commun. Si, en raison d'une maladie, d'une obligation personnelle ou simplement d'un manque de désir de s'y conformer, on ne pouvait pas remplir cette obligation, on pouvait envoyer quelqu'un d'autre travailler à sa place - mais on ne pouvait le faire qu'une seule fois. Sur terre, la place d'une personne était occupée par un ami, un parent ou une personne payée pour prendre sa place ; dans l'au-delà, cependant, la place était prise par une poupée shabti.
Les poupées Shabti (également connues sous le nom de shawbti et ushabti) étaient des figures funéraires de l'Égypte ancienne qui accompagnaient le défunt dans l'au-delà. Leur nom est dérivé de l'égyptien swb pour bâton mais correspond également au mot pour « réponse » (wsb) et ainsi les shabtis étaient connus sous le nom de « Ceux qui répondent ». Les personnages, en forme de momies adultes, mâles ou femelles, apparaissent dans les tombes où ils représentaient le défunt et étaient en pierre, en bois ou en faïence. Les figures, en forme de momies adultes, mâles ou femelles, apparaissent très tôt dans les tombes (quand elles représentaient le défunt) et, à l'époque du Nouvel Empire (1570-1069 av. J.-C.), elles étaient en pierre ou en bois (à la fin de la période, elles étaient composés de faïences) et représentaient un « ouvrier » anonyme.
Chaque poupée portait un « sortilège » (connu sous le nom de formule shabti) qui précisait la fonction de cette figure particulière. Le plus célèbre de ces sorts est le sort 472 des textes du cercueil qui datent d'environ 2143-2040 avant JC. Les citoyens étaient obligés de consacrer une partie de leur temps chaque année à travailler pour l'État sur les nombreux projets de travaux publics que le pharaon avait décrétés en fonction de leur volonté. une compétence particulière et un shabti refléterait cette compétence ou, s'il s'agissait d'une « poupée ouvrière » générale, une compétence considérée comme importante.
Alors que les Égyptiens considéraient l'au-delà comme une continuation de l'existence terrestre (mais mieux dans la mesure où elle n'incluait ni maladie ni, bien sûr, mort), on pensait que le dieu des morts, Osiris, aurait ses propres projets de travaux publics en cours. et le but du shabti était alors de « répondre » du défunt lorsqu'il était appelé à travailler. Leur fonction est clairement indiquée dans le Livre égyptien des morts (également connu sous le nom de Livre de la venue le jour) qui est une sorte de manuel (daté d'environ 1550-1070 av. J.-C.) destiné aux défunts et fournissant des conseils dans le domaine inconnu de la vie après la mort.
Le Livre des Morts contient des sorts qui doivent être prononcés par l'âme à différents moments et dans différents buts dans l'au-delà. Il existe des sorts pour invoquer une protection, pour se déplacer d'une zone à une autre, pour justifier ses actions dans la vie, et même un sort « pour faire sortir les paroles stupides de la bouche » (Sort 90). Parmi ces versets se trouve le Spell Six qui est connu sous le nom de « Sort pour amener un shabti à faire du travail pour un homme dans le royaume des morts ». Ce sort est une version reformulée du sort 472 des textes de cercueil. Lorsque l'âme était appelée dans l'au-delà pour travailler pour Osiris, elle récitait ce sort et le shabti prenait vie et accomplissait son devoir en remplacement.
Le sort se lit comme suit : "Ô shabti, qui m'est attribué, si je suis convoqué ou si je suis chargé d'effectuer un travail qui doit être effectué dans le royaume des morts ; si en effet des obstacles vous sont imposés en tant qu'homme à son fonctions, vous vous détaillerez pour moi à chaque occasion de rendre arable les champs, d'inonder les berges ou de transporter du sable d'est en ouest ; « Me voici », direz-vous.
Le shabti serait alors imprégné de vie et prendrait sa place dans la tâche. Tout comme sur terre, cela permettrait à l’âme de vaquer à ses occupations. Si l'on promenait son chien au bord de la rivière ou si l'on profitait de son temps sous un arbre préféré avec un bon livre et du bon pain et de la bière, on pourrait continuer à le faire ; le shabti s'occuperait des tâches qu'Osiris était appelé à accomplir. Chacun de ces shabtis a été créé selon une formule ainsi, par exemple, lorsque le sort ci-dessus fait référence à « rendre les champs arables », le shabti responsable serait façonné avec un outil agricole.
Chaque poupée shabti était sculptée à la main pour exprimer la tâche décrite par la formule shabti et il y avait donc des poupées avec des paniers à la main ou des houes ou des pioches, des ciseaux, selon le travail à effectuer. Les poupées étaient achetées dans les ateliers du temple et le nombre de poupées shabti que l'on pouvait se permettre correspondait à sa richesse personnelle. Dans les temps modernes, le nombre de poupées trouvées dans les tombes fouillées a donc aidé les archéologues à déterminer le statut du propriétaire de la tombe. Les tombes les plus pauvres ne contiennent pas de shabtis mais même celles de taille modeste en contiennent un ou deux et il y a eu des tombes contenant un shabti pour chaque jour de l'année.
Dans la Troisième Période Intermédiaire (vers 1069-747 av. J.-C.), apparut un shabti spécial avec une main sur le côté et l'autre tenant un fouet ; c'était la poupée du surveillant. Durant cette période, les shabti semblent avoir été moins considérés comme des travailleurs de remplacement ou des serviteurs des défunts que comme des esclaves. Le surveillant était chargé de garder dix shabtis au travail et, dans les tombes les plus élaborées, il y avait trente-six figures de surveillant pour les 365 poupées ouvrières. À la Basse Époque (vers 737-332 av. J.-C.), les shabtis continuent d'être placés dans les tombeaux mais la figure du surveillant n'apparaît plus. On ne sait pas exactement quel changement a eu lieu pour rendre la figure du surveillant obsolète, mais quoi qu'il en soit, les poupées shabti ont retrouvé leur ancien statut d'ouvrières et ont continué à être placées dans les tombes pour accomplir les devoirs de leur propriétaire dans l'au-delà. Ces shabtis étaient façonnés comme les premiers avec des outils spécifiques à la main ou à leurs côtés pour toute tâche qu'ils étaient appelés à accomplir.
Les poupées Shabti sont le type d’artefact le plus nombreux à avoir survécu dans l’Égypte ancienne (outre les scarabées). Comme indiqué, ils ont été trouvés dans les tombes de personnes de toutes les classes de la société, des plus pauvres aux plus riches et des plus ordinaires jusqu'au roi. Les poupées shabti de la tombe de Toutankamon étaient finement sculptées et merveilleusement ornées, tandis qu'un shabti provenant de la tombe d'un pauvre fermier était beaucoup plus simple. Peu importe que l’on ait régné sur toute l’Égypte ou cultivé une petite parcelle de terre, car tous étaient égaux devant la mort ; ou presque. Le roi et le fermier étaient tous deux également responsables devant Osiris, mais le temps et les efforts dont ils étaient responsables étaient dictés par le nombre de shabtis qu'ils avaient pu se permettre avant leur mort.
De la même manière que le peuple avait servi le souverain égyptien au cours de sa vie, les âmes étaient censées servir Osiris, le Seigneur des Morts, dans l’au-delà. Cela ne signifierait pas nécessairement qu'un roi ferait le travail d'un maçon, mais la royauté était censée servir au mieux de ses capacités, tout comme elle l'avait été sur terre. Cependant, plus on avait de poupées shabti à sa disposition, plus on pouvait espérer profiter de temps libre dans le Champ des Roseaux. Cela signifiait que si l’on avait été assez riche sur terre pour s’offrir une petite armée de poupées shabti, on pourrait espérer une vie après la mort assez confortable ; et ainsi, le statut terrestre d'une personne se reflétait dans l'ordre éternel, conformément au concept égyptien de l'au-delà comme reflet direct du temps passé sur terre. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Objets funéraires dans l'Egypte ancienne. Le concept de l'au-delà a changé au cours des différentes époques de la très longue histoire de l'Égypte, mais pour l'essentiel, il a été imaginé comme un paradis où l'on vivait éternellement. Pour les Égyptiens, leur pays était l’endroit le plus parfait créé par les dieux pour le bonheur humain. La vie après la mort était donc le reflet de la vie que l'on avait vécue sur terre - jusque dans les moindres détails - avec la seule différence étant l'absence de tous les aspects de l'existence que l'on trouvait désagréables ou douloureux. Une inscription sur l'au-delà parle de la capacité de l'âme de marcher éternellement au bord de son ruisseau préféré et de s'asseoir sous son sycomore préféré, d'autres montrent des maris et des femmes se retrouvant au paradis et faisant tout ce qu'ils faisaient sur terre, comme labourer les champs, récolter le grain, manger et boire.
Cependant, pour profiter de ce paradis, il faudrait les mêmes objets que ceux dont on disposait au cours de sa vie. Les tombes et même les tombes simples contenaient des effets personnels ainsi que de la nourriture et des boissons pour l'âme dans l'au-delà. Ces objets sont connus sous le nom de « biens funéraires » et sont devenus une ressource importante pour les archéologues modernes pour identifier les propriétaires des tombes, les dater et comprendre l'histoire égyptienne. Bien que certaines personnes qualifient cette pratique de « pillage de tombes », les archéologues qui fouillent professionnellement les tombes assurent aux défunts leur objectif premier : vivre éternellement et que leur nom se souvienne éternellement. Selon les croyances des anciens Égyptiens, les objets funéraires placés dans la tombe auraient rempli leur fonction il y a plusieurs siècles.
Des objets funéraires, en plus ou moins grand nombre et de valeur variable, ont été trouvés dans presque toutes les tombes égyptiennes qui n'ont pas été pillées dans l'Antiquité. Les objets que l'on trouverait dans la tombe d'une personne riche seraient similaires à ceux considérés comme précieux aujourd'hui : des objets richement fabriqués en or et en argent, des jeux de société en bois précieux et en pierres précieuses, des lits, des coffres, des chaises, des statues et des vêtements soigneusement travaillés. Le plus bel exemple de tombeau de pharaon, bien sûr, est celui du roi Toutankhamon du 14ème siècle avant JC, découvert par Howard Carter en 1922 après JC, mais de nombreuses tombes ont été fouillées dans toute l'Égypte ancienne qui mettent en évidence le statut social de l'individu qui y est enterré. Même ceux aux moyens modestes incluaient des objets funéraires avec le défunt. Le but principal des objets funéraires n'était pas de montrer le statut de la personne décédée, mais de fournir au défunt ce dont il aurait besoin dans l'au-delà.
Cependant, le but principal des objets funéraires n'était pas de montrer le statut de la personne décédée, mais de fournir au défunt ce dont il aurait besoin dans l'au-delà. La tombe d'une personne riche contiendrait donc plus de biens funéraires - de tout ce que cette personne a favorisé dans la vie - que celle d'une personne plus pauvre. Les aliments préférés étaient laissés dans la tombe, comme du pain et des gâteaux, mais les survivants devaient faire quotidiennement des offrandes de nourriture et de boissons. Dans les tombes des nobles de la classe supérieure et de la royauté, une chapelle d'offrandes était incluse, abritant la table des offrandes. La famille apportait de la nourriture et des boissons à la chapelle et les laissait sur la table. L’âme du défunt absorberait de manière surnaturelle les nutriments des offrandes puis retournerait dans l’au-delà. Cela garantissait le souvenir continu de la personne par les vivants et donc l'immortalité dans la vie suivante.
Si une famille était trop occupée pour s'occuper des offrandes quotidiennes et pouvait se le permettre, un prêtre (connu sous le nom de ka-prêtre ou verseur d'eau) était embauché pour accomplir les rituels. Quelle que soit la manière dont les offrandes étaient faites, il fallait en prendre soin quotidiennement. La célèbre histoire de Khonsemhab et du fantôme (datée du Nouvel Empire d’Égypte vers 1570-1069 avant JC) traite de cette situation précise. Dans l'histoire, le fantôme de Nebusemekh revient se plaindre à Khonsemhab, grand prêtre d'Amon, que son tombeau est tombé en ruine et qu'il a été oublié de sorte que les offrandes ne sont plus apportées. Khonsemhab trouve et répare le tombeau et promet également qu'il veillera désormais à ce que des offrandes soient fournies. La fin du manuscrit est perdue, mais on suppose que l'histoire se termine heureusement pour le fantôme de Nebusemekh. Si une famille devait oublier ses devoirs envers l'âme du défunt, alors elle, comme Khonsemhab, pourrait s'attendre à être hantée jusqu'à ce que ce tort soit réparé et que les offrandes régulières de nourriture et de boissons soient rétablies.
La bière était la boisson couramment fournie avec les objets funéraires. En Égypte, la bière était la boisson la plus populaire – considérée comme la boisson des dieux et l’un de leurs plus grands cadeaux – et constituait un élément de base du régime alimentaire égyptien. Une personne riche (comme Toutankhamon) était enterrée avec des cruches de bière fraîchement brassée, alors qu'une personne plus pauvre ne pourrait pas se permettre ce genre de luxe. Les gens étaient souvent payés en bière, donc en enterrer une cruche avec un être cher serait comparable à quelqu'un qui enterre aujourd'hui son chèque de paie. La bière était parfois brassée spécifiquement pour des funérailles, car elle était prête, du début à la fin, au moment où le cadavre avait subi le processus de momification. Après les funérailles, une fois le tombeau fermé, les personnes en deuil organisaient un banquet en l'honneur du passage du défunt de temps à autre, et le même breuvage qui avait été préparé pour le défunt était apprécié par les invités ; assurant ainsi la communion entre les vivants et les morts.
Parmi les objets funéraires les plus importants se trouvait la poupée shabti. Les Shabti étaient faits de bois, de pierre ou de faïence et étaient souvent sculptés à l'effigie du défunt. Dans la vie, les gens étaient souvent appelés à accomplir des tâches pour le roi, comme superviser ou travailler sur de grands monuments, et ne pouvaient se soustraire à cette tâche que s'ils trouvaient quelqu'un disposé à prendre leur place. Néanmoins, on ne peut pas s'attendre à se soustraire à ses fonctions année après année, et il faut donc une bonne excuse ainsi qu'un travailleur de remplacement.
Puisque la vie après la mort n’était qu’une continuation de la vie actuelle, les gens s’attendaient à être appelés à travailler pour Osiris dans l’au-delà, tout comme ils avaient travaillé pour le roi. La poupée shabti pouvait être animée, une fois passé dans le Champ des Roseaux, pour assumer ses responsabilités. L'âme du défunt pouvait continuer à lire un bon livre ou à aller à la pêche pendant que le shabti s'occupait des travaux à effectuer. Tout comme on ne peut pas se soustraire à ses obligations sur terre, le shabti ne peut pas être utilisé perpétuellement. Une poupée shabti ne pouvait être utilisée qu’une seule fois par an. Les gens commandaient autant de shabti qu'ils pouvaient se le permettre afin de leur offrir plus de loisirs dans l'au-delà.
Les poupées Shabti sont présentes dans les tombes tout au long de l'histoire de l'Égypte. Au cours de la première période intermédiaire (2181-2040 av. J.-C.), ils ont été produits en masse, comme de nombreux objets, et de plus en plus d'objets sont désormais inclus dans les tombes et les tombes de toutes les classes sociales. Les personnes les plus pauvres, bien sûr, ne pouvaient même pas se permettre une poupée shabti générique, mais quiconque le pouvait paierait pour en avoir le plus possible. Une collection de shabtis, un pour chaque jour de l'année, était placée dans la tombe dans une boîte à shabti spéciale qui était généralement peinte et parfois ornée.
Des instructions sur la façon d'animer un shabti dans la vie suivante, ainsi que sur la façon de naviguer dans le royaume qui attend après la mort, étaient fournies à travers les textes inscrits sur les murs des tombes et, plus tard, écrits sur des rouleaux de papyrus. Il s'agit des œuvres connues aujourd'hui sous le nom de Textes des Pyramides (vers 2400-2300 avant JC), de Textes du Cercueil (vers 2134-2040 avant JC) et du Livre des Morts égyptien (vers 1550-1070 avant JC). Les textes des pyramides sont les textes religieux les plus anciens et ont été écrits sur les murs de la tombe pour fournir au défunt assurance et orientation.
Lorsque le corps d'une personne finissait par échouer, l'âme se sentait d'abord piégée et confuse. Les rituels impliqués dans la momification préparaient l'âme à la transition de la vie à la mort, mais l'âme ne pouvait pas partir tant qu'une cérémonie funéraire appropriée n'avait pas été observée. Lorsque l’âme se réveillerait dans le tombeau et sortirait de son corps, elle n’aurait aucune idée de l’endroit où elle se trouvait ni de ce qui s’était passé. Afin de rassurer et de guider le défunt, les Textes des Pyramides et, plus tard, les Textes des Cercueils furent inscrits et peints à l'intérieur des tombes afin que lorsque l'âme se réveillerait dans le cadavre, elle sache où elle se trouvait et où elle devait désormais aller. .
Ces textes se sont finalement transformés en Le Livre égyptien des morts (dont le titre réel est Le Livre de la sortie de jour), qui est une série de sorts dont la personne décédée aurait besoin pour naviguer dans l'au-delà. Le sort 6 du Livre des Morts est une reformulation du sort 472 des textes du cercueil, expliquant à l'âme comment animer le shabti. Une fois que la personne est morte et que l'âme s'est réveillée dans le tombeau, cette âme a été conduite - généralement par le dieu Anubis mais parfois par d'autres - jusqu'à la Salle de la Vérité (également connue sous le nom de Salle des Deux Vérités) où elle a été jugée par le grand dieu Osiris. L'âme prononcerait alors la confession négative (une liste de « péchés » qu'elle pourrait honnêtement dire qu'elle n'avait pas commis, comme « je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas délibérément fait pleurer un autre »), puis le cœur de l'âme serait pesé sur une balance par rapport à la plume blanche de ma'at, le principe d'harmonie et d'équilibre.
Si le cœur s’avérait plus léger que la plume, alors l’âme était considérée comme justifiée ; si le cœur était plus lourd que la plume, il tombait sur le sol où il était dévoré par le monstre Amut, et l'âme cesserait alors d'exister. Il n'y avait pas d'« enfer » pour le châtiment éternel de l'âme dans l'Égypte ancienne ; leur plus grande peur était la non-existence, et tel était le sort de quelqu'un qui avait fait le mal ou avait délibérément échoué à faire le bien.
Si l’âme était justifiée par Osiris alors elle poursuivait son chemin. À certaines époques de l'Égypte, on croyait que l'âme rencontrait alors divers pièges et difficultés qu'elle aurait besoin des sorts du Livre des Morts pour surmonter. Cependant, à la plupart des époques, l'âme quittait la Salle de la Vérité et se rendait sur les rives du Lac Lily (également connu sous le nom de Lac des Fleurs) où elle rencontrait le passeur perpétuellement désagréable connu sous le nom de Hraf-hef ("Celui qui regarde derrière lui-même". ") qui ramerait l'âme à travers le lac jusqu'au paradis du Champ de Roseaux. Hraf-hef était le « test final » car l'âme devait trouver un moyen d'être polie, indulgente et agréable envers cette personne très désagréable afin de traverser.
Une fois le lac traversé, l'âme se retrouverait dans un paradis qui était le reflet de la vie sur terre, à l'exception de toute déception, maladie, perte ou - bien sûr - mort. Dans Le Champ de Roseaux, l'âme retrouvait les esprits de ceux qu'elle avait aimés et morts avant elle, son animal de compagnie préféré, sa maison, son arbre, son ruisseau préféré près desquels elle avait l'habitude de marcher - tout ce qu'elle pensait avoir perdu était restitué, et, de plus, on vivait éternellement en présence directe des dieux.
Retrouver ses proches et vivre éternellement avec les dieux était l'espoir de l'au-delà, mais c'était également le cas d'être accueilli par ses animaux de compagnie préférés au paradis. Les animaux de compagnie étaient parfois enterrés dans leur propre tombe mais, généralement, avec leur maître ou maîtresse. Si l’on avait assez d’argent, on pouvait momifier son chat, son chien, sa gazelle, son oiseau, son poisson ou son babouin et l’enterrer à côté de son cadavre. Les deux meilleurs exemples en sont la grande prêtresse Maatkare Mutemhat (vers 1077-943 av. J.-C.) qui a été enterrée avec son singe de compagnie momifié et la reine Isiemkheb (vers 1069-943 av. J.-C.) qui a été enterrée avec sa gazelle de compagnie.
La momification était cependant coûteuse, et surtout celle pratiquée sur ces deux animaux. Ils ont reçu un traitement de premier ordre lors de leur momification, ce qui représentait bien sûr la richesse de leurs propriétaires. Il y avait trois niveaux de momification disponibles : haut de gamme où l'on était traité comme un roi (et recevait un enterrement à la hauteur de la gloire du dieu Osiris) ; le niveau intermédiaire où l'on était bien traité mais pas très bien ; et le moins cher où l'on recevait un service minimal de momification et d'enterrement. Pourtant, tout le monde – riche ou pauvre – fournissait à ses morts une sorte de préparation du cadavre et des objets funéraires pour l’au-delà.
Les animaux de compagnie étaient très bien traités dans l'Égypte ancienne et étaient représentés dans les peintures funéraires et les objets funéraires tels que les colliers de chien. La tombe de Toutankhamon contenait des colliers de chien en or et des peintures de ses chiens de chasse. Bien que les écrivains modernes prétendent souvent que le chien préféré de Toutankhamon s'appelait Abuwtiyuw, qui a été enterré avec lui, cela est inexact. Abuwtiyuw est le nom d'un chien de l'Ancien Empire d'Égypte qui plut tellement au roi qu'il reçut un enterrement privé et tous les rites dus à une personne de naissance noble. L'identité du roi qui aimait le chien est inconnue, mais le chien du roi Khéops (2589-2566 avant JC), Akbaru, était très admiré par son maître et enterré avec lui.
Les colliers des chiens, qui donnaient souvent leur nom, étaient souvent inclus comme objets funéraires. La tombe du noble Maiherpre, un guerrier qui vécut sous le règne de Thoutmosis III (1458-1425 av. J.-C.) contenait deux colliers de chien en cuir ornés. Ceux-ci étaient teints en rose et décorés d'images. L'un d'eux présente des chevaux et des fleurs de lotus ponctués de clous en laiton tandis que l'autre représente des scènes de chasse et porte gravé le nom du chien, Tantanuit. Ce sont deux des meilleurs exemples du type de travail orné qui servait à fabriquer des colliers pour chiens dans l’Égypte ancienne. En fait, à l’époque du Nouvel Empire, le collier de chien était un type d’œuvre d’art à part entière et digne d’être porté dans l’au-delà en présence des dieux.
Au cours de la période de l'Empire du Milieu égyptien (2040-1782 av. J.-C.), il y a eu un changement philosophique important où les gens ont remis en question la réalité de ce paradis et ont mis l'accent sur le fait de tirer le meilleur parti de la vie, car rien n'existait après la mort. Certains érudits ont émis l'hypothèse que cette croyance était née des troubles de la Première Période Intermédiaire qui ont précédé l'Empire du Milieu, mais il n'existe aucune preuve convaincante de cela. De telles théories sont toujours fondées sur l’affirmation selon laquelle la Première Période Intermédiaire de l’Égypte fut une période sombre de chaos et de confusion, ce qui n’était certainement pas le cas. Les Égyptiens ont toujours insisté sur le fait de vivre pleinement la vie – toute leur culture est basée sur la gratitude pour la vie, le fait de profiter de la vie, d’aimer chaque instant de la vie – donc mettre l’accent sur cela n’était pas nouveau. Ce qui rend la croyance de l’Empire du Milieu si intéressante, cependant, c’est son refus de l’immortalité dans le but de rendre la vie actuelle encore plus précieuse.
La littérature de l'Empire du Milieu exprime un manque de croyance dans la vision traditionnelle du paradis, car les habitants de l'Empire du Milieu étaient plus « cosmopolites » qu'auparavant et tentaient très probablement de se distancier de ce qu'ils considéraient comme une « superstition ». La Première Période Intermédiaire avait élevé les différents districts d'Égypte, rendu leurs expressions artistiques individuelles aussi précieuses que l'art et la littérature mandatés par l'État de l'Ancien Empire égyptien, et les gens se sentaient plus libres d'exprimer leurs opinions personnelles plutôt que de simplement répéter ce qu'ils avaient. été dit. Ce scepticisme disparaît à l'époque du Nouvel Empire et, pour l'essentiel, la croyance au paradis du Champ des Roseaux fut constante tout au long de l'histoire de l'Égypte. Une composante de cette croyance était l'importance des objets funéraires qui serviraient au défunt dans l'au-delà tout aussi bien que sur le plan terrestre. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: À travers les douze chambres de l'enfer : l'au-delà dans l'Égypte ancienne. La mort, croyaient les anciens Égyptiens, n’était pas la fin de nos luttes. Ils croyaient en une vie après la mort et que les dignes iraient au paradis, mais leurs morts ne passaient pas simplement de l'autre côté. S'ils voulaient la vie éternelle, ils devraient se battre pour cela. Les âmes des Égyptiens morts devaient se frayer un chemin à travers les douze chambres de l'enfer, vaincre les démons et les monstres, traverser des lacs de feu et franchir des portes gardées par des serpents cracheurs de feu. Le chemin à travers l’au-delà était violent, brutal et dangereux. Ils pouvaient être tués en enfer, et une mort là-bas signifiait une éternité dans l'oubli. S’ils s’en sortaient indemnes, ils rencontreraient leur jour de jugement. Ils seraient jugés devant les dieux, qui pèsent leur cœur au poids d’une plume. Les dignes pourraient aller au paradis, ou même devenir un dieu – mais les indignes verraient leur cœur jeté aux démons, déchiré en lambeaux et dévoré.
La vision égyptienne de l’au-delà était incroyablement complexe. Nous avons vu les vestiges en décomposition de leur fixation sur la mort : les tombes pyramidales massives qui éclipsaient leurs villes et les corps momifiés enterrés à l'intérieur. Mais il s'agissait bien plus que de simples monuments dédiés à la vanité des rois : ils constituaient des portes d'entrée qui les préparaient à l'au-delà, où les prêtres préparaient leur âme à un voyage incroyable, différent de tout ce qu'ils avaient vécu dans la vie. Selon les Égyptiens, lorsque le corps mourait, deux parties de l’âme se séparaient. L'essence vitale qui constituait l'étincelle et l'énergie d'un homme se levait et se déplaçait, libre de se promener autour de sa tombe et de faire son voyage vers l'au-delà. Mais l’autre partie de l’âme, celle qui portait la personnalité, était laissée derrière, piégée dans le corps sans vie et immobile qui restait sur terre.
Le seul espoir des morts pour la vie éternelle et une âme réunie était de traverser l’enfer et d’affronter le jugement. Si l’essence de leur âme pouvait traverser Duat, le monde souterrain égyptien, et porter un jugement devant les dieux, leurs âmes seraient réunies – mais ce n’était pas un voyage simple, et le temps presse. Si le corps s’effondrait avant que son essence ne traverse le monde souterrain, la partie de l’âme piégée à l’intérieur mourrait. Tout cela ne servirait à rien. Les Égyptiens étaient momifiés pour garder leur âme en vie. Leurs corps devaient rester préservés, sinon leur chance de vie éternelle serait perdue. Ainsi, les embaumeurs égyptiens retiraient leurs organes vitaux et leur cerveau, ne laissant à l’intérieur que le cœur, la demeure de l’âme. Ils drainaient leurs liquides jusqu'à ce que leur corps soit complètement sec, les laissant dans un état qui pourrait être conservé pendant des milliers d'années.
Même après la mort, l’âme emprisonnée à l’intérieur du corps avait besoin de manger. Il pourrait encore mourir de faim – et un sorcier serait alors obligé d’invoquer les dieux pour qu’ils ouvrent la bouche. Une fois le corps enterré, les prêtres accomplissaient un rituel long et compliqué, ouvrant la bouche sur la statue faite à l'image des morts, suppliant les dieux de les laisser manger et laissant à ses pieds des animaux sacrifiés pour que l'âme puisse alimentation. Les rituels leur donnaient une chance d’accéder à la vie éternelle, mais cette procédure était coûteuse. Les pharaons et les riches pouvaient obtenir un tombeau et un embaumeur pour les aider à gagner leur seconde vie, mais aucune protection n'était offerte aux âmes des pauvres. Leur seule option était de transporter leurs morts dans le désert et de les enterrer dans une tombe peu profonde dans l’espoir que l’air sec déshydraterait leurs corps suffisamment longtemps pour atteindre le paradis.
Tandis qu’une partie de l’âme restait dans le corps en décomposition, l’essence de l’âme devait faire son voyage à travers le monde souterrain. Mais ce ne serait pas un voyage facile. Entre la terre et le monde souterrain, croyaient les Égyptiens, il y avait un grand fleuve dans le ciel que même les dieux ne pouvaient pas traverser. La seule personne qui pouvait le franchir était le passeur des dieux, une créature avec des yeux derrière la tête. Le passeur, cependant, n’aidait pas toujours. Parfois, il fallait le convaincre. Et parfois, il fallait le menacer. Lorsqu'un pharaon mourait, les sorciers passaient des jours à lancer des sorts magiques pour aider son âme à pénétrer dans le monde souterrain. Ce seraient des plaisirs divins – et parfois des menaces. Lorsque le pharaon Ounas mourut, ses sorciers ordonnèrent au passeur de le faire traverser, en le menaçant : « Si vous ne parvenez pas à transporter Unas, il sautera et s'assiéra sur l'aile de Thot », l'avertissant que s'il n'obéissait pas, il le ferait. affronter la colère d'un dieu.
Le ferry, cependant, les emmènerait à travers Duat, une terre pleine de dieux, de démons et de monstres, dont beaucoup étaient là pour tuer l'âme qui tentait de passer. Ces créatures s'attaquaient aux âmes des morts, qui devaient les combattre avec de la magie et des armes. Les Égyptiens morts étaient donc souvent enterrés avec des sorts et des amulettes pour les aider à rester dans les mondes inférieurs. Pour traverser Duat, ils franchissaient douze portes impénétrables bordées de lances acérées et gardées par des serpents qui respiraient du venin et du feu. Le seul moyen de passer était de prononcer les noms des gardiens. De nombreux rois seraient enterrés avec ces noms, de peur d’oublier.
Certains ont même été enterrés avec une carte de l'enfer. Cela montrerait un monde semblable à l’Égypte, mais parsemé de merveilles surnaturelles. Aux côtés des cavernes et des déserts, on promettait à un voyageur voyageant à travers Duat de voir des forêts d'arbres turquoise et des lacs de feu. Malgré toutes les terreurs de Duat, cependant, les pharaons eux-mêmes étaient souvent les choses les plus horribles. Durant l’Ancien Empire égyptien, de nombreux rois menaçaient les dieux avant leur mort, les avertissant qu’ils entraient dans leur domaine – et promettant de les massacrer et de cannibaliser leurs corps. Certains pharaons ont laissé des messages dans leurs tombes, avertissant les dieux de l’arrivée d’un roi qui « se nourrit des dieux ». L’un d’eux promit que trois dieux égyptiens allaient attacher leurs frères et leur arracher les entrailles pour que le pharaon puisse les cuisiner et les manger.
Manger un dieu donnerait aux pharaons la force de traverser le monde souterrain. Ils pouvaient voler les pouvoirs divins et les connaissances d'un dieu en mordant une divinité mineure – ou, comme l'avait promis un pharaon, en dévorant son cœur, en lui brisant les os et en lui suçant la moelle. Si les âmes pouvaient franchir les douze portes, elles arriveraient au royaume d'Osiris, le dieu des morts. Ici, ils devraient plaider qu’ils avaient vécu une vie bonne et juste en niant avoir commis une série de 42 péchés. Ensuite, leurs cœurs étaient pesés contre la plume de Maât, symbole de bonté, pour voir s'ils étaient vraiment purs.
Les innocents ont retrouvé la partie de l’âme laissée dans le corps. Ils obtiendraient la vie éternelle et le passage au paradis, où ils vivraient avec les dieux dans un pays où les champs poussaient en abondance sans fin. Mais même ici, une âme pourrait connaître sa fin. Si les dieux vous jugeaient méchant, votre cœur serait jeté vers le Dévoreur, une créature à la fois lion, hippopotame et crocodile. Leurs âmes seraient alors jetées dans un puits de feu et elles seraient effacées dans l’oubli. Le voyage vers le paradis, pour les Égyptiens, n’était pas un chemin facile, mais il était bien plus facile pour un pharaon que pour un homme ordinaire. Il n’y avait pas d’égalité dans l’au-delà. Même au paradis, un roi deviendrait un dieu, tandis que la seule récompense d'un serviteur serait de cultiver une qualité de blé légèrement supérieure.
Mais c’était en fait un pas en avant. Au début de l’Ancien Empire, les prêtres égyptiens enseignaient que seul le pharaon pouvait entrer au paradis, tandis que les autres devaient rester à Duat pour toujours, luttant pour survivre. Même pour le pharaon, le chemin n’a jamais été facile. Le leur était l'une des après-éclairages les plus terrifiantes et les plus difficiles à laquelle une culture pourrait faire face. C’était une situation à laquelle un homme pouvait passer toute sa vie à se préparer. Et, comme le montrent clairement les pyramides massives qu’ils ont laissées derrière eux, c’était un sort que les Égyptiens croyaient vraiment qui les attendait de l’autre côté. [Origines anciennes].
AVIS: L'Égypte ancienne était une civilisation de l'Afrique du Nord-Est ancienne, concentrée le long du cours inférieur du Nil, à l'endroit qui est aujourd'hui l'Égypte. C’est l’une des six civilisations historiques à naître de manière indépendante. La civilisation égyptienne a suivi l'Égypte préhistorique et a fusionné vers 3150 avant JC (selon la chronologie égyptienne conventionnelle) avec l'unification politique de la Haute et de la Basse-Égypte sous Ménès (souvent identifié à Narmer). L’histoire de l’Égypte ancienne s’est déroulée sous la forme d’une série de royaumes stables, séparés par des périodes d’instabilité relative connues sous le nom de périodes intermédiaires : l’Ancien Empire de l’âge du bronze ancien, l’Empire du Milieu de l’âge du bronze moyen et le Nouvel Empire de l’âge du bronze tardif. .
L’Égypte a atteint l’apogée de sa puissance au Nouvel Empire, pendant la période ramesside, où elle rivalisait avec l’empire hittite, l’empire assyrien et l’empire du Mitanni, après quoi elle est entrée dans une période de lent déclin. L'Égypte a été envahie ou conquise par une succession de puissances étrangères, telles que les Cananéens/Hyksos, les Libyens, les Nubiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses achéménides et les Macédoniens au cours de la troisième période intermédiaire et de la période tardive de l'Égypte. Au lendemain de la mort d'Alexandre le Grand, l'un de ses généraux, Ptolémée Soter, s'est imposé comme le nouveau dirigeant de l'Égypte. Ce royaume grec ptolémaïque a gouverné l’Égypte jusqu’en 30 avant JC, date à laquelle, sous Cléopâtre, il est tombé aux mains de l’Empire romain et est devenu une province romaine.
Le succès de la civilisation égyptienne antique provenait en partie de sa capacité à s’adapter aux conditions de la vallée du Nil pour l’agriculture. Les inondations prévisibles et l'irrigation contrôlée de la vallée fertile ont produit des récoltes excédentaires, qui ont soutenu une population plus dense, ainsi qu'un développement social et culturel. Avec des ressources en réserve, l'administration a financé l'exploitation minière de la vallée et des régions désertiques environnantes, le développement précoce d'un système d'écriture indépendant, l'organisation de projets de construction et agricoles collectifs, le commerce avec les régions environnantes et une armée destinée à vaincre les ennemis étrangers et affirmer la domination égyptienne. Ces activités étaient motivées et organisées par une bureaucratie composée de scribes d'élite, de chefs religieux et d'administrateurs sous le contrôle d'un pharaon, qui assurait la coopération et l'unité du peuple égyptien dans le contexte d'un système élaboré de croyances religieuses.
Les nombreuses réalisations des anciens Égyptiens comprennent les techniques d'exploitation de carrières, d'arpentage et de construction qui ont permis la construction de pyramides monumentales, de temples et d'obélisques ; un système de mathématiques, un système de médecine pratique et efficace, des systèmes d'irrigation et des techniques de production agricole, les premiers bateaux en planches connus, la technologie égyptienne de la faïence et du verre, de nouvelles formes de littérature et le premier traité de paix connu, conclu avec les Hittites. L’Égypte a laissé un héritage durable. Son art et son architecture ont été largement copiés et ses antiquités emportées aux quatre coins du monde. Ses ruines monumentales inspirent l’imagination des voyageurs et des écrivains depuis des siècles. Un nouveau respect pour les antiquités et les fouilles au début de la période moderne par les Européens et les Égyptiens a conduit à des recherches scientifiques sur la civilisation égyptienne et à une plus grande appréciation de son héritage culturel.
Le Nil a été la bouée de sauvetage de sa région pendant une grande partie de l’histoire de l’humanité. La plaine inondable fertile du Nil a donné aux humains la possibilité de développer une économie agricole sédentaire et une société plus sophistiquée et centralisée qui est devenue la pierre angulaire de l’histoire de la civilisation humaine. Les chasseurs-cueilleurs humains nomades modernes ont commencé à vivre dans la vallée du Nil jusqu'à la fin du Pléistocène moyen il y a environ 120 000 ans. À la fin du Paléolithique, le climat aride de l’Afrique du Nord est devenu de plus en plus chaud et sec, obligeant les populations de la région à se concentrer le long de la région fluviale.
À l’époque prédynastique et au début de la dynastie, le climat égyptien était beaucoup moins aride qu’aujourd’hui. De vastes régions d’Égypte étaient couvertes de savanes arborées et traversées par des troupeaux d’ongulés en pâturage. Le feuillage et la faune étaient beaucoup plus prolifiques dans tous les environs et la région du Nil abritait de grandes populations de sauvagine. La chasse aurait été courante pour les Égyptiens, et c’est aussi la période où de nombreux animaux ont été domestiqués pour la première fois. Vers 5 500 avant JC, les petites tribus vivant dans la vallée du Nil s'étaient développées en une série de cultures démontrant un contrôle ferme sur l'agriculture et l'élevage, et identifiables par leurs poteries et leurs objets personnels, tels que des peignes, des bracelets et des perles. La plus grande de ces premières cultures de la Haute (sud) Égypte était la Badari, probablement originaire du désert occidental ; elle était connue pour ses céramiques de haute qualité, ses outils en pierre et son utilisation du cuivre.
Le Badari a été suivi par les cultures Amratian (Naqada I) et Gerzeh (Naqada II), qui ont apporté un certain nombre d'améliorations technologiques. Dès la période Naqada I, les Égyptiens prédynastiques importaient de l’obsidienne d’Éthiopie, utilisée pour façonner des lames et d’autres objets à partir de paillettes. À l'époque de Naqada II, il existe des preuves précoces de contacts avec le Proche-Orient, en particulier avec Canaan et la côte de Byblos. Sur une période d'environ 1 000 ans, la culture Naqada s'est développée à partir de quelques petites communautés agricoles pour devenir une civilisation puissante dont les dirigeants contrôlaient totalement la population et les ressources de la vallée du Nil. En établissant un centre de pouvoir à Hierakonpolis, puis à Abydos, les dirigeants de Naqada III étendirent leur contrôle sur l'Égypte vers le nord, le long du Nil. Ils commerçaient également avec la Nubie au sud, les oasis du désert occidental à l'ouest et les cultures de la Méditerranée orientale et du Proche-Orient à l'est. Les sépultures royales nubiennes à Qustul ont produit des artefacts portant les plus anciens exemples connus de symboles dynastiques égyptiens, tels que la couronne blanche d'Égypte et le faucon.
La culture Naqada fabriquait une sélection diversifiée de biens matériels, reflétant le pouvoir et la richesse croissants de l'élite, ainsi que des objets sociétaux à usage personnel, notamment des peignes, de petites statues, des poteries peintes, des vases en pierre décoratifs de haute qualité, des palettes de cosmétiques, et des bijoux en or, lapis et ivoire. Ils ont également développé une glaçure céramique connue sous le nom de faïence, qui a été utilisée jusqu'à l'époque romaine pour décorer des tasses, des amulettes et des figurines. Au cours de la dernière phase prédynastique, la culture Naqada a commencé à utiliser des symboles écrits qui ont finalement été développés en un système complet de hiéroglyphes pour écrire la langue égyptienne ancienne.
La première période dynastique était à peu près contemporaine de la première civilisation sumérienne-akkadienne de la Mésopotamie et de l'ancien Élam. Le prêtre égyptien Manéthon du troisième siècle avant JC a regroupé la longue lignée de pharaons depuis Ménès jusqu'à son époque en 30 dynasties, un système encore utilisé aujourd'hui. Il choisit de commencer son histoire officielle avec le roi nommé « Meni » (ou Ménès en grec) qui aurait uni les deux royaumes de Haute et Basse Égypte (vers 3100 avant JC). La transition vers un État unifié s’est produite plus progressivement que ne le pensaient les anciens écrivains égyptiens, et il n’existe aucune trace contemporaine de Ménès. Certains érudits pensent cependant maintenant que le mythique Ménès pourrait être le pharaon Narmer, représenté portant des insignes royaux sur la palette cérémoniale de Narmer, dans un acte symbolique d'unification.
Au début de la période dynastique, vers 3150 av. routes commerciales vers le Levant. Le pouvoir et la richesse croissants des pharaons au début de la période dynastique se reflétaient dans leurs tombes mastaba élaborées et leurs structures de culte mortuaire à Abydos, qui étaient utilisées pour célébrer le pharaon déifié après sa mort. La solide institution de royauté développée par les pharaons a servi à légitimer le contrôle de l’État sur la terre, la main-d’œuvre et les ressources essentielles à la survie et à la croissance de la civilisation égyptienne antique.
Des progrès majeurs dans l'architecture, l'art et la technologie ont été réalisés au cours de l'Ancien Empire, alimentés par l'augmentation de la productivité agricole et de la population qui en résulte, rendue possible par une administration centrale bien développée. Certaines des réalisations majeures de l'Égypte ancienne, les pyramides de Gizeh et le Grand Sphinx, ont été construites pendant l'Ancien Empire. Sous la direction du vizir, les fonctionnaires de l'État collectaient des impôts, coordonnaient des projets d'irrigation pour améliorer le rendement des cultures, enrôlaient des paysans pour travailler sur des projets de construction et établissaient un système judiciaire pour maintenir la paix et l'ordre.
Parallèlement à l'importance croissante d'une administration centrale, est apparue une nouvelle classe de scribes et de fonctionnaires instruits qui se sont vu accorder des domaines par le pharaon en paiement de leurs services. Les pharaons accordaient également des terres à leurs cultes mortuaires et à leurs temples locaux, afin de garantir que ces institutions disposaient des ressources nécessaires pour adorer le pharaon après sa mort. Les spécialistes estiment que cinq siècles de ces pratiques ont lentement érodé le pouvoir économique du pharaon et que l’économie ne pouvait plus se permettre de soutenir une grande administration centralisée. À mesure que le pouvoir du pharaon diminuait, les gouverneurs régionaux appelés nomarques commencèrent à contester la suprématie du pharaon. Ceci, associé à de graves sécheresses entre 2200 et 2150 avant JC, est censé avoir poussé le pays à entrer dans la période de 140 ans de famine et de conflits connue sous le nom de Première Période Intermédiaire.
Après l'effondrement du gouvernement central égyptien à la fin de l'Ancien Empire, l'administration n'est plus en mesure de soutenir ou de stabiliser l'économie du pays. Les gouverneurs régionaux ne pouvaient pas compter sur l’aide du roi en temps de crise, et les pénuries alimentaires et les conflits politiques qui en ont résulté ont dégénéré en famines et en guerres civiles à petite échelle. Pourtant, malgré des problèmes difficiles, les dirigeants locaux, qui n’avaient aucun tribut à rendre au pharaon, ont utilisé leur nouvelle indépendance pour établir une culture prospère dans les provinces. Une fois maîtres de leurs propres ressources, les provinces sont devenues économiquement plus riches, comme en témoignent les sépultures plus grandes et de meilleure qualité parmi toutes les classes sociales. Dans des élans de créativité, les artisans provinciaux adoptèrent et adaptèrent des motifs culturels autrefois réservés à la royauté de l'Ancien Empire, et les scribes développèrent des styles littéraires qui exprimaient l'optimisme et l'originalité de l'époque.
Libérés de leur loyauté envers le pharaon, les dirigeants locaux ont commencé à se faire concurrence pour le contrôle territorial et le pouvoir politique. En 2160 avant JC, les dirigeants d'Hérakléopolis contrôlaient la Basse-Égypte au nord, tandis qu'un clan rival basé à Thèbes, la famille Intef, prenait le contrôle de la Haute-Égypte au sud. À mesure que les Intefs gagnaient en puissance et étendaient leur contrôle vers le nord, un affrontement entre les deux dynasties rivales devenait inévitable. Vers 2055 avant JC, les forces thébaines du nord dirigées par Nebhepetre Mentuhotep II ont finalement vaincu les dirigeants d'Hérakléopolitain, réunissant les deux terres. Ils inaugurent une période de renaissance économique et culturelle connue sous le nom d’Empire du Milieu.
Les pharaons de l'Empire du Milieu ont restauré la prospérité et la stabilité du pays, stimulant ainsi une résurgence de l'art, de la littérature et des projets de construction monumentale. Mentouhotep II et ses successeurs de la onzième dynastie régnèrent depuis Thèbes, mais le vizir Amenemhat Ier, après avoir assumé la royauté au début de la douzième dynastie vers 1985 avant JC, transféra la capitale nationale à la ville d'Itjtawy, située dans le Fayoum. Depuis Itjtawy, les pharaons de la XIIe dynastie ont entrepris un projet de remise en état des terres et d'irrigation à long terme pour augmenter la production agricole dans la région. De plus, l'armée a reconquis un territoire de Nubie riche en carrières et en mines d'or, tandis que les ouvriers ont construit une structure défensive dans le delta oriental, appelée « Murs du Souverain », pour se défendre contre les attaques étrangères.
Les pharaons ayant assuré la sécurité militaire et politique et de vastes richesses agricoles et minières, la population, les arts et la religion de la nation ont prospéré. Contrairement aux attitudes élitistes de l'Ancien Empire envers les dieux, l'Empire du Milieu a connu une augmentation des expressions de piété personnelle et ce que l'on pourrait appeler une démocratisation de l'au-delà, dans laquelle tous les hommes possédaient une âme et pouvaient être accueillis en compagnie des dieux. après la mort. La littérature de l’Empire du Milieu présentait des thèmes et des personnages sophistiqués écrits dans un style confiant et éloquent. Les reliefs et les portraits sculptés de cette période capturaient des détails subtils et individuels qui atteignaient de nouveaux sommets de perfection technique.
Le dernier grand souverain de l'Empire du Milieu, Amenemhat III, a permis aux colons cananéens du Proche-Orient de langue sémitique de s'établir dans la région du delta afin de fournir une main-d'œuvre suffisante pour ses campagnes minières et de construction particulièrement actives. Ces ambitieuses activités de construction et d'exploitation minière, cependant, combinées aux graves inondations du Nil plus tard sous son règne, ont mis à rude épreuve l'économie et précipité le lent déclin de la deuxième période intermédiaire au cours des dernières treizième et quatorzième dynasties. Au cours de ce déclin, les colons cananéens ont commencé à prendre le contrôle de la région du delta, pour finalement arriver au pouvoir en Égypte sous le nom de Hyksos.
Vers 1785 avant JC, alors que le pouvoir des pharaons de l’Empire du Milieu s’affaiblissait, un peuple d’Asie occidentale appelé Hyksos s’était déjà installé dans la ville d’Avaris dans le delta oriental, avait pris le contrôle de l’Égypte et forcé le gouvernement central à se retirer à Thèbes. Le pharaon était traité comme un vassal et devait lui rendre hommage. Les Hyksos (« dirigeants étrangers ») ont conservé les modèles de gouvernement égyptiens et se sont identifiés comme des pharaons, intégrant ainsi des éléments égyptiens dans leur culture. Eux et d’autres envahisseurs ont introduit de nouveaux outils de guerre en Égypte, notamment l’arc composite et le char tiré par des chevaux.
Après leur retraite, les rois thébains indigènes se sont retrouvés coincés entre les Hyksos cananéens dirigeant le nord et les alliés nubiens des Hyksos, les Koushites, au sud de l'Égypte. Après des années de vassalité, Thèbes rassembla suffisamment de forces pour défier les Hyksos dans un conflit qui dura plus de 30 ans, jusqu'en 1555 avant JC. Les pharaons Seqenenre Tao II et Kamose parvinrent finalement à vaincre les Nubiens au sud de l'Égypte, mais échouèrent. les Hyksos. Cette tâche incomba au successeur de Kamose, Ahmosis Ier, qui mena avec succès une série de campagnes qui éradiquèrent définitivement la présence des Hyksos en Égypte. Il fonde une nouvelle dynastie. Dans le Nouvel Empire qui suivit, l'armée devint une priorité centrale pour les pharaons cherchant à étendre les frontières de l'Égypte et à conquérir le Proche-Orient.
Les pharaons du Nouvel Empire ont établi une période de prospérité sans précédent en sécurisant leurs frontières et en renforçant les liens diplomatiques avec leurs voisins, notamment l'empire du Mitanni, l'Assyrie et Canaan. Les campagnes militaires menées sous Thoutmosis Ier et son petit-fils Thoutmosis III étendirent l'influence des pharaons au plus grand empire que l'Égypte ait jamais connu. Entre leurs règnes, Hatchepsout a généralement favorisé la paix et restauré les routes commerciales perdues pendant l'occupation des Hyksos, ainsi que son expansion vers de nouvelles régions. À la mort de Thoutmosis III en 1425 avant JC, l’Égypte possédait un empire s’étendant de Niya, au nord-ouest de la Syrie, jusqu’à la quatrième cascade du Nil en Nubie, renforçant ainsi les loyautés et ouvrant l’accès à des importations essentielles telles que le bronze et le bois.
Les pharaons du Nouvel Empire lancèrent une campagne de construction à grande échelle pour promouvoir le dieu Amon, dont le culte grandissant était basé à Karnak. Ils ont également construit des monuments pour glorifier leurs propres réalisations, à la fois réelles et imaginaires. Le temple de Karnak est le plus grand temple égyptien jamais construit. Le pharaon Hatchepsout a utilisé tant d’hyperbole et de grandeur au cours de son règne de près de vingt-deux ans. Son règne fut très réussi, marqué par une longue période de paix et de création de richesses, d'expéditions commerciales à Pount, de restauration des réseaux de commerce extérieur et de grands projets de construction, notamment un élégant temple funéraire qui rivalisait avec l'architecture grecque d'un millier d'années plus tard. une paire colossale d'obélisques et une chapelle à Karnak.
Malgré ses réalisations, Amenhotep II, l'héritier du neveu-beau-fils d'Hatchepsout, Thoutmosis III, a cherché à effacer son héritage vers la fin du règne de son père et tout au long du sien, vantant nombre de ses réalisations comme étant les siennes. Il a également tenté de changer de nombreuses traditions établies qui s'étaient développées au fil des siècles, ce que certains considèrent comme une tentative futile d'empêcher d'autres femmes de devenir pharaons et de freiner leur influence dans le royaume. Vers 1350 avant JC, la stabilité du Nouvel Empire semblait encore plus menacée lorsqu'Amenhotep IV monta sur le trône et institua une série de réformes radicales et chaotiques.
Changeant son nom en Akhenaton, il vanta Aton, la divinité solaire auparavant obscure, comme la divinité suprême, supprima le culte de la plupart des autres divinités et attaqua le pouvoir du temple qui était devenu dominé par les prêtres d'Amon à Thèbes, qu'il considérait comme corrompu. En déplaçant la capitale dans la nouvelle ville d'Akhetaton (aujourd'hui Amarna), Akhenaton a fait la sourde oreille aux événements du Proche-Orient (où les Hittites, le Mitanni et les Assyriens se disputaient le contrôle). Il était dévoué à sa nouvelle religion et à son nouveau style artistique. Après sa mort, le culte d'Aton fut rapidement abandonné, les prêtres d'Amon reprirent bientôt le pouvoir et rendirent la capitale à Thèbes. Sous leur influence, les pharaons suivants Toutankhamon, Ay et Horemheb s'efforcèrent d'effacer toute mention de l'hérésie d'Akhenaton, maintenant connue sous le nom de période amarnienne.
Vers 1279 avant JC, Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, monta sur le trône et construisit plus de temples, érigea plus de statues et d'obélisques et engendra plus d'enfants que tout autre pharaon de l'histoire. Chef militaire audacieux, Ramsès II a mené son armée contre les Hittites lors de la bataille de Kadesh (dans la Syrie moderne) et, après avoir combattu jusqu'à l'impasse, a finalement accepté le premier traité de paix enregistré, vers 1258 avant JC. Avec les Égyptiens et l'Empire hittite. se révélant incapable de prendre le dessus l'une sur l'autre, et les deux puissances craignant également l'expansion de l'empire assyrien moyen, l'Égypte se retira d'une grande partie du Proche-Orient. Les Hittites durent ainsi rivaliser sans succès avec les puissants Assyriens et les Phrygiens nouvellement arrivés.
La richesse de l'Égypte, cependant, en faisait une cible tentante pour l'invasion, en particulier par les Berbères libyens à l'ouest, et par les Peuples de la Mer, une supposée confédération de marins de la mer Égée. Initialement, l’armée fut capable de repousser ces invasions, mais l’Égypte finit par perdre le contrôle de ses territoires restants dans le sud de Canaan, dont une grande partie tomba aux mains des Assyriens. Les effets des menaces extérieures ont été exacerbés par des problèmes internes tels que la corruption, le vol de tombes et les troubles civils. Après avoir repris leur pouvoir, les grands prêtres du temple d'Amon à Thèbes ont accumulé de vastes étendues de terres et de richesses, et leur pouvoir accru a divisé le pays au cours de la Troisième Période Intermédiaire.
Après la mort de Ramsès XI en 1078 avant JC, Smendès assuma l'autorité sur la partie nord de l'Égypte, dirigeant depuis la ville de Tanis. Le sud était effectivement contrôlé par les grands prêtres d'Amon à Thèbes, qui ne reconnaissaient Smendès que de nom. Pendant ce temps, des tribus berbères de ce qui allait plus tard être appelé Libye s'étaient installées dans le delta occidental et les chefs de ces colons ont commencé à accroître leur autonomie. Les princes libyens prirent le contrôle du delta sous Shoshenq Ier en 945 avant JC, fondant la dynastie des Berbères libyens, ou Bubastites, qui régna pendant environ 200 ans. Shoshenq a également pris le contrôle du sud de l'Égypte en plaçant les membres de sa famille à des postes sacerdotaux importants.
Au milieu du IXe siècle avant JC, l’Égypte a tenté en vain de reprendre pied en Asie occidentale. Osorkon II d'Égypte, ainsi qu'une large alliance de nations et de peuples, dont la Perse, Israël, Hamath, la Phénicie/Canaan, les Arabes, les Araméens et les néo-Hitites, entre autres, se sont engagés dans la bataille de Karkar contre le puissant roi assyrien Shalmaneser III. en 853 avant JC. Cependant, cette coalition de puissances échoua et l'empire néo-assyrien continua de dominer l'Asie occidentale. Le contrôle berbère libyen a commencé à s'éroder à mesure qu'une dynastie indigène rivale dans le delta est apparue sous Léontopolis. De plus, les Nubiens des Koushites menaçaient l’Égypte depuis les terres situées au sud.
Vers 730 avant JC Les Libyens de l'ouest ont fracturé l'unité politique du pays. S'appuyant sur des millénaires d'interaction (commerce, acculturation, occupation, assimilation et guerre) avec l'Égypte, le roi koushite Piye a quitté sa capitale nubienne de Napata et a envahi l'Égypte vers 727 avant JC. Piye a facilement pris le contrôle de Thèbes et finalement du delta du Nil. Il a enregistré l'épisode sur sa stèle de la victoire. Piye a ouvert la voie aux pharaons ultérieurs de la vingt-cinquième dynastie, tels que Taharqa, pour réunir les « deux terres » du nord et du sud de l'Égypte. L’empire de la vallée du Nil était aussi vaste qu’il l’avait été depuis le Nouvel Empire.
La vingt-cinquième dynastie a marqué le début d’une période de renaissance pour l’Égypte ancienne. La religion, les arts et l’architecture ont retrouvé leurs glorieuses formes de l’Ancien, du Moyen et du Nouvel Empire. Des pharaons, comme Taharqa, ont construit ou restauré des temples et des monuments dans toute la vallée du Nil, notamment à Memphis, Karnak, Kawa, Jebel Barkal, etc. C'est au cours de la Vingt-cinquième dynastie qu'a eu lieu la première construction généralisée de pyramides (beaucoup dans le Soudan moderne) dans la vallée du Nil depuis l'Empire du Milieu. Piye a fait plusieurs tentatives infructueuses pour étendre l'influence égyptienne au Proche-Orient, alors contrôlé par l'Assyrie. En 720 avant JC, il envoya une armée soutenir une rébellion contre l'Assyrie, qui se déroulait en Philistie et à Gaza. Cependant, Piye fut vaincu par Sargon II et la rébellion échoua. En 711 avant JC, Piye soutint à nouveau une révolte contre l'Assyrie par les Israélites d'Ashdod et fut de nouveau vaincu par le roi assyrien Sargon II. Par la suite, Piye a été chassé du Proche-Orient.
À partir du Xe siècle avant JC, l’Assyrie se bat pour le contrôle du sud du Levant. Fréquemment, les villes et les royaumes du sud du Levant faisaient appel à l’Égypte pour obtenir de l’aide dans leurs luttes contre la puissante armée assyrienne. Taharqa a connu un certain succès dans ses tentatives de reprendre pied au Proche-Orient. Taharqa a aidé le roi de Judée Ézéchias lorsque Ézéchias et Jérusalem furent assiégés par le roi assyrien Sennachérib. Les érudits ne sont pas d’accord sur la raison principale de l’abandon par l’Assyrie de son siège sur Jérusalem. Les raisons du retrait assyrien vont du conflit avec l'armée égyptienne/kouchite à l'intervention divine pour céder à la maladie. Henry Aubin soutient que l'armée koushite/égyptienne a sauvé Jérusalem des Assyriens et a empêché les Assyriens de revenir capturer Jérusalem pour le reste de la vie de Sennachérib (20 ans). Certains affirment que la maladie a été la principale raison pour laquelle la ville n’a pas été prise ; cependant, les annales de Senacherib affirment que Juda a quand même été contraint de rendre hommage.
Sennachérib avait été assassiné par ses propres fils pour avoir détruit la ville rebelle de Babylone, ville sacrée pour tous les Mésopotamiens, y compris les Assyriens. En 674 avant JC, Esarhaddon lança une incursion préliminaire en Égypte ; cependant, cette tentative fut repoussée par Taharqa. Cependant, en 671 avant JC, Esarhaddon lança une invasion à grande échelle. Une partie de son armée est restée sur place pour faire face aux rébellions en Phénicie et en Israël. Le reste se dirigea vers le sud jusqu'à Rapihu, puis traversa le Sinaï et entra en Égypte. Esarhaddon a vaincu Taharqa de manière décisive, a pris Memphis, Thèbes et toutes les grandes villes d'Égypte, et Taharqa a été repoussé dans sa patrie nubienne. Esarhaddon s'appelait désormais « roi d'Égypte, Patros et Koush » et revint avec un riche butin des villes du delta ; il érigea à cette époque une stèle de victoire et fit défiler le prince captif Ushankhuru, fils de Taharqa à Ninive. Esarhaddon a stationné une petite armée dans le nord de l'Égypte et décrit comment « tous les Éthiopiens (lire Nubiens/Kushites) j'ai déportés d'Égypte, n'en laissant plus un seul pour me rendre hommage ». Il installa des princes égyptiens indigènes dans tout le pays pour gouverner en son nom. La conquête par Esarhaddon a effectivement marqué la fin de l'éphémère empire koushite.
Cependant, les dirigeants égyptiens indigènes installés par Esarhaddon n'ont pas pu conserver longtemps le contrôle total de l'ensemble du pays. Deux ans plus tard, Taharqa revint de Nubie et prit le contrôle d'une partie du sud de l'Égypte jusqu'à Memphis. Esarhaddon se préparait à retourner en Égypte et à expulser une fois de plus Taharqa ; cependant, il tomba malade et mourut dans sa capitale, Ninive, avant de quitter l'Assyrie. Son successeur, Ashurbanipal, envoya un général assyrien nommé Sha-Nabu-shu avec une armée petite mais bien entraînée, qui battit définitivement Taharqa à Memphis et le chassa une fois de plus d'Égypte. Taharqa mourut en Nubie deux ans plus tard.
Son successeur, Tanutamun, tenta également, en vain, de reconquérir l'Égypte pour la Nubie. Il a vaincu avec succès Necho, le dirigeant fantoche égyptien installé par Ashurbanipal, prenant Thèbes dans le processus. Les Assyriens envoyèrent alors une grande armée vers le sud. Tantamani (Tanutamun) fut lourdement mis en déroute et s'enfuit vers la Nubie. L’armée assyrienne a pillé Thèbes à tel point qu’elle ne s’en est jamais vraiment remise. Un dirigeant indigène, Psammetichus Ier fut placé sur le trône, en tant que vassal d'Assurbanipal, et les Nubiens ne devaient plus jamais constituer une menace ni pour l'Assyrie ni pour l'Égypte.
Sans plans permanents de conquête, les Assyriens laissèrent le contrôle de l'Égypte à une série de vassaux qui devinrent connus sous le nom de rois saïtes de la vingt-sixième dynastie. En 653 avant JC, le roi saïte Psamtik I (profitant du fait que l'Assyrie était impliquée dans une guerre féroce pour conquérir l'Élam et que peu de troupes assyriennes étaient stationnées en Égypte) fut capable de libérer l'Égypte de manière relativement pacifique de la vassalité assyrienne avec l'aide de Lydian. et des mercenaires grecs, ces derniers furent recrutés pour former la première marine égyptienne. Psamtik et ses successeurs veillèrent cependant à maintenir des relations pacifiques avec l'Assyrie. L'influence grecque s'est considérablement développée lorsque la ville de Naukratis est devenue la demeure des Grecs du delta.
En 609 avant JC, Nécho II entra en guerre contre la Babylonie, les Chaldéens, les Mèdes et les Scythes pour tenter de sauver l'Assyrie, qui, après une guerre civile brutale, était envahie par cette coalition de puissances. Cependant, la tentative de sauver les anciens maîtres égyptiens a échoué. Les Égyptiens tardèrent trop à intervenir, et Ninive était déjà tombée et le roi Sin-shar-ishkun était mort au moment où Necho II envoya ses armées vers le nord. Cependant, Necho écarta facilement l'armée israélite dirigée par le roi Josias, mais lui et les Assyriens perdirent ensuite une bataille à Harran face aux Babyloniens, aux Mèdes et aux Scythes. Necho II et Ashur-uballit II d'Assyrie furent finalement vaincus à Karkemish en Aramée (Syrie moderne) en 605 avant JC.
Les Égyptiens restèrent dans la région pendant plusieurs décennies, luttant contre les rois babyloniens Nabopolassar et Nabuchodonosor II pour le contrôle de parties de l'ancien empire assyrien au Levant. Cependant, ils furent finalement repoussés en Égypte, et Nabuchodonosor II envahit même brièvement l'Égypte elle-même en 567 avant JC. Les rois saïtes basés dans la nouvelle capitale de Saïs furent témoins d'une résurgence brève mais dynamique de l'économie et de la culture, mais en 525 avant JC, le puissant Les Perses, dirigés par Cambyse II, commencèrent leur conquête de l'Égypte, capturant finalement le pharaon Psamtik III à la bataille de Péluse. Cambyse II prit alors le titre officiel de pharaon, mais dirigea l'Égypte depuis sa maison de Suse en Perse (Iran moderne), laissant l'Égypte sous le contrôle d'une satrapie. Quelques révoltes temporairement réussies contre les Perses marquèrent le Ve siècle avant JC, mais l'Égypte ne fut jamais en mesure de renverser définitivement les Perses.
Suite à son annexion par la Perse, l'Égypte fut rejointe par Chypre et la Phénicie (Liban moderne) dans la sixième satrapie de l'empire perse achéménide. Cette première période de domination perse sur l'Égypte, également connue sous le nom de vingt-septième dynastie, s'est terminée après plus de cent ans en 402 avant JC, et de 380 à 343 avant JC, la trentième dynastie a régné comme la dernière maison royale indigène de l'Égypte dynastique. qui se termina avec la royauté de Nectanebo II. Une brève restauration de la domination perse, parfois connue sous le nom de trente et unième dynastie, commença en 343 avant JC, mais peu de temps après, en 332 avant JC, le souverain perse Mazaces remit l'Égypte au souverain macédonien Alexandre le Grand sans combat.
En 332 avant JC, Alexandre le Grand conquit l’Égypte sans grande résistance de la part des Perses et fut accueilli par les Égyptiens comme un libérateur. L'administration établie par les successeurs d'Alexandre, le royaume ptolémaïque macédonien, était basée sur un modèle égyptien et basée dans la nouvelle capitale d'Alexandrie. La ville a démontré la puissance et le prestige de la domination hellénistique et est devenue un siège d'apprentissage et de culture, centré sur la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie a ouvert la voie aux nombreux navires qui assuraient le commerce dans la ville, alors que les Ptolémées faisaient du commerce et des entreprises génératrices de revenus, telles que la fabrication de papyrus, leur priorité absolue.
La culture hellénistique n'a pas supplanté la culture égyptienne indigène, car les Ptolémées soutenaient des traditions séculaires dans le but d'assurer la loyauté de la population. Ils construisirent de nouveaux temples dans le style égyptien, soutenèrent les cultes traditionnels et se présentèrent comme des pharaons. Certaines traditions ont fusionné, les dieux grecs et égyptiens étant syncrétisés en divinités composites, telles que Sérapis, et les formes de sculpture grecques classiques ont influencé les motifs égyptiens traditionnels. Malgré leurs efforts pour apaiser les Égyptiens, les Ptolémées furent confrontés à la rébellion indigène, à d'âpres rivalités familiales et à la puissante foule d'Alexandrie qui se forma après la mort de Ptolémée IV. De plus, comme Rome dépendait davantage des importations de céréales en provenance d’Égypte, les Romains s’intéressaient beaucoup à la situation politique du pays. Les révoltes égyptiennes continues, les politiciens ambitieux et les puissants opposants syriaques du Proche-Orient ont rendu cette situation instable, conduisant Rome à envoyer des forces pour sécuriser le pays en tant que province de son empire.
Les portraits des momies du Fayoum incarnent la rencontre des cultures égyptienne et romaine. L'Égypte est devenue une province de l'Empire romain en 30 avant JC, à la suite de la défaite de Marc Antoine et de la reine ptolémaïque Cléopâtre VII par Octave (plus tard l'empereur Auguste) lors de la bataille d'Actium. Les Romains dépendaient fortement des expéditions de céréales en provenance d'Égypte et l'armée romaine, sous le contrôle d'un préfet nommé par l'empereur, réprimait les rébellions, appliquait strictement la perception de lourdes taxes et empêchait les attaques de bandits, qui étaient devenues un problème notoire au cours de l'époque. la période. Alexandrie est devenue un centre de plus en plus important sur la route commerciale avec l'Orient, car les produits de luxe exotiques étaient très demandés à Rome.
Bien que les Romains eussent une attitude plus hostile que les Grecs envers les Égyptiens, certaines traditions telles que la momification et le culte des dieux traditionnels perdurèrent. L'art du portrait de momies était florissant et certains empereurs romains se faisaient eux-mêmes représentés comme des pharaons, mais pas dans la même mesure que les Ptolémées. Les premiers vivaient hors d’Égypte et n’exerçaient pas les fonctions cérémonielles de la royauté égyptienne. L'administration locale est devenue de style romain et fermée aux Égyptiens indigènes. À partir du milieu du premier siècle de notre ère, le christianisme s’est implanté en Égypte et était à l’origine considéré comme un autre culte pouvant être accepté. Cependant, c’était une religion intransigeante qui cherchait à gagner des convertis de la religion égyptienne et de la religion gréco-romaine et menaçait les traditions religieuses populaires.
Cela a conduit à la persécution des convertis au christianisme, culminant avec les grandes purges de Dioclétien à partir de 303, mais finalement le christianisme l'a emporté. En 391, l’empereur chrétien Théodose introduisit une législation interdisant les rites païens et fermant les temples. Alexandrie est devenue le théâtre de grandes émeutes anti-païennes avec la destruction de l'imagerie religieuse publique et privée. En conséquence, la culture religieuse indigène de l'Égypte était continuellement en déclin. Même si la population autochtone a certainement continué à parler leur langue, la capacité de lire l’écriture hiéroglyphique a lentement disparu à mesure que le rôle des prêtres et prêtresses des temples égyptiens diminuait. Les temples eux-mêmes étaient parfois transformés en églises ou abandonnés au désert.
Le pharaon était le monarque absolu du pays et, du moins en théorie, exerçait un contrôle total sur la terre et ses ressources. Le roi était le commandant militaire suprême et le chef du gouvernement, qui s'appuyait sur une bureaucratie composée de fonctionnaires pour gérer ses affaires. En charge de l'administration était son commandant en second, le vizir, qui agissait en tant que représentant du roi et coordonnait les levés fonciers, le trésor, les projets de construction, le système juridique et les archives. Au niveau régional, le pays était divisé en 42 régions administratives appelées nomes, chacune gouvernée par un nomarque, qui était responsable devant le vizir de sa juridiction. Les temples constituaient l’épine dorsale de l’économie. Non seulement ils étaient des lieux de culte, mais ils étaient également chargés de collecter et de stocker les richesses de la nation dans un système de greniers et de trésors administrés par des surveillants qui redistribuaient les céréales et les marchandises.
Une grande partie de l’économie était organisée de manière centralisée et strictement contrôlée. Bien que les anciens Égyptiens n'aient utilisé la monnaie qu'à la fin de la période, ils utilisaient une sorte de système de troc monétaire, avec des sacs standards de céréales et du deben, un poids d'environ 91 grammes (3 onces) de cuivre ou d'argent, formant un dénominateur commun. Les ouvriers étaient payés en céréales ; un simple ouvrier peut gagner 5½ sacs (200 kg ou 400 lb) de céréales par mois, tandis qu'un contremaître peut gagner 7½ sacs (250 kg ou 550 lb). Les prix étaient fixés dans tout le pays et enregistrés sur des listes pour faciliter les échanges ; par exemple, une chemise coûte cinq deben de cuivre, tandis qu'une vache coûte 140 deben. Les céréales pouvaient être échangées contre d'autres biens, selon la liste de prix fixe. Au cours du cinquième siècle avant JC, la monnaie frappée fut introduite en Égypte depuis l'étranger. Au début, les pièces étaient utilisées comme pièces standardisées de métal précieux plutôt que comme monnaie véritable, mais au cours des siècles suivants, les commerçants internationaux en sont venus à compter sur la monnaie.
La société égyptienne était très stratifiée et le statut social était expressément affiché. Les agriculteurs constituaient la majeure partie de la population, mais les produits agricoles appartenaient directement à l'État, au temple ou à la famille noble qui possédait la terre. Les agriculteurs étaient également soumis à une taxe sur le travail et étaient tenus de travailler sur des projets d'irrigation ou de construction dans un système de corvée. Les artistes et les artisans avaient un statut plus élevé que les agriculteurs, mais ils étaient également sous le contrôle de l'État, travaillant dans les ateliers rattachés aux temples et payés directement par le trésor public. Les scribes et les fonctionnaires formaient la classe supérieure de l'Égypte ancienne, connue sous le nom de « classe du kilt blanc » en référence aux vêtements en lin blanchi qui servaient de marque de leur rang. La classe supérieure affiche clairement son statut social dans l’art et la littérature. Au-dessous de la noblesse se trouvaient les prêtres, les médecins et les ingénieurs ayant une formation spécialisée dans leur domaine. L’esclavage était connu dans l’Égypte ancienne, mais l’étendue et la prévalence de sa pratique ne sont pas claires.
Les anciens Égyptiens considéraient les hommes et les femmes, y compris les personnes de toutes les classes sociales à l'exception des esclaves, comme fondamentalement égaux devant la loi, et même le paysan le plus modeste avait le droit de demander réparation au vizir et à son tribunal. Bien que les esclaves soient principalement utilisés comme serviteurs sous contrat, ils étaient capables d'acheter et de vendre leur servitude, de se frayer un chemin vers la liberté ou la noblesse et étaient généralement soignés par des médecins sur leur lieu de travail. Les hommes et les femmes avaient le droit de posséder et de vendre des biens, de conclure des contrats, de se marier et de divorcer, de recevoir un héritage et de porter plainte devant les tribunaux.
Les couples mariés pouvaient posséder des biens conjointement et se protéger du divorce en concluant des contrats de mariage qui stipulaient les obligations financières du mari envers sa femme et ses enfants en cas de rupture du mariage. Par rapport à leurs homologues de la Grèce antique, de Rome et de pays encore plus modernes à travers le monde, les femmes égyptiennes de l’Antiquité disposaient d’un plus grand éventail de choix personnels et d’opportunités de réussite. Des femmes comme Hatchepsout et Cléopâtre VII sont même devenues pharaons, tandis que d’autres ont exercé le pouvoir en tant qu’épouses divines d’Amon. Malgré ces libertés, les femmes égyptiennes antiques n’occupaient pas souvent des rôles officiels dans l’administration, n’occupaient que des rôles secondaires dans les temples et n’étaient pas aussi susceptibles d’être aussi instruites que les hommes.
Le chef du système juridique était officiellement le pharaon, chargé de promulguer les lois, de rendre la justice et de maintenir l'ordre public, un concept que les anciens Égyptiens appelaient Maât. Bien qu'aucun code juridique de l'Égypte ancienne n'ait survécu, les documents judiciaires montrent que la loi égyptienne était basée sur une vision sensée du bien et du mal qui mettait l'accent sur la conclusion d'accords et la résolution des conflits plutôt que sur le strict respect d'un ensemble complexe de lois. Les conseils locaux des anciens, connus sous le nom de Kenbet au Nouvel Empire, étaient chargés de statuer sur les affaires judiciaires impliquant de petites créances et des litiges mineurs.
Les cas plus graves impliquant des meurtres, des transactions foncières importantes et des vols de tombes étaient renvoyés au Grand Kenbet, présidé par le vizir ou le pharaon. Les plaignants et les défendeurs étaient censés se représenter eux-mêmes et devaient prêter serment selon lequel ils avaient dit la vérité. Dans certains cas, l'État a assumé à la fois le rôle de procureur et de juge, et il a pu torturer l'accusé en le battant pour obtenir des aveux et les noms d'éventuels complices. Que les accusations soient insignifiantes ou graves, les scribes du tribunal ont documenté la plainte, le témoignage et le verdict de l'affaire pour référence future.
La punition pour les délits mineurs impliquait soit l'imposition d'amendes, de passages à tabac, de mutilations faciales ou l'exil, selon la gravité de l'infraction. Les crimes graves tels que le meurtre et le vol de tombes étaient punis par l'exécution, par décapitation, noyade ou empalage du criminel sur un bûcher. La punition pourrait également être étendue à la famille du criminel. À partir du Nouvel Empire, les oracles ont joué un rôle majeur dans le système juridique, rendant la justice aussi bien dans les affaires civiles que pénales. La procédure consistait à poser au dieu une question « oui » ou « non » concernant le bien ou le mal d'un problème. Le dieu, porté par un certain nombre de prêtres, rendait son jugement en choisissant l'un ou l'autre, en avançant ou en reculant, ou en désignant l'une des réponses écrites sur un morceau de papyrus ou un ostracon.
Une combinaison de caractéristiques géographiques favorables a contribué au succès de la culture égyptienne antique, dont la plus importante était le sol riche et fertile résultant des inondations annuelles du Nil. Les anciens Égyptiens étaient ainsi capables de produire une abondance de nourriture, permettant à la population de consacrer plus de temps et de ressources aux activités culturelles, technologiques et artistiques. La gestion des terres était cruciale dans l’Égypte ancienne, car les impôts étaient calculés en fonction de la superficie des terres possédées par une personne. L'agriculture en Égypte dépendait du cycle du Nil. Les Égyptiens reconnaissaient trois saisons : Akhet (inondation), Peret (plantation) et Shemu (récolte).
La saison des crues a duré de juin à septembre, déposant sur les rives du fleuve une couche de limon riche en minéraux, idéale pour la culture. Après le retrait des eaux de crue, la saison de croissance s'est étendue d'octobre à février. Les agriculteurs labouraient et plantaient des graines dans les champs irrigués par des fossés et des canaux. L'Égypte a reçu peu de précipitations, les agriculteurs comptaient donc sur le Nil pour arroser leurs cultures. De mars à mai, les agriculteurs utilisaient des faucilles pour récolter leurs récoltes, qui étaient ensuite battues au fléau pour séparer la paille du grain. Le vannage éliminait les paillettes du grain, et le grain était ensuite moulu en farine, brassé pour faire de la bière ou stocké pour une utilisation ultérieure.
Les anciens Égyptiens cultivaient l’amidonnier et l’orge, ainsi que plusieurs autres céréales, qui servaient toutes à fabriquer les deux principaux aliments de base que sont le pain et la bière. Les plants de lin, arrachés avant leur floraison, étaient cultivés pour les fibres de leurs tiges. Ces fibres étaient fendues sur toute leur longueur et filées en fil, utilisé pour tisser des feuilles de lin et confectionner des vêtements. Le papyrus poussant sur les rives du Nil était utilisé pour fabriquer du papier. Les légumes et les fruits étaient cultivés dans des parcelles de jardin, à proximité des habitations et sur des terrains plus élevés, et devaient être arrosés à la main. Les légumes comprenaient les poireaux, l'ail, les melons, les courges, les légumineuses, la laitue et d'autres cultures, en plus des raisins transformés en vin.
Les Égyptiens croyaient qu’une relation équilibrée entre les humains et les animaux était un élément essentiel de l’ordre cosmique ; ainsi, les humains, les animaux et les plantes étaient considérés comme membres d’un tout unique. Les animaux, tant domestiques que sauvages, constituaient donc une source essentielle de spiritualité, de compagnie et de subsistance pour les anciens Égyptiens. Le bétail était le bétail le plus important ; l'administration collectait des impôts sur le bétail lors de recensements réguliers, et la taille d'un troupeau reflétait le prestige et l'importance du domaine ou du temple qui le possédait. En plus du bétail, les anciens Égyptiens élevaient des moutons, des chèvres et des porcs. Les volailles, comme les canards, les oies et les pigeons, étaient capturées dans des filets et élevées dans des fermes, où elles étaient gavées de pâte pour les engraisser. Le Nil fournissait une abondante source de poisson. Les abeilles étaient également domestiquées au moins depuis l’Ancien Empire et fournissaient à la fois du miel et de la cire.
Les anciens Égyptiens utilisaient des ânes et des bœufs comme bêtes de somme, et ils étaient chargés de labourer les champs et de piétiner les graines dans le sol. L'abattage d'un bœuf engraissé était également un élément central d'un rituel d'offrande. Les chevaux ont été introduits par les Hyksos au cours de la deuxième période intermédiaire. Les chameaux, bien que connus du Nouvel Empire, ne furent utilisés comme bêtes de somme qu'à la Basse Époque. Il existe également des preuves suggérant que les éléphants ont été brièvement utilisés à la fin de la période, mais en grande partie abandonnés en raison du manque de pâturages. Les chiens, les chats et les singes étaient des animaux de compagnie courants dans la famille, tandis que les animaux plus exotiques importés du cœur de l'Afrique, comme les lions d'Afrique subsaharienne, étaient réservés à la royauté. Hérodote a observé que les Égyptiens étaient les seuls à garder leurs animaux avec eux dans leurs maisons. Au cours des périodes prédynastiques et tardives, le culte des dieux sous leur forme animale était extrêmement populaire, comme la déesse chat Bastet et le dieu ibis Thot, et ces animaux étaient élevés en grand nombre dans les fermes à des fins de sacrifices rituels.
L'Égypte est riche en pierres de construction et décoratives, en minerais de cuivre et de plomb, en or et en pierres semi-précieuses. Ces ressources naturelles permettaient aux anciens Égyptiens de construire des monuments, de sculpter des statues, de fabriquer des outils et de confectionner des bijoux. Les embaumeurs utilisaient les sels du Wadi Natrun pour la momification, qui fournissaient également le gypse nécessaire à la fabrication du plâtre. Des formations rocheuses contenant du minerai ont été découvertes dans des oueds lointains et inhospitaliers du désert oriental et du Sinaï, ce qui a nécessité de grandes expéditions contrôlées par l'État pour obtenir les ressources naturelles qui s'y trouvent. Il y avait de vastes mines d'or en Nubie, et l'une des premières cartes connues concerne une mine d'or dans cette région. Le Wadi Hammamat était une source notable de granit, de grauwacke et d'or. Le silex a été le premier minéral collecté et utilisé pour fabriquer des outils, et les bifaces en silex sont les premières preuves d'habitation dans la vallée du Nil. Les nodules du minéral ont été soigneusement écaillés pour fabriquer des lames et des pointes de flèches d'une dureté et d'une durabilité modérées, même après l'adoption du cuivre à cet effet. Les anciens Égyptiens ont été parmi les premiers à utiliser des minéraux tels que le soufre comme substances cosmétiques.
Les Égyptiens exploitaient les gisements de galène de plomb à Gebel Rosas pour fabriquer des plombs, des fils à plomb et de petites figurines. Le cuivre était le métal le plus important pour la fabrication d’outils dans l’Égypte ancienne et était fondu dans des fours à partir du minerai de malachite extrait du Sinaï. Les ouvriers collectaient l'or en lavant les pépites des sédiments dans les dépôts alluviaux, ou par le processus plus exigeant en main-d'œuvre de broyage et de lavage du quartzite aurifère. Les gisements de fer découverts en Haute-Égypte ont été exploités à la Basse Époque. Les pierres de construction de haute qualité étaient abondantes en Égypte ; les anciens Égyptiens exploitaient du calcaire tout au long de la vallée du Nil, du granit d'Assouan, ainsi que du basalte et du grès des oueds du désert oriental. Des gisements de pierres décoratives telles que le porphyre, la grauwacke, l'albâtre et la cornaline parsèment le désert oriental et ont été collectés avant même la Première Dynastie. Aux époques ptolémaïque et romaine, les mineurs exploitaient les gisements d'émeraudes de Wadi Sikait et d'améthyste de Wadi el-Hudi.
Les anciens Égyptiens faisaient du commerce avec leurs voisins étrangers pour obtenir des produits rares et exotiques qu’on ne trouve pas en Égypte. À l'époque prédynastique, ils établirent un commerce avec la Nubie pour obtenir de l'or et de l'encens. Ils ont également établi des échanges commerciaux avec la Palestine, comme en témoignent les cruches à huile de style palestinien trouvées dans les sépultures des pharaons de la Première Dynastie. Une colonie égyptienne stationnée dans le sud de Canaan date d’un peu avant la Première Dynastie. Narmer faisait produire de la poterie égyptienne en Canaan et l'exportait vers l'Égypte. Au plus tard sous la Deuxième Dynastie, le commerce égyptien antique avec Byblos fournissait une source essentielle de bois de qualité introuvable en Égypte.
Sous la Cinquième Dynastie, le commerce avec Pount fournissait de l'or, des résines aromatiques, de l'ébène, de l'ivoire et des animaux sauvages tels que des singes et des babouins. L'Égypte dépendait du commerce avec l'Anatolie pour des quantités essentielles d'étain ainsi que des approvisionnements supplémentaires en cuivre, les deux métaux étant nécessaires à la fabrication du bronze. Les anciens Égyptiens appréciaient la pierre bleue lapis-lazuli, qui devait être importée du lointain Afghanistan. Les partenaires commerciaux méditerranéens de l'Égypte comprenaient également la Grèce et la Crète, qui fournissaient, entre autres marchandises, des approvisionnements en huile d'olive. En échange de ses importations de produits de luxe et de matières premières, l’Égypte exportait principalement des céréales, de l’or, du lin et du papyrus, en plus d’autres produits finis, notamment des objets en verre et en pierre.
La langue égyptienne est une langue afro-asiatique du nord étroitement liée aux langues berbères et sémitiques. Son histoire est la deuxième plus longue de toutes les langues (après le sumérien), ayant été écrite entre environ 3 200 avant JC et le Moyen Âge et restant plus longtemps une langue parlée. Les phases de l'égyptien ancien sont le vieil égyptien, le moyen égyptien (égyptien classique), l'égyptien tardif, le démotique et le copte. Les écrits égyptiens ne montrent pas de différences dialectales avant le copte, mais il était probablement parlé dans les dialectes régionaux autour de Memphis et plus tard de Thèbes. L’égyptien ancien était une langue synthétique, mais elle est devenue plus analytique par la suite. L'Égyptien tardif a développé des articles préfixes définis et indéfinis, qui ont remplacé les anciens suffixes flexionnels. Il y a eu un changement par rapport à l’ancien ordre des mots verbe-sujet-objet à sujet-verbe-objet. Les écritures égyptiennes hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques ont finalement été remplacées par l'alphabet copte, plus phonétique. Le copte est encore utilisé dans la liturgie de l’Église orthodoxe égyptienne, et on en trouve des traces dans l’arabe égyptien moderne.
L'écriture hiéroglyphique date d'environ 3000 avant JC et est composée de centaines de symboles. Un hiéroglyphe peut représenter un mot, un son ou un déterminant silencieux ; et le même symbole peut servir à des fins différentes dans des contextes différents. Les hiéroglyphes étaient une écriture formelle, utilisée sur les monuments en pierre et dans les tombes, qui pouvait être aussi détaillée que des œuvres d'art individuelles. Dans l’écriture quotidienne, les scribes utilisaient une forme d’écriture cursive, appelée hiératique, qui était plus rapide et plus simple. Alors que les hiéroglyphes formels peuvent être lus en lignes ou en colonnes dans les deux sens (bien qu'ils soient généralement écrits de droite à gauche), le hiératique était toujours écrit de droite à gauche, généralement en lignes horizontales. Une nouvelle forme d'écriture, le démotique, est devenue le style d'écriture dominant, et c'est cette forme d'écriture, ainsi que les hiéroglyphes formels, qui accompagnent le texte grec sur la pierre de Rosette.
Vers le premier siècle après JC, l’alphabet copte a commencé à être utilisé parallèlement à l’écriture démotique. Le copte est un alphabet grec modifié avec l'ajout de quelques signes démotiques. Bien que les hiéroglyphes formels aient été utilisés dans un rôle cérémonial jusqu'au IVe siècle, vers la fin, seule une petite poignée de prêtres pouvaient encore les lire. À mesure que les établissements religieux traditionnels ont été dissous, la connaissance de l’écriture hiéroglyphique a été en grande partie perdue. Les tentatives pour les déchiffrer remontent aux périodes byzantine et islamique en Égypte, mais ce n'est qu'en 1822, après la découverte de la pierre de Rosette et des années de recherches de Thomas Young et Jean-François Champollion, que les hiéroglyphes furent presque entièrement déchiffrés.
L'écriture est apparue pour la première fois en association avec la royauté sur les étiquettes et les étiquettes des objets trouvés dans les tombes royales. C'était avant tout une occupation des scribes, qui travaillaient au sein de l'institution Per Ankh ou de la Maison de la Vie. Cette dernière comprenait des bureaux, des bibliothèques (appelées Maison du Livre), des laboratoires et des observatoires. Certaines des pièces les plus connues de la littérature égyptienne ancienne, telles que les textes de la pyramide et du cercueil, ont été écrites en égyptien classique, qui est resté la langue d'écriture jusqu'à environ 1300 avant JC. L'égyptien ultérieur a été parlé à partir du Nouvel Empire et est représenté dans les documents administratifs ramessides, la poésie amoureuse et les contes, ainsi que dans les textes démotiques et coptes. Au cours de cette période, la tradition de l'écriture avait évolué vers l'autobiographie funéraire, comme celles de Harkhuf et Weni.
Le genre connu sous le nom de Sebayt (« instructions ») a été développé pour communiquer les enseignements et les conseils de nobles célèbres ; le papyrus Ipuwer, un poème de lamentations décrivant les catastrophes naturelles et les bouleversements sociaux, en est un exemple célèbre. L'Histoire de Sinuhé, écrite en moyen égyptien, pourrait être le classique de la littérature égyptienne. Le Papyrus Westcar fut également écrit à cette époque, un ensemble d'histoires racontées à Khéops par ses fils relatant les merveilles accomplies par les prêtres. L'Instruction d'Amenemope est considérée comme un chef-d'œuvre de la littérature proche-orientale.
Vers la fin du Nouvel Empire, la langue vernaculaire était plus souvent utilisée pour écrire des pièces populaires comme l'Histoire de Wenamun et l'Instruction d'Any. Le premier raconte l'histoire d'un noble qui se fait voler alors qu'il allait acheter du cèdre au Liban et sa lutte pour retourner en Égypte. À partir d'environ 700 avant JC, des histoires narratives et des instructions, telles que les instructions populaires d'Onchsheshonqy, ainsi que des documents personnels et professionnels, ont été rédigés dans l'écriture et la phase démotiques de l'égyptien. De nombreuses histoires écrites en démotique au cours de la période gréco-romaine se déroulaient dans des époques historiques antérieures, lorsque l'Égypte était une nation indépendante dirigée par de grands pharaons tels que Ramsès II.
La plupart des anciens Égyptiens étaient des agriculteurs attachés à la terre. Leurs habitations étaient réservées aux membres de la famille immédiate et étaient construites en briques crues conçues pour rester fraîches dans la chaleur de la journée. Chaque maison avait une cuisine à toit ouvert, qui contenait une meule pour moudre le grain et un petit four pour cuire le pain. Les murs étaient peints en blanc et pouvaient être recouverts de tentures murales en lin teint. Les sols étaient recouverts de nattes de roseau, tandis que des tabourets en bois, des lits surélevés et des tables individuelles constituaient le mobilier.
Les anciens Égyptiens accordaient une grande importance à l’hygiène et à l’apparence. La plupart se baignaient dans le Nil et utilisaient un savon pâteux à base de graisse animale et de craie. Les hommes se rasaient tout le corps pour plus de propreté ; les parfums et les onguents aromatiques couvraient les mauvaises odeurs et apaisaient la peau. Les vêtements étaient confectionnés à partir de simples draps de lin blanchis en blanc, et les hommes et les femmes des classes supérieures portaient des perruques, des bijoux et des cosmétiques. Les enfants restaient nus jusqu'à leur maturité, vers l'âge de 12 ans, et à cet âge les hommes étaient circoncis et avaient la tête rasée. Les mères étaient responsables de s'occuper des enfants, tandis que le père assurait le revenu de la famille.
La musique et la danse étaient des divertissements populaires pour ceux qui en avaient les moyens. Les premiers instruments comprenaient des flûtes et des harpes, tandis que des instruments similaires aux trompettes, hautbois et cornemuses se sont développés plus tard et sont devenus populaires. Au Nouvel Empire, les Égyptiens jouaient des cloches, des cymbales, des tambourins, des tambours et importaient des luths et des lyres d'Asie. Le sistre était un instrument de musique semblable à un hochet, particulièrement important lors des cérémonies religieuses. Les anciens Égyptiens pratiquaient diverses activités de loisirs, notamment des jeux et de la musique. Senet, un jeu de société dans lequel les pièces se déplaçaient selon le hasard, était particulièrement populaire dès les premiers temps ; un autre jeu similaire était le mehen, qui avait un plateau de jeu circulaire.
La jonglerie et les jeux de ballon étaient populaires auprès des enfants, et la lutte est également documentée dans une tombe à Beni Hasan. Les membres riches de la société égyptienne antique appréciaient également la chasse et la navigation de plaisance. Les fouilles du village ouvrier de Deir el-Madinah ont donné lieu à l'un des récits les plus documentés de la vie communautaire du monde antique, qui s'étend sur près de quatre cents ans. Il n’existe aucun site comparable dans lequel l’organisation, les interactions sociales, les conditions de travail et de vie d’une communauté ont été étudiées avec autant de détails.
La cuisine égyptienne est restée remarquablement stable au fil du temps ; en effet, la cuisine de l’Égypte moderne conserve des similitudes frappantes avec la cuisine des anciens. Le régime alimentaire de base se composait de pain et de bière, complétés par des légumes comme les oignons et l'ail, et des fruits comme les dattes et les figues. Le vin et la viande étaient appréciés de tous les jours de fête, tandis que les classes supérieures en consommaient plus régulièrement. Le poisson, la viande et la volaille pouvaient être salés ou séchés et cuits dans des ragoûts ou rôtis sur un gril.
L'architecture de l'Égypte ancienne comprend certaines des structures les plus célèbres au monde : les grandes pyramides de Gizeh et les temples de Thèbes. Des projets de construction étaient organisés et financés par l’État à des fins religieuses et commémoratives, mais aussi pour renforcer le vaste pouvoir du pharaon. Les anciens Égyptiens étaient d’habiles bâtisseurs ; En utilisant uniquement des outils et des instruments de visée simples mais efficaces, les architectes pouvaient construire de grandes structures en pierre avec une grande exactitude et précision qui est encore enviée aujourd'hui.
Les habitations domestiques des Égyptiens de l’élite et des Égyptiens ordinaires ont été construites à partir de matériaux périssables tels que les briques de terre crue et le bois, et n’ont pas survécu. Les paysans vivaient dans des maisons simples, tandis que les palais de l'élite et du pharaon étaient des structures plus élaborées. Quelques palais du Nouvel Empire survivants, comme ceux de Malkata et d'Amarna, présentent des murs et des sols richement décorés avec des scènes de personnages, d'oiseaux, de bassins d'eau, de divinités et de motifs géométriques. Les structures importantes telles que les temples et les tombeaux, censées durer éternellement, étaient construites en pierre plutôt qu'en briques de terre crue. Les éléments architecturaux utilisés dans le premier bâtiment en pierre à grande échelle au monde, le complexe funéraire de Djoser, comprennent des supports de poteaux et de linteaux au motif de papyrus et de lotus.
Les temples égyptiens antiques les plus anciens conservés, comme ceux de Gizeh, se composent de salles uniques et fermées avec des dalles de toit soutenues par des colonnes. Au Nouvel Empire, les architectes ajoutèrent le pylône, la cour ouverte et la salle hypostyle fermée à la façade du sanctuaire du temple, un style qui était standard jusqu'à la période gréco-romaine. L'architecture funéraire la plus ancienne et la plus populaire de l'Ancien Empire était le mastaba, une structure rectangulaire à toit plat en brique crue ou en pierre construite sur une chambre funéraire souterraine. La pyramide à degrés de Djéser est une série de mastabas en pierre empilés les uns sur les autres. Les pyramides ont été construites au cours de l'Ancien et du Moyen Empire, mais la plupart des dirigeants ultérieurs les ont abandonnées au profit de tombes creusées dans la roche, moins visibles. La vingt-cinquième dynastie était une exception notable, car tous les pharaons de la vingt-cinquième dynastie construisaient des pyramides.
Les anciens Égyptiens produisaient de l’art à des fins fonctionnelles. Pendant plus de 3 500 ans, les artistes ont adhéré aux formes artistiques et à l’iconographie développées sous l’Ancien Empire, en suivant un ensemble de principes stricts qui résistaient aux influences étrangères et aux changements internes. Ces normes artistiques – des lignes, des formes et des aplats de couleurs simples combinées à la projection plate caractéristique de figures sans indication de profondeur spatiale – créaient un sentiment d'ordre et d'équilibre au sein d'une composition. Les images et les textes étaient intimement liés sur les murs des tombes et des temples, sur les cercueils, les stèles et même les statues. La palette Narmer, par exemple, affiche des figures qui peuvent également être lues comme des hiéroglyphes.
En raison des règles rigides qui régissaient son apparence hautement stylisée et symbolique, l’art égyptien antique servait ses objectifs politiques et religieux avec précision et clarté. Les artisans égyptiens antiques utilisaient la pierre pour sculpter des statues et de fins reliefs, mais utilisaient le bois comme substitut bon marché et facile à sculpter. Les peintures étaient obtenues à partir de minéraux tels que les minerais de fer (ocres rouges et jaunes), les minerais de cuivre (bleu et vert), la suie ou le charbon de bois (noir) et le calcaire (blanc). Les peintures pouvaient être mélangées avec de la gomme arabique comme liant et pressées en gâteaux, qui pouvaient être humidifiés avec de l'eau si nécessaire.
Les pharaons utilisaient des reliefs pour enregistrer les victoires au combat, les décrets royaux et les scènes religieuses. Les citoyens ordinaires avaient accès à des œuvres d'art funéraire, telles que des statues shabti et des livres des morts, qui, pensaient-ils, les protégeraient dans l'au-delà. Au cours de l'Empire du Milieu, les modèles en bois ou en argile représentant des scènes de la vie quotidienne devinrent des ajouts populaires au tombeau. Dans une tentative de reproduire les activités des vivants dans l’au-delà, ces modèles montrent des ouvriers, des maisons, des bateaux et même des formations militaires qui sont des représentations à l’échelle de l’au-delà idéal de l’Égypte ancienne.
Malgré l'homogénéité de l'art égyptien ancien, les styles d'époques et de lieux particuliers reflétaient parfois des attitudes culturelles ou politiques changeantes. Après l'invasion des Hyksos au cours de la Deuxième Période Intermédiaire, des fresques de style minoen ont été découvertes à Avaris. L'exemple le plus frappant d'un changement politique dans les formes artistiques vient de la période amarnienne, où les figures ont été radicalement modifiées pour se conformer aux idées religieuses révolutionnaires d'Akhenaton. Ce style, connu sous le nom d'art amarnien, fut rapidement et complètement effacé après la mort d'Akhenaton et remplacé par les formes traditionnelles.
Les croyances au divin et à l’au-delà étaient enracinées dans la civilisation égyptienne antique depuis sa création ; La domination pharaonique était fondée sur le droit divin des rois. Le panthéon égyptien était peuplé de dieux dotés de pouvoirs surnaturels et appelés à l’aide ou à la protection. Cependant, les dieux n’étaient pas toujours considérés comme bienveillants et les Égyptiens pensaient qu’il fallait les apaiser par des offrandes et des prières. La structure de ce panthéon changeait continuellement à mesure que de nouvelles divinités étaient promues dans la hiérarchie, mais les prêtres ne faisaient aucun effort pour organiser les mythes et histoires divers et parfois contradictoires en un système cohérent. Ces différentes conceptions de la divinité n’étaient pas considérées comme contradictoires mais plutôt comme des couches des multiples facettes de la réalité.
Les dieux étaient vénérés dans des temples de culte administrés par des prêtres agissant au nom du roi. Au centre du temple se trouvait la statue du culte dans un sanctuaire. Les temples n'étaient pas des lieux de culte public ou de congrégation, et ce n'est que lors de certains jours de fête et celebrations qu'un sanctuaire portant la statue du dieu était exposé au culte public. Normalement, le domaine du dieu était isolé du monde extérieur et n'était accessible qu'aux fonctionnaires du temple. Les citoyens ordinaires pouvaient vénérer des statues privées chez eux et les amulettes offraient une protection contre les forces du chaos. Après le Nouvel Empire, le rôle du pharaon en tant qu'intermédiaire spirituel a été atténué à mesure que les coutumes religieuses se sont déplacées vers un culte direct des dieux. En conséquence, les prêtres développèrent un système d’oracles pour communiquer la volonté des dieux directement au peuple.
Les Égyptiens croyaient que chaque être humain était composé de parties ou d’aspects physiques et spirituels. En plus du corps, chaque personne avait un šwt (ombre), un ba (personnalité ou âme), un ka (force vitale) et un nom. Le cœur, plutôt que le cerveau, était considéré comme le siège des pensées et des émotions. Après la mort, les aspects spirituels étaient libérés du corps et pouvaient se déplacer à volonté, mais ils nécessitaient les restes physiques (ou un substitut, comme une statue) comme foyer permanent. Le but ultime du défunt était de rejoindre son ka et son ba et de devenir l'un des « morts bénis », vivant comme un akh, ou « un mort efficace ». Pour que cela se produise, le défunt devait être jugé digne lors d'un procès au cours duquel le cœur était mis en balance avec une « plume de vérité ». S’il en est jugé digne, le défunt pourrait continuer son existence sur terre sous forme spirituelle.
Les anciens Égyptiens maintenaient un ensemble complexe de coutumes funéraires qu’ils croyaient nécessaires pour garantir l’immortalité après la mort. Ces coutumes impliquaient la préservation du corps par momification, la réalisation de cérémonies d'enterrement et l'inhumation avec les biens du corps que le défunt utiliserait dans l'au-delà. Avant l’Ancien Empire, les corps enterrés dans les fosses du désert étaient naturellement préservés par dessiccation. Les conditions arides et désertiques ont été une aubaine tout au long de l’histoire de l’Égypte ancienne pour les enterrements des pauvres, qui ne pouvaient pas se permettre les préparations funéraires élaborées dont disposait l’élite. Les Égyptiens les plus riches ont commencé à enterrer leurs morts dans des tombes en pierre et à recourir à la momification artificielle, qui consistait à retirer les organes internes, à envelopper le corps dans du lin et à l'enterrer dans un sarcophage rectangulaire en pierre ou un cercueil en bois. À partir de la IVe dynastie, certaines parties étaient conservées séparément dans des canopes.
Au Nouvel Empire, les anciens Égyptiens avaient perfectionné l’art de la momification ; la meilleure technique prenait 70 jours et impliquait l'ablation des organes internes, l'ablation du cerveau par le nez et la dessèchement du corps dans un mélange de sels appelé natron. Le corps était ensuite enveloppé dans du lin avec des amulettes de protection insérées entre les couches et placé dans un cercueil anthropoïde décoré. Les momies de la Basse Époque étaient également placées dans des caisses à momies en cartonnage peint. Les pratiques de préservation réelles ont décliné au cours des époques ptolémaïque et romaine, tandis qu'une plus grande importance a été accordée à l'apparence extérieure de la momie, qui était décorée.
Les riches Égyptiens étaient enterrés avec de plus grandes quantités d'objets de luxe, mais toutes les sépultures, quel que soit leur statut social, comprenaient des biens destinés au défunt. À partir du Nouvel Empire, les livres des morts étaient inclus dans la tombe, ainsi que des statues shabti censées effectuer un travail manuel pour eux dans l'au-delà. Des rituels au cours desquels le défunt était réanimé par magie accompagnaient les enterrements. Après l'enterrement, les parents vivants devaient occasionnellement apporter de la nourriture au tombeau et réciter des prières en faveur du défunt.
L'armée égyptienne antique était chargée de défendre l'Égypte contre les invasions étrangères et de maintenir la domination égyptienne sur l'ancien Proche-Orient. L'armée a protégé les expéditions minières dans le Sinaï pendant l'Ancien Empire et a mené des guerres civiles pendant la première et la deuxième période intermédiaire. L'armée était chargée d'entretenir les fortifications le long des routes commerciales importantes, comme celles de la ville de Bouhen sur la route vers la Nubie. Des forts furent également construits pour servir de bases militaires, comme la forteresse de Sile, qui servait de base d'opérations pour les expéditions au Levant. Au Nouvel Empire, une série de pharaons ont utilisé l’armée égyptienne permanente pour attaquer et conquérir Kouch et certaines parties du Levant.
L'équipement militaire typique comprenait des arcs et des flèches, des lances et des boucliers arrondis fabriqués en étirant de la peau d'animal sur un cadre en bois. Au Nouvel Empire, l'armée a commencé à utiliser des chars qui avaient été introduits auparavant par les envahisseurs Hyksos. Les armes et armures ont continué à s'améliorer après l'adoption du bronze : les boucliers étaient désormais fabriqués en bois massif avec une boucle en bronze, les lances étaient terminées par une pointe en bronze et le Khopesh a été adopté par les soldats asiatiques. Le pharaon était généralement représenté dans l’art et la littérature chevauchant à la tête de l’armée ; il a été suggéré qu'au moins quelques pharaons, comme Seqenenre Tao II et ses fils, l'ont fait. Cependant, il a également été avancé que « les rois de cette période n’agissaient pas personnellement en tant que chefs de guerre de première ligne, combattant aux côtés de leurs troupes ». Les soldats étaient recrutés parmi la population générale, mais pendant et surtout après le Nouvel Empire, des mercenaires de Nubie, de Kouch et de Libye furent embauchés pour combattre pour l'Égypte.
En technologie, médecine et mathématiques, l’Égypte ancienne atteignait un niveau de productivité et de sophistication relativement élevé. L'empirisme traditionnel, comme en témoignent les papyrus d'Edwin Smith et d'Ebers (vers 1600 avant JC), est attribué pour la première fois à l'Égypte. Les Égyptiens ont créé leur propre alphabet et système décimal. Même avant l’Ancien Empire, les anciens Égyptiens avaient développé un matériau vitreux appelé faïence, qu’ils traitaient comme une sorte de pierre semi-précieuse artificielle. La faïence est une céramique non argileuse composée de silice, de petites quantités de chaux et de soude et d'un colorant, généralement du cuivre. Le matériau était utilisé pour fabriquer des perles, des tuiles, des figurines et de petits objets. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour créer de la faïence, mais la production impliquait généralement l'application de matériaux en poudre sous forme de pâte sur un noyau d'argile, qui était ensuite cuit. Par une technique connexe, les anciens Égyptiens produisaient un pigment connu sous le nom de bleu égyptien, également appelé fritte bleue, qui est produit par fusion (ou frittage) de silice, de cuivre, de chaux et d'un alcali tel que le natron. Le produit peut être broyé et utilisé comme pigment.
Les anciens Égyptiens pouvaient fabriquer une grande variété d’objets en verre avec une grande habileté, mais il n’est pas clair s’ils ont développé ce procédé de manière indépendante. On ne sait pas non plus s’ils fabriquaient leur propre verre brut ou s’ils importaient simplement des lingots préfabriqués, qu’ils fondaient et finissaient. Cependant, ils possédaient une expertise technique dans la fabrication d’objets, ainsi que dans l’ajout d’oligo-éléments pour contrôler la couleur du verre fini. Une gamme de couleurs pouvait être produite, notamment le jaune, le rouge, le vert, le bleu, le violet et le blanc, et le verre pouvait être transparent ou opaque.
Les problèmes médicaux des anciens Égyptiens découlaient directement de leur environnement. Vivre et travailler près du Nil présentait des risques liés au paludisme et aux parasites débilitants de la schistosomiase, qui causaient des lésions hépatiques et intestinales. Les espèces sauvages dangereuses telles que les crocodiles et les hippopotames constituaient également une menace courante. Les travaux agricoles et de construction qui ont duré toute une vie ont exercé une pression sur la colonne vertébrale et les articulations, et les blessures traumatiques causées par la construction et la guerre ont toutes eu des conséquences néfastes sur le corps. Les grains et le sable de la farine moulue sur pierre abrasaient les dents, les rendant vulnérables aux abcès. L’alimentation des riches était riche en sucres, ce qui favorisait les maladies parodontales. Malgré les physiques flatteurs représentés sur les murs des tombes, les momies en surpoids de nombreux membres de la classe supérieure montrent les effets d'une vie d'excès. L'espérance de vie adulte était d'environ 35 ans pour les hommes et 30 ans pour les femmes, mais atteindre l'âge adulte était difficile car environ un tiers de la population mourait en bas âge.
Les médecins égyptiens antiques étaient réputés au Proche-Orient pour leurs compétences en matière de guérison, et certains, comme Imhotep, sont restés célèbres longtemps après leur mort. Hérodote a fait remarquer qu'il existait un haut degré de spécialisation parmi les médecins égyptiens, certains ne traitant que la tête ou l'estomac, tandis que d'autres étaient ophtalmologistes et dentistes. La formation des médecins avait lieu à l'institution Per Ankh ou « Maison de Vie », notamment celles dont le siège était à Per-Bastet au Nouvel Empire et à Abydos et Saïs à la fin de la période. Les papyrus médicaux montrent une connaissance empirique de l'anatomie, des blessures et des traitements pratiques.
Les blessures étaient traitées par des bandages avec de la viande crue, du linge blanc, des sutures, des filets, des tampons et des tampons imbibés de miel pour prévenir l'infection, tandis que du thym à opium et de la belladone étaient utilisés pour soulager la douleur. Les premiers enregistrements de traitement des brûlures décrivent des pansements pour brûlures utilisant le lait des mères de bébés mâles. Des prières étaient adressées à la déesse Isis. Du pain moisi, du miel et des sels de cuivre étaient également utilisés pour prévenir l'infection par la saleté des brûlures. L'ail et les oignons étaient utilisés régulièrement pour promouvoir une bonne santé et étaient censés soulager les symptômes de l'asthme. Les chirurgiens égyptiens antiques recousaient les plaies, réparaient les os brisés et amputaient les membres malades, mais ils reconnaissaient que certaines blessures étaient si graves qu'elles ne pouvaient que mettre le patient à l'aise jusqu'à ce que la mort survienne.
Les premiers Égyptiens savaient comment assembler des planches de bois pour former une coque de navire et maîtrisaient les formes avancées de construction navale dès 3000 avant JC. L'Institut archéologique d'Amérique rapporte que les plus anciens navires en planches connus sont les bateaux Abydos. Un groupe de 14 navires découverts à Abydos étaient construits à partir de planches de bois « cousues » ensemble. Découvertes par l'égyptologue David O'Connor de l'Université de New York, des sangles tissées étaient utilisées pour attacher les planches ensemble, et des roseaux ou de l'herbe coincés entre les planches aidaient à sceller les coutures. Parce que les navires sont tous enterrés ensemble et à proximité d'une morgue appartenant au pharaon Khasekhemwy, on pensait à l'origine qu'ils lui appartenaient tous, mais l'un des 14 navires date de 3000 avant JC, et les pots de poterie associés enterrés avec les navires suggèrent également une date antérieure. datation.
Le navire datant de 3000 avant JC mesurait 75 pieds de long et on pense maintenant qu'il aurait appartenu à un pharaon antérieur. Selon le professeur O'Connor, le navire vieux de 5 000 ans aurait même appartenu au pharaon Aha. Les premiers Égyptiens savaient également comment assembler des planches de bois avec des clous pour les fixer ensemble, en utilisant de la poix pour calfeutrer les joints. Le « navire Khéops », un navire de 143 pieds enfermé dans une fosse du complexe pyramidal de Gizeh au pied de la Grande Pyramide de Gizeh sous la Quatrième Dynastie vers 2500 avant JC, est un exemple survivant grandeur nature qui aurait pu remplir la fonction symbolique. d'une barque solaire. Les premiers Égyptiens savaient également comment fixer les planches de ce navire avec des tenons et des mortaises.
On sait que les grands navires de mer ont été largement utilisés par les Égyptiens dans leur commerce avec les cités-États de la Méditerranée orientale, en particulier Byblos (sur la côte de l'actuel Liban), et dans plusieurs expéditions sur la mer Rouge jusqu'au pays de Coup de volée. En fait, l'un des premiers mots égyptiens désignant un navire de mer est « Navire de Byblos », qui définissait à l'origine une classe de navires de mer égyptiens utilisés sur la route de Byblos ; cependant, à la fin de l’Ancien Empire, le terme en était venu à inclure les grands navires de mer, quelle que soit leur destination.
En 2011, des archéologues d'Italie, des États-Unis et d'Égypte, fouillant une lagune asséchée connue sous le nom de Mersa Gawasis, ont mis au jour des traces d'un ancien port qui lançait autrefois les premiers voyages comme l'expédition Pount d'Hatchepsout en pleine mer. Certaines des preuves les plus évocatrices du site sur les prouesses maritimes des anciens Égyptiens comprennent de grandes poutres de navire et des centaines de pieds de cordes, fabriquées à partir de papyrus, enroulées en énormes paquets. Et en 2013, une équipe d'archéologues franco-égyptiens a découvert ce qui est considéré comme le port le plus ancien du monde, datant d'environ 4 500 ans, de l'époque du roi Khéops, sur la côte de la mer Rouge, près de Wadi el-Jarf (à environ 180 km au sud de Suez). ). En 1977, un ancien canal nord-sud datant de l’Empire du Milieu égyptien a été découvert, s’étendant du lac Timsah aux lacs Ballah. Il a été daté de l'Empire du Milieu égyptien en extrapolant les dates des sites antiques construits le long de son parcours.
Les premiers exemples attestés de calculs mathématiques datent de la période prédynastique de Naqada et montrent un système numérique pleinement développé. L'importance des mathématiques pour un Égyptien instruit est suggérée par une lettre fictive du Nouvel Empire dans laquelle l'écrivain propose une compétition scientifique entre lui et un autre scribe concernant les tâches de calcul quotidiennes telles que la comptabilité de la terre, du travail et des céréales. Des textes tels que le papyrus mathématique de Rhind et le papyrus mathématique de Moscou montrent que les anciens Égyptiens pouvaient effectuer les quatre opérations mathématiques de base : addition, soustraction, multiplication et division, utiliser des fractions, calculer les volumes de boîtes et de pyramides et calculer les surfaces. de rectangles, de triangles et de cercles. Ils comprenaient les concepts de base de l’algèbre et de la géométrie et pouvaient résoudre des ensembles simples d’équations simultanées.
La notation mathématique était décimale et basée sur des signes hiéroglyphiques pour chaque puissance de dix à un million. Chacun de ces éléments pourrait être écrit autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre souhaité ; ainsi, pour écrire le nombre quatre-vingt ou huit cents, le symbole dix ou cent était écrit respectivement huit fois. Parce que leurs méthodes de calcul ne pouvaient pas gérer la plupart des fractions dont le numérateur était supérieur à un, ils ont dû écrire les fractions comme la somme de plusieurs fractions. Par exemple, ils ont résolu la fraction deux cinquièmes en la somme d’un tiers + un quinzième. Des tableaux de valeurs standard ont facilité cela. Certaines fractions courantes, cependant, étaient écrites avec un glyphe spécial : l'équivalent des deux tiers modernes est indiqué à droite.
Les mathématiciens de l’Égypte ancienne connaissaient les principes qui sous-tendent le théorème de Pythagore, sachant par exemple qu’un triangle avait un angle droit opposé à l’hypoténuse lorsque ses côtés étaient dans un rapport de 3-4-5. Ils ont pu estimer l’aire d’un cercle en soustrayant un neuvième de son diamètre et en mettant le résultat au carré. Le nombre d'or semble se refléter dans de nombreuses constructions égyptiennes, y compris les pyramides, mais son utilisation pourrait être une conséquence involontaire de la pratique égyptienne ancienne consistant à combiner l'utilisation de cordes nouées avec un sens intuitif des proportions et de l'harmonie.
Une équipe dirigée par Johannes Krause a réussi le premier séquençage fiable du génome de 90 individus momifiés en 2017. Bien que non concluante, en raison de la période non exhaustive et de la localisation restreinte que représentent les momies, leur étude a néanmoins montré que ces anciens Égyptiens « ressemblaient beaucoup aux populations anciennes et modernes du Proche-Orient, en particulier celles du Levant, et n'avaient presque aucun ADN provenant de Afrique sub-saharienne. De plus, la génétique des momies est restée remarquablement cohérente même lorsque différentes puissances, notamment les Nubiens, les Grecs et les Romains, ont conquis l'empire. » Plus tard, cependant, quelque chose a modifié le génome des Égyptiens. Bien que les momies ne contiennent presque aucun ADN provenant d’Afrique subsaharienne, environ 15 à 20 % de l’ADN des Égyptiens modernes reflète une ascendance subsaharienne.
La culture et les monuments de l’Égypte ancienne ont laissé un héritage durable au monde. Le culte de la déesse Isis, par exemple, est devenu populaire dans l’Empire romain, à mesure que les obélisques et autres reliques étaient ramenés à Rome. Les Romains importaient également des matériaux de construction d’Égypte pour ériger des structures de style égyptien. Les premiers historiens tels qu'Hérodote, Strabon et Diodore de Sicile ont étudié et écrit sur cette terre, que les Romains en sont venus à considérer comme un lieu mystérieux. Au Moyen Âge et à la Renaissance, la culture païenne égyptienne était en déclin après la montée du christianisme et plus tard de l'islam, mais l'intérêt pour l'antiquité égyptienne s'est poursuivi dans les écrits d'érudits médiévaux tels que Dhul-Nun al-Misri et al-Maqrizi.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les voyageurs et touristes européens rapportèrent des antiquités et écrivirent des récits de leurs voyages, déclenchant une vague d’égyptomanie à travers l’Europe. Ce regain d'intérêt envoya des collectionneurs en Égypte, qui prirent, achetèrent ou reçurent de nombreuses antiquités importantes. Bien que l'occupation coloniale européenne de l'Égypte ait détruit une partie importante de l'héritage historique du pays, certains étrangers ont laissé des traces plus positives. Napoléon, par exemple, a organisé les premières études d'égyptologie lorsqu'il a amené quelque 150 scientifiques et artistes pour étudier et documenter l'histoire naturelle de l'Égypte, publiée dans la Description de l'Égypte.
Au XXe siècle, le gouvernement égyptien et les archéologues ont reconnu l'importance du respect et de l'intégrité culturelle dans les fouilles. Le Conseil suprême des antiquités approuve et supervise désormais toutes les fouilles, qui visent à trouver des informations plutôt que des trésors. Le conseil supervise également les programmes de reconstruction de musées et de monuments destinés à préserver l'héritage historique de l'Égypte. [Wikipédia].
AVIS: L'Égypte est un pays d'Afrique du Nord, au bord de la mer Méditerranée, et abrite l'une des plus anciennes civilisations de la planète. Le nom « Égypte » vient du grec Aegyptos qui était la prononciation grecque du nom égyptien « Hwt-Ka-Ptah » (« Maison de l'esprit de Ptah »), à l'origine le nom de la ville de Memphis. Memphis était la première capitale de l'Égypte et un célèbre centre religieux et commercial ; son statut élevé est attesté par les Grecs faisant allusion à l'ensemble du pays par ce nom. Pour les Égyptiens eux-mêmes, leur pays était simplement connu sous le nom de Kemet, ce qui signifie «Terre noire», ainsi nommé pour le sol riche et sombre le long du Nil où les premières colonies ont commencé. Plus tard, le pays était connu sous le nom de Misr qui signifie «pays», un nom encore utilisé par les Égyptiens pour leur nation de nos jours.
L'Égypte a prospéré pendant des milliers d'années (d'environ 8000 avant JC à 30 avant JC) en tant que nation indépendante dont la culture était célèbre pour ses grandes avancées culturelles dans tous les domaines de la connaissance humaine, des arts à la science en passant par la technologie et la religion. Les grands monuments pour lesquels l'Egypte est encore célébrée reflètent la profondeur et la grandeur de la culture égyptienne qui a influencé tant de civilisations anciennes, dont la Grèce et Rome. L'une des raisons de la popularité durable de la culture égyptienne est l'accent mis sur la grandeur de l'expérience humaine. Leurs grands monuments, tombeaux, temples et œuvres d'art célèbrent tous la vie et rappellent ce qui était autrefois et ce que les êtres humains, à leur meilleur, sont capables de réaliser. Bien que l'Égypte dans la culture populaire soit souvent associée à la mort et aux rites mortuaires, quelque chose même dans ceux-ci parle aux gens à travers les âges de ce que signifie être un être humain et du pouvoir et du but du souvenir.
Pour les Égyptiens, la vie sur terre n'était qu'un aspect d'un voyage éternel. L'âme était immortelle et n'habitait un corps sur ce plan physique que pendant une courte période. À la mort, on rencontrerait le jugement dans la salle de vérité et, si cela était justifié, on passerait à un paradis éternel connu sous le nom de Champ de roseaux qui était une image miroir de sa vie sur terre. Une fois arrivé au paradis, on pouvait vivre paisiblement en compagnie de ceux qu'on avait aimés sur terre, y compris ses animaux de compagnie, dans le même quartier par la même vapeur, sous les mêmes arbres qu'on croyait avoir perdus à la mort. Cette vie éternelle, cependant, n'était accessible qu'à ceux qui avaient bien vécu et conformément à la volonté des dieux dans le lieu le plus parfait propice à un tel but : la terre d'Égypte.
L'Égypte a une longue histoire qui remonte bien au-delà de l'écrit, des histoires des dieux ou des monuments qui ont fait la renommée de la culture. La preuve du surpâturage du bétail, sur la terre qui est maintenant le désert du Sahara, a été datée d'environ 8000 av. J.-C. Cette preuve, ainsi que les artefacts découverts, indiquent une civilisation agricole florissante dans la région à cette époque. Comme la terre était pour la plupart aride même alors, les nomades chasseurs-cueilleurs ont cherché la fraîcheur de la source d'eau de la vallée du Nil et ont commencé à s'y installer quelque temps avant 6000 av.
L'agriculture organisée a commencé dans la région vers 6000 avant JC et les communautés connues sous le nom de culture badarienne ont commencé à prospérer le long de la rivière. L'industrie s'est développée à peu près à la même époque, comme en témoignent les ateliers de faïence découverts à Abydos datant d'environ 5500 av. qui ont tous contribué de manière significative au développement de ce qui est devenu la civilisation égyptienne. L'histoire écrite de la terre commence à un moment donné entre 3400 et 3200 avant JC lorsque l'écriture hiéroglyphique est développée par la culture Naqada III.
Vers 3500 av. J.-C., la momification des morts était pratiquée dans la ville de Hierakonpolis et de grandes tombes en pierre construites à Abydos. La ville de Xois est enregistrée comme étant déjà ancienne vers 3100-2181 av. J.-C. comme inscrit sur la célèbre pierre de Palerme. Comme dans d'autres cultures du monde, les petites communautés agraires se sont centralisées et sont devenues de plus grands centres urbains. La prospérité a conduit, entre autres, à une augmentation du brassage de la bière, à plus de temps libre pour sports et aux progrès de la médecine.
La période dynastique précoce (vers 3150-2613 av. J.-C.) a vu l'unification des royaumes du nord et du sud de l'Égypte sous le roi Menes (également connu sous le nom de Meni ou Manes) de Haute-Égypte qui a conquis la Basse-Égypte vers 3118 av. J.-C. ou vers 3150 av. La version de l'histoire ancienne provient de l'Aegyptica (Histoire de l'Égypte) de l'ancien historien Manéthon qui a vécu au IIIe siècle avant J.-C. sous la dynastie ptolémaïque (323-30 avant J.-C.). Bien que sa chronologie ait été contestée par les historiens ultérieurs, elle est encore régulièrement consultée sur la succession dynastique et l'histoire ancienne de l'Égypte.
L'ouvrage de Manéthon est la seule source qui cite Ménès et la conquête et on pense maintenant que l'homme auquel Manéthon fait référence sous le nom de « Ménès » était le roi Narmer qui uni pacifiquement la Haute et la Basse-Égypte sous un même règne. L'identification de Ménès avec Narmer est loin d'être universellement acceptée, cependant, et Ménès a été lié de manière aussi crédible au roi Hor-Aha (vers 3100-3050 avant JC) qui lui a succédé. Une explication de l'association de Ménès avec son prédécesseur et successeur est que «Ménès» est un titre honorifique signifiant «celui qui endure» et non un nom personnel et aurait donc pu être utilisé pour désigner plus d'un roi. L'affirmation selon laquelle la terre a été unifiée par une campagne militaire est également contestée car la célèbre palette de Narmer, représentant une victoire militaire, est considérée par certains érudits comme de la propagande royale. Le pays a peut-être d'abord été uni pacifiquement, mais cela semble peu probable.
La désignation géographique en Égypte suit la direction du Nil et la Haute-Égypte est donc la région sud et la Basse-Égypte la région nord la plus proche de la mer Méditerranée. Narmer a régné depuis la ville de Heirakonopolis, puis depuis Memphis et Abydos. Le commerce a considérablement augmenté sous les dirigeants de la période dynastique précoce et les tombes mastaba élaborées, précurseurs des pyramides ultérieures, se sont développées dans des pratiques funéraires rituelles qui comprenaient des techniques de momification de plus en plus élaborées.
Dès la période pré-dynastique (vers 6000-3150 av. J.-C.), une croyance aux dieux définit la culture égyptienne. Un mythe de la création égyptienne ancienne raconte l'histoire du dieu Atoum qui se tenait au milieu d'un chaos tourbillonnant avant le début des temps et a donné naissance à la création. Atoum était accompagné de la force éternelle de heka (magie), personnifiée dans le dieu Heka et d'autres forces spirituelles qui animaient le monde. Heka était la force primordiale qui a infusé l'univers et a fait que toutes les choses fonctionnent comme elles le faisaient; il a également tenu compte de la valeur centrale de la culture égyptienne : maât, harmonie et équilibre.
Tous les dieux et toutes leurs responsabilités sont revenus à ma'at et heka. Le soleil se levait et se couchait comme il le faisait et la lune suivait sa course dans le ciel et les saisons allaient et venaient conformément à l'équilibre et à l'ordre qui étaient possibles grâce à ces deux agents. Ma'at était également personnifiée comme une divinité, la déesse de la plume d'autruche, à qui chaque roi promettait ses pleines capacités et sa dévotion. Le roi était associé au dieu Horus dans la vie et à Osiris dans la mort sur la base d'un mythe devenu le plus populaire de l'histoire égyptienne.
Osiris et sa sœur-épouse Isis étaient les premiers monarques qui gouvernaient le monde et donnaient au peuple les dons de la civilisation. Le frère d'Osiris, Set, est devenu jaloux de lui et l'a assassiné, mais il a été ramené à la vie par Isis qui a ensuite enfanté son fils Horus. Osiris était cependant incomplet et descendit ainsi pour gouverner le monde souterrain tandis qu'Horus, une fois mûri, vengea son père et vainquit Seth. Ce mythe illustrait comment l'ordre triomphait du chaos et deviendrait un motif persistant dans les rituels mortuaires, les textes et l'art religieux. Il n'y a pas eu de période où les dieux n'ont pas joué un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Égyptiens et cela se voit clairement dès les premiers temps de l'histoire du pays.
Au cours de la période connue sous le nom d'Ancien Empire (vers 2613-2181 av. J.-C.), l'architecture honorant les dieux s'est développée à un rythme accéléré et certains des monuments les plus célèbres d'Égypte, tels que les pyramides et le Grand Sphinx de Gizeh, ont été construits. Le roi Djoser, qui régna vers 2670 av. J.-C., construisit la première pyramide à degrés à Saqqarah vers 2670, conçue par son architecte en chef et médecin Imhotep (vers 2667-2600 av. J.-C.) qui écrivit également l'un des premiers textes médicaux décrivant le traitement de plus de 200 différentes maladies et arguant que la cause de la maladie pourrait être naturelle, et non la volonté des dieux. La Grande Pyramide de Khufu (dernière des sept merveilles du monde antique) a été construite sous son règne (2589-2566 avant JC) avec les pyramides de Khafre (2558-2532 avant JC) et Menkaure (2532-2503 avant JC) après.
La grandeur des pyramides du plateau de Gizeh, telles qu'elles auraient dû apparaître à l'origine, gainées de calcaire blanc étincelant, témoigne de la puissance et de la richesse des dirigeants de cette période. De nombreuses théories abondent sur la manière dont ces monuments et tombes ont été construits, mais les architectes et les érudits modernes sont loin d'être d'accord sur une seule. Compte tenu de la technologie de l'époque, certains ont soutenu qu'un monument tel que la Grande Pyramide de Gizeh ne devrait pas exister. D'autres prétendent, cependant, que l'existence de tels bâtiments et tombes suggère une technologie supérieure qui a été perdue avec le temps.
Il n'y a absolument aucune preuve que les monuments du plateau de Gizeh - ou d'autres en Egypte - aient été construits par des esclaves et il n'y a aucune preuve pour soutenir une lecture historique du livre biblique de l'Exode. La plupart des érudits réputés rejettent aujourd'hui l'affirmation selon laquelle les pyramides et autres monuments ont été construits par des esclaves, bien que des esclaves de différentes nationalités existaient certainement en Égypte et étaient régulièrement employés dans les mines. Les monuments égyptiens étaient considérés comme des travaux publics créés pour l'État et utilisaient des ouvriers égyptiens qualifiés et non qualifiés dans la construction, qui étaient tous payés pour leur travail. Les travailleurs du site de Gizeh, qui n'était qu'un parmi tant d'autres, ont reçu une ration de bière trois fois par jour et leur logement, leurs outils et même leur niveau de soins de santé ont tous été clairement établis.
L'ère connue sous le nom de première période intermédiaire (2181-2040 av. J.-C.) a vu un déclin du pouvoir du gouvernement central suite à son effondrement. Des districts largement indépendants avec leurs propres gouverneurs se sont développés dans toute l'Égypte jusqu'à l'émergence de deux grands centres : Hierakonpolis en Basse-Égypte et Thèbes en Haute-Égypte. Ces centres ont fondé leurs propres dynasties qui ont gouverné leurs régions de manière indépendante et se sont battues par intermittence pour le contrôle suprême jusqu'à environ 2040 avant JC, lorsque le roi thébain Mentuhotep II (vers 2061-2010 avant JC) a vaincu les forces de Hiérakonpolis et uni l'Égypte sous le règne de Thèbes. .
La stabilité apportée par la domination thébaine a permis l'épanouissement de ce qu'on appelle l'Empire du Milieu (2040-1782 av. J.-C.). L'Empire du Milieu est considéré comme l'"âge classique" de l'Égypte, lorsque l'art et la culture ont atteint de grands sommets et que Thèbes est devenue la ville la plus importante et la plus riche du pays. Selon les historiens Oakes et Gahlin, "les rois de la douzième dynastie étaient des dirigeants puissants qui ont établi le contrôle non seulement sur l'ensemble de l'Égypte, mais aussi sur la Nubie au sud, où plusieurs forteresses ont été construites pour protéger les intérêts commerciaux égyptiens". La première armée permanente a été créée pendant l'Empire du Milieu par le roi Amenemhat I (vers 1991-1962 avant JC) le temple de Karnak a été commencé sous Senruset I (vers 1971-1926 avant JC), et certains des plus grands arts et littérature de la civilisation a été produit. La 13e dynastie, cependant, était plus faible que la 12e et distraite par des problèmes internes qui ont permis à un peuple étranger connu sous le nom de Hyksos de prendre le pouvoir en Basse-Égypte autour du delta du Nil.
Les Hyksos sont un peuple mystérieux, probablement originaire de la région de Syrie/Palestine, qui est apparu pour la première fois en Égypte vers 1800 et s'est installé dans la ville d'Avaris. Alors que les noms des rois Hyksos sont d'origine sémitique, aucune appartenance ethnique précise n'a été établie pour eux. Les Hyksos ont gagné en puissance jusqu'à ce qu'ils soient capables de prendre le contrôle d'une partie importante de la Basse-Égypte vers 1720 av. J.-C., faisant de la dynastie thébaine de la Haute-Égypte presque un État vassal.
Cette époque est connue sous le nom de deuxième période intermédiaire (vers 1782-1570 av. J.-C.). Alors que les Hyksos (dont le nom signifie simplement « dirigeants étrangers ») étaient détestés par les Égyptiens, ils ont introduit de nombreuses améliorations dans la culture, telles que l'arc composite, le cheval et le char, ainsi que la rotation des cultures et les développements du bronze et de la céramique. travaux. En même temps, les Hyksos contrôlaient les ports de la Basse-Égypte, en 1700 avant JC, le royaume de Koush s'était élevé au sud de Thèbes en Nubie et tenait maintenant cette frontière. Les Égyptiens organisèrent un certain nombre de campagnes pour chasser les Hyksos et soumettre les Nubiens, mais toutes échouèrent jusqu'à ce que le prince Ahmose Ier de Thèbes (vers 1570-1544 av. J.-C.) réussisse et unifie le pays sous la domination thébaine.
Ahmose I a initié ce que l'on appelle la période du Nouvel Empire (vers 1570 - vers 1069 avant JC) qui a de nouveau vu une grande prospérité dans le pays sous un gouvernement central fort. Le titre de pharaon pour le souverain de l'Egypte vient de la période du Nouvel Empire ; les premiers monarques étaient simplement connus sous le nom de rois. Bon nombre des souverains égyptiens les plus connus aujourd'hui ont régné pendant cette période et la majorité des grandes structures de l'Antiquité telles que le Ramesseum, Abou Simbel, les temples de Karnak et de Louxor, et les tombeaux de la Vallée des Rois et de la Vallée des Reines ont été créés ou grandement améliorés pendant cette période.
Entre 1504 et 1492 av. J.-C., le pharaon Thoutmosis Ier consolida son pouvoir et étendit les frontières de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate au nord, la Syrie et la Palestine à l'ouest et la Nubie au sud. Son règne a été suivi par la reine Hatchepsout (1479-1458 av. J.-C.) qui a considérablement développé le commerce avec d'autres nations, notamment le Pays de Pount. Son règne de 22 ans fut un règne de paix et de prospérité pour l'Égypte.
Son successeur, Thoutmosis III, a poursuivi sa politique (bien qu'il ait essayé d'éradiquer tout souvenir d'elle car, pense-t-on, il ne voulait pas qu'elle serve de modèle aux autres femmes puisque seuls les hommes étaient considérés comme dignes de régner) et , au moment de sa mort en 1425 av. J.-C., l'Égypte était une nation grande et puissante. La prospérité a conduit, entre autres, à une augmentation du brassage de la bière dans de nombreuses variétés différentes et à plus de temps libre pour sports . Les progrès de la médecine ont permis d'améliorer la santé.
Le bain était depuis longtemps une partie importante du régime quotidien des Égyptiens car il était encouragé par leur religion et modelé par leur clergé. À cette époque, cependant, des bains plus élaborés ont été produits, sans doute plus pour les loisirs que simplement pour l'hygiène. Le papyrus gynécologique de Kahun, concernant la santé des femmes et les contraceptifs, avait été écrit vers 1800 avant JC et, pendant cette période, semble avoir été largement utilisé par les médecins. La chirurgie et la dentisterie étaient toutes deux largement pratiquées et avec une grande habileté, et la bière était prescrite par les médecins pour soulager les symptômes de plus de 200 maladies différentes.
En 1353 av. J.-C., le pharaon Amenhotep IV accéda au trône et, peu de temps après, changea son nom en Akhenaton (« esprit vivant d'Aton ») pour refléter sa croyance en un dieu unique, Aton. Les Égyptiens, comme indiqué ci-dessus, croyaient traditionnellement en de nombreux dieux dont l'importance influençait tous les aspects de leur vie quotidienne. Parmi les plus populaires de ces divinités figuraient Amon, Osiris, Isis et Hathor. Le culte d'Amon, à cette époque, était devenu si riche que les prêtres étaient presque aussi puissants que le pharaon. Akhenaton et sa reine, Néfertiti, ont renoncé aux croyances et coutumes religieuses traditionnelles de l'Égypte et ont institué une nouvelle religion basée sur la reconnaissance d'un dieu unique.
Ses réformes religieuses ont effectivement coupé le pouvoir des prêtres d'Amon et l'ont placé entre ses mains. Il a déplacé la capitale de Thèbes à Amarna pour éloigner davantage son règne de celui de ses prédécesseurs. C'est ce qu'on appelle la période amarnienne (1353-1336 av. J.-C.) au cours de laquelle Amarna devint la capitale du pays et les coutumes religieuses polythéistes furent interdites. Parmi ses nombreuses réalisations, Akhenaton a été le premier souverain à décréter la statuaire et un temple en l'honneur de sa reine au lieu de seulement pour lui-même ou les dieux et a utilisé l'argent qui allait autrefois aux temples pour les travaux publics et les parcs. Le pouvoir du clergé a fortement diminué à mesure que celui du gouvernement central augmentait, ce qui semblait être l'objectif d'Akhenaton, mais il n'a pas utilisé son pouvoir pour le meilleur intérêt de son peuple. Les Lettres d'Amarna précisent qu'il était plus préoccupé par ses réformes religieuses que par la politique étrangère ou les besoins du peuple égyptien.
Son règne a été suivi par son fils, le dirigeant égyptien le plus reconnaissable de nos jours, Toutankhamon, qui a régné de 1336 à 1327 av. a changé son nom en "Toutankhamon" pour honorer l'ancien dieu Amon. Il restaura les anciens temples, supprima toute référence à la divinité unique de son père et rendit la capitale à Thèbes. Son règne a été écourté par sa mort et, aujourd'hui, il est surtout célèbre pour la grandeur intacte de sa tombe, découverte en 1922 CE, qui est devenue une sensation internationale à l'époque.
Le plus grand dirigeant du Nouvel Empire, cependant, était Ramsès II (également connu sous le nom de Ramsès le Grand, 1279-1213 av. J.-C.) qui a commencé les projets de construction les plus élaborés de tous les dirigeants égyptiens et qui a régné si efficacement qu'il avait les moyens de le faire. . Bien que la célèbre bataille de Kadesh de 1274 (entre Ramsès II d'Égypte et Muwatalli II des Hitties) soit aujourd'hui considérée comme un match nul, Ramsès la considérait comme une grande victoire égyptienne et se célébrait comme un champion du peuple, et enfin comme un dieu. , dans ses nombreux travaux publics.
Son temple d'Abou Simbel (construit pour sa reine Néfertari) représente la bataille de Kadesh et le plus petit temple du site, à l'instar d'Akhenaton, est dédié à la reine préférée de Ramsès, Néfertari. Sous le règne de Ramsès II, le premier traité de paix au monde (le traité de Kadesh) fut signé en 1258 av. J.-C. et l'Égypte connut une prospérité presque sans précédent comme en témoigne le nombre de monuments construits ou restaurés pendant son règne.
Le quatrième fils de Ramsès II, Khaemweset (vers 1281-1225 av. J.-C.), est connu comme le "premier égyptologue" pour ses efforts dans la préservation et l'enregistrement d'anciens monuments, temples et noms de leurs propriétaires d'origine. C'est en grande partie grâce à l'initiative de Khaemweset que le nom de Ramsès II est si proéminent sur tant de sites antiques en Égypte. Khaemweset a laissé une trace de ses propres efforts, du constructeur/propriétaire d'origine du monument ou du temple, ainsi que du nom de son père.
Ramsès II est devenu connu des générations suivantes comme "Le Grand Ancêtre" et a régné si longtemps qu'il a survécu à la plupart de ses enfants et de ses épouses. Avec le temps, tous ses sujets étaient nés en ne connaissant que Ramsès II comme dirigeant et n'avaient aucun souvenir d'un autre. Il a connu une vie exceptionnellement longue de 96 ans, soit plus du double de la durée de vie moyenne d'un ancien Égyptien. À sa mort, il est rapporté que beaucoup craignaient que la fin du monde ne soit venue car ils n'avaient connu aucun autre pharaon et aucun autre type d'Égypte.
L'un de ses successeurs, Ramsès III (1186-1155 av. J.-C.), suivit sa politique mais, à cette époque, la grande richesse de l'Égypte avait attiré l'attention des peuples de la mer qui commencèrent à faire des incursions régulières le long de la côte. Les peuples de la mer, comme les Hyksos, sont d'origine inconnue, mais on pense qu'ils sont originaires de la région méridionale de la mer Égée. Entre 1276 et 1178 av. J.-C., les peuples de la mer constituaient une menace pour la sécurité égyptienne. Ramsès II les avait vaincus dans une bataille navale au début de son règne, tout comme son successeur Merenptah (1213-1203 av. J.-C.). Après la mort de Merenptah, cependant, ils ont intensifié leurs efforts, saccageant Kadesh, qui était alors sous contrôle égyptien, et ravageant la côte. Entre 1180 et 1178 av. J.-C., Ramsès III les combattit, les battant finalement à la bataille de Xois en 1178 av.
Après le règne de Ramsès III, ses successeurs ont tenté de maintenir sa politique mais se sont de plus en plus heurtés à la résistance du peuple égyptien, de ceux des territoires conquis et, surtout, de la classe sacerdotale. Dans les années qui suivirent la restauration de l'ancienne religion d'Amon par Toutankhamon, et en particulier pendant la grande période de prospérité sous Ramsès II, les prêtres d'Amon avaient acquis de vastes étendues de terre et amassé de grandes richesses qui menaçaient désormais le gouvernement central et perturbaient l'unité de Egypte. À l'époque de Ramsès XI (1107-1077 av. J.-C.), à la fin de la 20e dynastie, le gouvernement était devenu si affaibli par le pouvoir et la corruption du clergé que le pays s'est à nouveau fracturé et que l'administration centrale s'est effondrée, initiant la soi-disant troisième Période intermédiaire d'environ 1069-525 av.
Sous le roi Koushite Piye (752-722 av. J.-C.), l'Égypte fut à nouveau unifiée et la culture prospéra, mais à partir de 671 av. J.-C., les Assyriens sous Esarhaddon commencèrent leur invasion de l'Égypte, la conquérant en 666 av. J.-C. sous son successeur Ashurbanipal. N'ayant fait aucun plan à long terme pour le contrôle du pays, les Assyriens l'ont laissé en ruine entre les mains des dirigeants locaux et ont abandonné l'Égypte à son sort. L'Égypte a été reconstruite et fortifiée, cependant, et c'est l'état dans lequel se trouvait le pays lorsque Cambyse II de Perse a frappé la ville de Pelusium en 525 av. Bastet) Cambyse II ordonna à ses hommes de peindre des chats sur leurs boucliers et de chasser les chats, et autres animaux sacrés pour les Égyptiens, devant l'armée vers Péluse. Les forces égyptiennes se sont rendues et le pays est tombé aux mains des Perses. Il restera sous occupation perse jusqu'à la venue d'Alexandre le Grand en 332 av.
Alexandre fut accueilli en libérateur et conquit l'Egypte sans combat. Il a établi la ville d'Alexandrie et est parti à la conquête de la Phénicie et du reste de l'empire perse. Après sa mort en 323 avant JC, son général, Ptolémée, ramena son corps à Alexandrie et fonda la dynastie ptolémaïque (323-30 avant JC). Le dernier des Ptolémées était Cléopâtre VII qui s'est suicidée en 30 avant JC après la défaite de ses forces (et de celles de son époux Marc Antoine) par les Romains sous Octave César à la bataille d'Actium (31 avant JC). L'Égypte est alors devenue une province de Rome (30 avant JC - 476 après JC) puis de l'Empire byzantin (vers 527-646 après JC) jusqu'à ce qu'elle soit conquise par les musulmans arabes sous le calife Umar en 646 CE et tombe sous la domination islamique. La gloire du passé de l'Égypte, cependant, a été redécouverte au cours des 18e et 19e siècles de notre ère et a eu un impact profond sur la compréhension actuelle de l'histoire ancienne et du monde. L'historien Will Durant exprime un sentiment ressenti par beaucoup :
"L'effet ou le souvenir de ce que l'Egypte a accompli à l'aube même de l'histoire a une influence sur chaque nation et à chaque époque. « Il est même possible », comme l'a dit Faure, « que l'Égypte, par la solidarité, l'unité et la variété disciplinée de ses productions artistiques, par l'énorme durée et la puissance soutenue de son effort, offre le spectacle des plus grands civilisation qui est encore apparue sur la terre. Nous ferons bien de l'égaler."
La culture et l'histoire égyptiennes ont depuis longtemps une fascination universelle pour les gens; que ce soit à travers le travail des premiers archéologues du 19ème siècle de notre ère (comme Champollion qui a déchiffré la pierre de Rosette en 1822 après JC) ou la célèbre découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter en 1922 après JC L'ancienne croyance égyptienne en la vie comme un voyage éternel , créé et maintenu par la magie divine, a inspiré les cultures ultérieures et les croyances religieuses ultérieures. Une grande partie de l'iconographie et des croyances de la religion égyptienne a trouvé son chemin dans la nouvelle religion du christianisme et nombre de leurs symboles sont reconnaissables aujourd'hui avec en grande partie la même signification. C'est un témoignage important de la puissance de la civilisation égyptienne que tant d'œuvres de l'imagination, des films aux livres en passant par les peintures et même la croyance religieuse, ont été et continuent d'être inspirées par sa vision élevante et profonde de l'univers et de la place de l'humanité. dedans. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: La culture égyptienne antique a prospéré entre environ 5 500 avant JC avec l'avènement de la technologie (comme en témoigne le travail du verre en faïence) et 30 avant JC avec la mort de Cléopâtre VII, le dernier dirigeant ptolémaïque de l'Égypte. Elle est aujourd'hui célèbre pour les grands monuments qui célébraient les triomphes des dirigeants et honoraient les dieux du pays. Cette culture est souvent comprise à tort comme étant obsédée par la mort, mais si cela avait été le cas, il est peu probable qu'elle aurait produit l'impression significative qu'elle a produite sur d'autres cultures anciennes telles que la Grèce et Rome. La culture égyptienne était, en fait, une affirmation de la vie, comme l'écrit l'érudite Salima Ikram :
"À en juger par le nombre de tombeaux et de momies que les anciens Égyptiens ont laissés derrière eux, on peut pardonner de penser qu'ils étaient obsédés par la mort. Cependant, ce n’est pas le cas. Les Égyptiens étaient obsédés par la vie et sa continuation plutôt que par une fascination morbide pour la mort. Les tombeaux, les temples mortuaires et les momies qu'ils produisaient étaient une célébration de la vie et un moyen de la perpétuer pour l'éternité… Pour les Égyptiens, comme pour d'autres cultures, la mort faisait partie du voyage de la vie, la mort marquant une transition ou une transformation après laquelle vie se poursuivait sous une autre forme, spirituelle plutôt que corporelle. »
Cette passion pour la vie a imprégné chez les anciens Égyptiens un grand amour pour leur terre, car on pensait qu'il ne pouvait y avoir de meilleur endroit sur terre pour profiter de l'existence. Même si les classes inférieures en Égypte, comme ailleurs, subsistaient avec beaucoup moins que les classes aisées, elles semblent néanmoins avoir apprécié la vie de la même manière que les citoyens les plus riches. Ceci est illustré par le concept de gratitude et le rituel connu sous le nom de Les cinq dons d'Hathor dans lequel les pauvres ouvriers étaient encouragés à regarder les doigts de leur main gauche (la main qu'ils atteignaient quotidiennement pour récolter les champs) et à considérer les cinq choses pour lesquelles ils étaient le plus reconnaissants dans leur vie. L'ingratitude était considérée comme un « péché de passerelle » car elle conduisait à tous les autres types de pensées négatives et aux comportements qui en résultaient. Une fois que l'on se sentait ingrat, a-t-on observé, on était alors enclin à se livrer davantage à de mauvais comportements. Le culte d'Hathor était très populaire en Égypte, parmi toutes les classes sociales, et incarne l'importance primordiale de la gratitude dans la culture égyptienne.
La religion faisait partie intégrante de la vie quotidienne de chaque Égyptien. Comme pour le peuple de Mésopotamie, les Égyptiens se considéraient comme des collaborateurs des dieux, mais avec une distinction importante : alors que les peuples mésopotamiens croyaient qu'ils devaient travailler avec leurs dieux pour empêcher la récurrence de l'état originel de chaos, les Égyptiens comprenaient leur les dieux avaient déjà atteint cet objectif et le devoir d'un humain était de célébrer ce fait et d'en rendre grâce. La soi-disant « mythologie égyptienne » était, dans les temps anciens, une structure de croyance aussi valable que n'importe quelle religion acceptée de nos jours.
La religion égyptienne enseignait au peuple qu'au début, il n'y avait rien d'autre que des eaux tourbillonnantes chaotiques d'où s'élevait une petite colline connue sous le nom de Ben-Ben. Au sommet de cette colline se tenait le grand dieu Atoum qui a donné naissance à la création en s'appuyant sur le pouvoir de Heka, le dieu de la magie. On pensait que Heka était antérieure à la création et qu'elle était l'énergie qui permettait aux dieux d'accomplir leurs devoirs. La magie a informé toute la civilisation et Heka était la source de ce pouvoir créatif, durable et éternel. Dans une autre version du mythe, Atoum crée le monde en façonnant d'abord Ptah, le dieu créateur qui effectue ensuite le travail proprement dit. Une autre variante de cette histoire est que Ptah est apparu pour la première fois et a créé Atoum. Une autre version, plus élaborée, de l'histoire de la création voit Atoum s'accoupler avec son ombre pour créer Shu (l'air) et Tefnout (l'humidité) qui donnent ensuite naissance au monde et aux autres dieux.
De cet acte originel d’énergie créatrice est né tout le monde connu et l’univers. Il était entendu que les êtres humains constituaient un aspect important de la création des dieux et que chaque âme humaine était aussi éternelle que celle des divinités qu’ils vénéraient. La mort n'était pas la fin de la vie mais la réintégration de l'âme individuelle au royaume éternel d'où elle était issue. Le concept égyptien de l'âme la considérait comme composée de neuf parties : le Khat était le corps physique ; la double forme du Ka un ; le Ba, un aspect d'oiseau à tête humaine qui pouvait se déplacer entre la terre et le ciel ; Shuyet était le moi de l'ombre ; Akh le moi immortel et transformé, les aspects Sahu et Sechem de l'Akh ; Ab était le cœur, la source du bien et du mal ; Ren était son nom secret.
Le nom d'un individu était considéré comme d'une telle importance que le véritable nom d'un Égyptien restait secret tout au long de sa vie et que chacun était connu sous un surnom. La connaissance du vrai nom d'une personne lui donnait des pouvoirs magiques sur cet individu et c'est l'une des raisons pour lesquelles les dirigeants égyptiens ont pris un autre nom en montant sur le trône ; il ne s'agissait pas seulement de se lier symboliquement à un autre pharaon à succès, mais aussi d'une forme de protection pour assurer sa sécurité et contribuer à garantir un voyage sans problème vers l'éternité une fois sa vie sur terre terminée. Selon l'historienne Margaret Bunson :
« L’éternité était une période d’existence sans fin qu’aucun Égyptien ne devait craindre. Le terme « Aller vers son Ka » (être astral) était utilisé à chaque époque pour exprimer la mort. Le hiéroglyphe désignant un cadavre était traduit par « participer à la vie éternelle ». Le tombeau était le « Manoir de l'Éternité » et le mort était un Akh, un esprit transformé.
La célèbre momie égyptienne (dont le nom vient des mots persans et arabes signifiant « cire » et « bitume », muum et mumia) a été créée pour préserver le corps physique de l'individu (Khat) sans lequel l'âme ne pourrait atteindre l'immortalité. Comme le Khat et le Ka ont été créés en même temps, le Ka serait incapable de se rendre au Champ des Roseaux s'il lui manquait la composante physique sur terre. Les dieux qui avaient façonné l’âme et créé le monde veillaient constamment sur le peuple égyptien et entendaient et répondaient à ses requêtes. Un exemple célèbre de ceci est celui où Ramsès II fut encerclé par ses ennemis lors de la bataille de Kadesh (1274 avant JC) et, faisant appel au dieu Amon pour l'aide, trouva la force de se frayer un chemin vers la sécurité. Il existe cependant de nombreux exemples beaucoup moins dramatiques, enregistrés sur les murs des temples, les stèles et les fragments de papyrus.
Le papyrus (d'où vient le mot anglais « paper ») n'était qu'une des avancées technologiques de la culture égyptienne antique. Les Égyptiens étaient également responsables du développement de la rampe, du levier et de la géométrie à des fins de construction, des progrès en mathématiques et en astronomie (également utilisés dans la construction comme en témoignent les positions et les emplacements des pyramides et de certains temples, comme Abou Simbel), des améliorations dans l'irrigation et l'agriculture (peut-être apprises des Mésopotamiens), la construction navale et l'aérodynamique (peut-être introduites par les Phéniciens), la roue (apportée en Égypte par les Hyksos) et la médecine.
Le papyrus gynécologique de Kahun (vers 1800 avant JC) est un des premiers traités sur les problèmes de santé des femmes et de contraception et le papyrus d'Edwin Smith (vers 1600 avant JC) est l'ouvrage le plus ancien sur les techniques chirurgicales. La dentisterie était largement pratiquée et on attribue aux Égyptiens l'invention du dentifrice, des brosses à dents, du cure-dent et même des bonbons à la menthe. Ils ont créé le sport du bowling et amélioré le brassage de la bière pratiqué pour la première fois en Mésopotamie. Les Égyptiens n’ont cependant pas inventé la bière. Cette fiction populaire selon laquelle les Égyptiens seraient les premiers brasseurs vient du fait que la bière égyptienne ressemblait plus à la bière moderne qu'à celle des Mésopotamiens.
Le travail du verre, la métallurgie du bronze et de l'or et le mobilier étaient d'autres avancées de la culture égyptienne et leur art et leur architecture sont célèbres dans le monde entier pour leur précision et leur beauté. L'hygiène personnelle et l'apparence étaient très appréciées et les Égyptiens se lavaient régulièrement, se parfumaient avec du parfum et de l'encens et créaient des produits cosmétiques utilisés aussi bien par les hommes que par les femmes. La pratique du rasage a été inventée par les Égyptiens, tout comme la perruque et la brosse à cheveux. Vers 1600 avant JC, l’horloge à eau était utilisée en Égypte, tout comme le calendrier. Certains ont même suggéré qu'ils comprenaient le principe de l'électricité, comme en témoigne la célèbre gravure de la Lumière de Dendérah sur le mur du temple Hathor à Dendérah. Les images sur le mur ont été interprétées par certains comme représentant une ampoule et des personnages reliant ladite ampoule à une source d'énergie. Cette interprétation a cependant été largement discréditée par la communauté universitaire.
Dans la vie quotidienne, les Égyptiens semblent peu différents des autres cultures anciennes. Comme les habitants de la Mésopotamie, de l’Inde, de la Chine et de la Grèce, ils vivaient pour la plupart dans des maisons modestes, élevaient des familles et profitaient de leur temps libre. Cependant, une différence significative entre la culture égyptienne et celle des autres pays était que les Égyptiens croyaient que la terre était intimement liée à leur salut personnel et qu'ils avaient une profonde peur de mourir au-delà des frontières de l'Égypte. Ceux qui servaient leur pays dans l’armée, ou ceux qui voyageaient pour gagner leur vie, prenaient des dispositions pour que leurs corps soient rapatriés en Égypte s’ils étaient tués. On pensait que la terre fertile et sombre du delta du Nil était la seule zone sanctifiée par les dieux pour la renaissance de l'âme dans l'au-delà et que le fait d'être enterré ailleurs était une condamnation à la non-existence.
En raison de cette dévotion à la patrie, les Égyptiens n’étaient pas de grands voyageurs du monde et il n’y a pas d’« Hérodote égyptien » qui puisse laisser derrière lui des impressions du monde antique au-delà des frontières égyptiennes. Même dans les négociations et les traités avec d’autres pays, la préférence égyptienne pour rester en Égypte était dominante. L'historien Nardo écrit : "Bien qu'Aménophis III ait joyeusement ajouté deux princesses du Mitanni à son harem, il refusa d'envoyer une princesse égyptienne au souverain du Mitanni, car, "depuis des temps immémoriaux, une fille royale d'Egypte n'a été donnée à personne". ' Ce n'est pas seulement l'expression du sentiment de supériorité des Égyptiens sur les étrangers mais en même temps et l'indication de la sollicitude accordée aux parentes féminines, qui ne sauraient être incommodées de vivre parmi des « barbares ». »
De plus, à l’intérieur des campagnes, les gens ne voyageaient pas très loin de leur lieu de naissance et la plupart, sauf en temps de guerre, de famine ou d’autres bouleversements, vivaient et mouraient au même endroit. Comme on croyait que l'au-delà serait une continuation du présent (mais mieux dans la mesure où il n'y aurait ni maladie, ni déception ni, bien sûr, mort), le lieu dans lequel on passerait sa vie constituerait son paysage éternel. La cour, l'arbre et le ruisseau que l'on voyait chaque jour devant sa fenêtre seraient exactement reproduits dans l'au-delà. Cela étant, les Égyptiens étaient encouragés à rejoice et à apprécier profondément leur environnement immédiat et à vivre avec gratitude selon leurs moyens. Le concept de ma'at (harmonie et équilibre) régissait la culture égyptienne et, qu'ils soient de classe supérieure ou inférieure, les Égyptiens s'efforçaient de vivre en paix avec leur environnement et entre eux.
Parmi les classes inférieures, les maisons étaient construites en briques de terre cuite cuites au soleil. Plus un citoyen est riche, plus la maison est épaisse ; les personnes les plus riches avaient des maisons construites avec une double couche, ou plus, de brique, tandis que les maisons des personnes plus pauvres n'avaient qu'une seule brique de largeur. Le bois était rare et n'était utilisé que pour les portes et les rebords de fenêtres (encore une fois, dans les maisons les plus riches) et le toit était considéré comme une autre pièce de la maison où les rassemblements avaient lieu régulièrement car l'intérieur des maisons était souvent faiblement éclairé.
Les vêtements étaient en lin simple, non teint, les hommes portant une jupe (ou un pagne) jusqu'aux genoux et les femmes portant des robes ou des robes légères jusqu'aux chevilles qui cachaient ou exposaient leurs seins selon la mode du moment. Il semblerait cependant que le niveau de déshabillage d'une femme soit révélateur de son statut social tout au long de l'histoire égyptienne. Les danseuses, les musiciennes, les servantes et les esclaves sont régulièrement montrées nues ou presque nues tandis qu'une dame de la maison est entièrement habillée, même à l'époque où les seins exposés étaient une déclaration de mode.
Malgré cela, les femmes étaient libres de s’habiller comme bon leur semblait et il n’y a jamais eu d’interdiction, à aucun moment de l’histoire égyptienne, de la mode féminine. Les seins exposés d'une femme étaient considérés comme un choix de mode naturel et normal et n'étaient en aucun cas considérés comme impudiques ou provocateurs. Il était entendu que la déesse Isis avait donné des droits égaux aux hommes et aux femmes et que, par conséquent, les hommes n'avaient pas le droit de dicter la façon dont une femme, même sa propre épouse, devait se vêtir. Les enfants portaient peu ou pas de vêtements jusqu'à la puberté.
Les mariages n'étaient pas arrangés entre les classes inférieures et il ne semble pas y avoir eu de cérémonie de mariage formelle. Un homme apporterait des cadeaux à la maison de sa future épouse et, si les cadeaux étaient acceptés, elle s'installerait avec lui. L'âge moyen d'une mariée était de 13 ans et celui d'un marié de 18 à 21 ans. Un contrat serait rédigé partageant les biens d'un homme entre sa femme et ses enfants et cette répartition ne pourrait être annulée que pour cause d'adultère (défini comme un rapport sexuel avec une femme mariée et non avec un homme marié). Les femmes égyptiennes pouvaient posséder des terres, des maisons, diriger des entreprises et présider des temples et pouvaient même être des pharaons (comme dans l'exemple de la reine Hatshepsout, 1479-1458 avant JC) ou, plus tôt, de la reine Sobeknofru, vers 1767-1759 avant JC).
L’historien Thompson écrit : « L’Égypte traitait ses femmes mieux que n’importe quelle autre grande civilisation du monde antique. Les Égyptiens croyaient que la joie et le bonheur étaient des objectifs légitimes de la vie et considéraient la maison et la famille comme la principale source de plaisir. En raison de cette croyance, les femmes jouissaient d'un prestige plus élevé en Égypte que dans toute autre culture du monde antique.
Alors que l’homme était considéré comme le chef de la maison, la femme était la chef du foyer. Elle a élevé les enfants des deux sexes jusqu'à ce que, à l'âge de quatre ou cinq ans, les garçons soient placés sous la garde et la tutelle de leur père pour apprendre leur métier (ou fréquenter l'école si la profession du père était celle de scribe, de prêtre ou de médecin). ). Les filles restaient sous la garde de leur mère, apprenant à tenir un ménage jusqu'à leur mariage. Les femmes pouvaient également être scribes, prêtres ou médecins, mais cela était inhabituel car l'éducation était coûteuse et la tradition voulait que le fils doive suivre la profession de son père, pas la fille. Le mariage était l'état courant des Égyptiens après la puberté et le fait d'être célibataire, homme ou femme, était considéré comme anormal.
Les classes supérieures, ou noblesse, vivaient dans des demeures plus ornées et dotées d'une plus grande richesse matérielle, mais semblent avoir suivi les mêmes préceptes que les personnes inférieures dans la hiérarchie sociale. Tous les Égyptiens aimaient jouer à des jeux, comme le jeu de Senet (un jeu de société populaire depuis la période pré-dynastique, vers 5500-3150 avant JC), mais seuls ceux qui avaient les moyens pouvaient se permettre un plateau de jeu de qualité. Cela ne semble cependant pas empêcher les plus pauvres de jouer à ce jeu ; ils jouaient simplement avec un décor moins orné.
Regarder des matchs et des courses de lutte et participer à d'autres événements sportifs, tels que la chasse, le tir à l'arc et la voile, étaient populaires parmi la noblesse et la classe supérieure, mais, encore une fois, tous les Égyptiens en profitaient dans la mesure où ils pouvaient se le permettre (à l'exception des grands). chasse aux animaux qui était la seule provenance du souverain et de ceux qu'il désignait). Se régaler lors de banquets était une activité de loisir réservée aux classes supérieures, même si les classes inférieures pouvaient se divertir de la même manière (bien que moins somptueuse) lors des nombreuses fêtes religieuses organisées tout au long de l'année.
La natation et l'aviron étaient extrêmement populaires dans toutes les classes. L'écrivain romain Sénèque a observé des Égyptiens ordinaires en train de jouer sur le Nil et a décrit la scène : « Les gens embarquent sur de petits bateaux, deux par bateau, et l'un rame tandis que l'autre écope l'eau. Puis ils sont violemment ballottés dans les rapides déchaînés. Enfin, ils atteignent les canaux les plus étroits… et, entraînés par toute la force du fleuve, ils contrôlent à la main le bateau qui se précipite et plongent la tête en bas à la grande terreur des spectateurs. On croirait tristement qu'ils sont maintenant noyés et submergés par une telle masse d'eau quand, loin de l'endroit où ils sont tombés, ils jaillissent comme d'une catapulte, naviguant toujours, et que la vague descendante ne les submerge pas, mais emporte vers les eaux calmes."
La natation était une partie importante de la culture égyptienne et les enfants apprenaient à nager dès leur plus jeune âge. sports nautiques jouaient un rôle important dans le divertissement égyptien, car le Nil constituait un aspect majeur de leur vie quotidienne. Le sport des joutes nautiques, dans lequel deux petits bateaux, chacun avec un ou deux rameurs et un jouteur, s'affrontaient, semble avoir été très populaire. Le ou les rameurs dans le bateau cherchaient à manœuvrer stratégiquement tandis que le combattant tentait de faire tomber son adversaire de l'engin. Ils appréciaient également les jeux qui n'avaient rien à voir avec la rivière, mais qui étaient similaires aux jeux modernes de catch et de handball.
Les jardins et les décorations simples de la maison étaient très prisés par les Égyptiens. Un jardin potager était important pour la subsistance, mais procurait également du plaisir à s'occuper de sa propre récolte. Les ouvriers des champs ne travaillaient jamais leur propre récolte et leur jardin individuel était donc un lieu de fierté de produire quelque chose qui leur était propre, cultivé à partir de leur propre sol. Ce sol, encore une fois, serait leur demeure éternelle après avoir quitté leur corps et était donc grandement apprécié. Une inscription funéraire datant de 1400 avant JC dit : « Puissé-je marcher chaque jour au bord de l'eau, que mon âme repose sur les branches des arbres que j'ai plantés, que je me rafraîchisse à l'ombre de mon sycomore » en faisant référence à l'éternité. aspect de l'environnement quotidien de chaque Égyptien. Après la mort, on jouirait encore de son sycomore particulier, de sa propre promenade quotidienne au bord de l'eau, dans une terre de paix éternelle accordée aux Egyptiens par les dieux qu'ils vénéraient avec gratitude. [Encyclopédie de l'histoire ancienne].
AVIS: Alors que beaucoup pensent que les momies sont strictement liées à l'histoire de l'Égypte, il est important de se rappeler que l'histoire des momies peut également être vue dans d'autres régions d'Afrique, de Chine, d'Amérique du Sud et du Nord et d'Europe. Chaque culture ne traite pas les momies et le processus de momification exactement de la même manière, mais elles sont toutes utilisées en relation avec la mort et pour tenter de mieux préserver le corps après le décès de l'individu.
Selon le pays ou l'intention de ceux qui les momifient, les momies peuvent être classées en deux catégories : anthropiques (corps intentionnellement momifiés) ou spontanés (créés involontairement par des forces naturelles). La plupart des momifications dans des pays comme la Chine, l'Europe et les Amériques étaient connues pour l'enterrement spontané de momies, c'est pourquoi elles ne sont pas aussi reconnues pour leur histoire de momification. Aujourd’hui, les momies de l’Égypte ancienne sont connues pour leur impact religieux et technologique et sont considérées comme la partie la plus cruciale de l’histoire des momies.
Les momies en Égypte sont surtout reconnues pour représenter l'utilisation distincte de la religion et le but de préparer le corps à l'au-delà. Beaucoup ont l’idée préconçue que les Égyptiens étaient obsédés par l’idée de la mort, alors qu’en réalité ; ils étaient fantasmés par l'idée de la vie et de la vie après la mort. L’utilisation de momies en Égypte a montré que toutes les momies n’étaient pas accidentelles, qu’elles avaient été créées dans un but précis.
Les Égyptiens étaient de loin les plus avancés dans leurs processus de momification, créant des embaumements, des prélèvements d'organes, la création de tombes et même l'enterrement des corps des morts avec des objets qu'ils pourraient emporter avec eux dans l'au-delà. Dans les trois royaumes les plus distinctement reconnus au cours de cette période, de nombreux progrès ont été réalisés, non seulement en termes de processus de momification, mais également sur le plan religieux.
Aujourd’hui, l’Égypte est considérée comme un brillant exemple de la manière dont la mort est influencée par de nombreux autres facteurs plutôt que par le simple décès. La religion en est venue à jouer un rôle très important, montrant comment les Égyptiens utilisaient les momies de plusieurs manières. L’Ancien Empire fut le premier des royaumes de l’Égypte ancienne. À l’époque de l’Ancien Empire, toutes les tentatives visant à sauver le corps d’une momie étaient évidentes, mais n’aboutissaient à aucun résultat concluant. L’une des découvertes les plus importantes de cette époque est que les Égyptiens ont pris conscience de l’importance du processus de dessiccation, qui contribuait à retarder la décomposition du corps enterré. Les momies étaient entièrement enveloppées dans des bandages de type gaze, avec des empreintes faites autour du visage. C'est pendant cette période que les momies ont commencé à être enveloppées avec leurs bras à côté de leur corps, les mains placées contre l'extérieur des cuisses.
En ce qui concerne les lieux de sépulture proprement dits, la construction en pierre est devenue beaucoup plus répandue et l'architecture funéraire s'est considérablement développée au cours de l'Ancien Empire. Ces cimetières ne contenaient pas de décorations, mais étaient enterrés dans des pyramides pour faciliter le transport du sarcophage jusqu'aux tombeaux. Les lieux de sépulture des gens ordinaires n'atteignaient pas les mêmes normes que ceux des niveaux supérieurs, étant donné que la plupart des roturiers étaient enterrés dans des fosses creusées dans le sol et recouvertes de briques.
L’Empire du Milieu est le deuxième royaume qui a évolué après l’Ancien Empire. Comme l'Ancien Empire, l'Empire du Milieu montre que les Égyptiens n'avaient pas encore trouvé de moyen très efficace d'utiliser le processus de momification mais ont montré quelques améliorations qui ont contribué à améliorer la préservation du corps. Les Égyptiens ont créé un mélange chimique qui leur faisait simplement perdre la graisse de leur corps plutôt que d’autres parties vitales du corps. Une autre similitude entre les royaumes était le manque de mobilier dans les lieux de sépulture. Les lieux de sépulture, cependant, ont commencé à contenir des peintures principalement liées au pèlerinage à Abydos, où se trouvait, semble-t-il, le tombeau d'Osiris.
Bien entendu, toutes les personnes enterrées n’étaient pas traitées de la même manière ; ceux qui étaient d'un statut social inférieur ne recevaient pas le même traitement d'embaumement que ceux d'un statut social plus élevé. C'est à cette époque qu'on commence à utiliser régulièrement des masques funéraires et des vases canopes, qui contenaient des organes humains, protégés par les têtes des quatre fils d'Horus. Le Nouvel Empire était le dernier des royaumes de l’Égypte ancienne, considéré comme le plus développé en matière de momies. Le Nouvel Empire était considéré comme le plus élaboré des royaumes ; on dit que de nombreuses tombes contiennent de belles œuvres d'art, des vases et d'autres reliques bien décorées. Les cercueils de ce royaume variaient en termes de décoration, certains au début de cette période n'ayant que de simples décorations et rayures, ceux des époques ultérieures contenant des scènes, des textes et des motifs décoratifs complexes.
Au cours des années 1920, fut découverte « La Vallée des Rois », une vallée remplie de momies de pharas spécifiquement originaires du Nouvel Empire. La momie la plus importante découverte à cette époque était Toutankhamon. C'est lui qui a donné aux archéologues le meilleur aperçu de la manière dont les momies royales étaient traitées au Nouvel Empire. Les momies royales contenaient souvent des objets de nature funéraire tels que de la nourriture, des sculptures d'animaux et des maquettes de bateaux destinées à représenter le voyage dans l'au-delà. Le Nouvel Empire met également l’accent sur l’importance d’Osiris, dieu des morts.
Aujourd’hui, les momies peuvent nous donner un aperçu extrêmement important du fonctionnement des cultures et des sociétés passées. La qualité de l'enterrement des momies, l'endroit où elles ont été enterrées et la nature de leur enterrement ont grandement aidé les archéologues à découvrir certains des grands mystères du passé. Cela peut également donner une idée de la religion d’une culture, de la manière dont cette religion a affecté la mort et du processus qui y est associé. Aujourd’hui, nous considérons l’Égypte ancienne comme l’un des endroits les plus importants pour étudier les momies en raison de leur riche histoire dans les cultures et civilisations de l’époque. [CollegeHistory.Com].
: Nous expédions toujours des livres au niveau national (aux États-Unis) via USPS ASSURÉ courrier des médias (« tarif livre »). Cependant, ce livre est assez volumineux et lourd, trop volumineux pour tenir dans un courrier à tarif forfaitaire. Il existe également un programme de réduction qui peut réduire les frais de port de 50 à 75 % si vous achetez environ une demi-douzaine de livres ou plus (5 kilos et plus). Nos frais de port sont aussi raisonnables que les tarifs USPS le permettent.
ACHATS SUPPLÉMENTAIRES recevez un TRÈS GRAND Votre achat sera généralement expédié dans les 48 heures suivant le paiement. Nous emballons aussi bien que n'importe qui dans le secteur, avec de nombreux rembourrages et conteneurs de protection.
Veuillez noter que pour les acheteurs internationaux, nous ferons tout notre possible pour minimiser votre responsabilité en matière de TVA et/ou de droits. Mais nous ne pouvons assumer aucune responsabilité ou obligation pour les taxes ou droits pouvant être prélevés sur votre achat par le pays de votre résidence. Si vous n'aimez pas les régimes fiscaux et douaniers imposés par votre gouvernement, veuillez vous plaindre auprès d'eux. Nous ne sommes pas en mesure d'influencer ou de modérer les régimes fiscaux/droits de votre pays. Le suivi international est fourni gratuitement par l'USPS pour certains pays, d'autres pays entraînent des frais supplémentaires. Nous proposons le courrier prioritaire du service postal américain, le courrier recommandé et le courrier express pour les envois internationaux et nationaux, ainsi que United Parcel Service (UPS) et Federal Express (Fed-Ex). Merci de demander un devis. Nous accepterons le mode de paiement avec lequel vous êtes le plus à l'aise.
Si à la réception de l'article vous êtes déçu pour quelque raison que ce soit, je propose une politique de retour de 30 jours sans poser de questions. Veuillez noter que bien qu'ils le fassent généralement, eBay ne rembourse pas toujours les frais de traitement des paiements sur les retours au-delà d'une fenêtre d'achat de 30 jours. Nous n'avons évidemment aucune possibilité d'influencer, de modifier ou de renoncer aux politiques d'eBay.
À PROPOS: Avant notre retraite, nous voyageions plusieurs fois par an en Europe de l'Est et en Asie centrale à la recherche de pierres précieuses et de bijoux anciens provenant des centres de production et de taille de pierres précieuses les plus prolifiques du monde. La plupart des articles que nous proposons proviennent d'acquisitions que nous avons réalisées au cours de ces années en Europe de l'Est, en Inde et au Levant (Méditerranée orientale/Proche-Orient) auprès de diverses institutions et revendeurs. Une grande partie de ce que nous générons sur Etsy, Amazon et Ebay est destinée à soutenir des institutions dignes d'Europe et d'Asie liées à l'anthropologie et à l'archéologie. Bien que nous ayons une collection de pièces de monnaie anciennes se comptant par dizaines de milliers, nos principaux intérêts sont les bijoux anciens et les pierres précieuses, reflet de notre formation universitaire.
Bien qu’elles soient peut-être difficiles à trouver aux États-Unis, en Europe de l’Est et en Asie centrale, les pierres précieuses antiques sont généralement démontées des anciennes montures cassées – l’or est réutilisé – les pierres précieuses sont recoupées et réinitialisées. Avant que ces magnifiques pierres précieuses antiques ne soient retaillées, nous essayons d’acquérir les meilleures d’entre elles dans leur état d’origine, antique et fini à la main – la plupart d’entre elles ont été fabriquées il y a un siècle ou plus. Nous pensons que le travail créé par ces maîtres artisans disparus depuis longtemps mérite d'être protégé et préservé plutôt que de détruire ce patrimoine de pierres précieuses antiques en découpant l'œuvre originale de l'existence. En préservant leur travail, d’une certaine manière, nous préservons leur vie et l’héritage qu’ils ont laissé aux temps modernes. Il vaut bien mieux apprécier leur métier que de le détruire avec une coupe moderne.
Tout le monde n’est pas d’accord : au moins 95 % des pierres précieuses antiques qui arrivent sur ces marchés sont retaillées et l’héritage du passé est perdu. Mais si vous êtes d'accord avec nous que le passé mérite d'être protégé et que les vies passées et les produits de ces vies comptent toujours aujourd'hui, envisagez d'acheter une pierre précieuse naturelle antique, taillée à la main plutôt qu'une pierre précieuse taillée à la machine produite en série (souvent synthétique). ou « produites en laboratoire ») qui dominent le marché aujourd’hui. Nous pouvons sertir la plupart des pierres précieuses antiques que vous achetez chez nous dans votre choix de styles et de métaux allant des bagues aux pendentifs en passant par les boucles d'oreilles et les bracelets ; en argent sterling, en or massif 14 carats et en or 14 carats. Nous serions heureux de vous fournir un certificat/garantie d’authenticité pour tout article que vous achetez chez nous. Je répondrai toujours à chaque demande, que ce soit par e-mail ou par message eBay, alors n'hésitez pas à écrire.
