1577AD 1st Britannique Américain Colonie Canadien Arctique Île Gold Rush Inuit





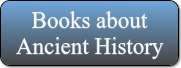
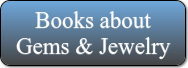
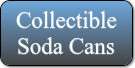









Rivage inconnu : L'histoire perdue de la colonie arctique anglaise par Robert Ruby.
NOTE: Nous avons 100 000 livres dans notre bibliothèque, soit plus de 10 400 titres différents. Il y a de fortes chances que nous ayons d'autres exemplaires de ce même titre dans des conditions variables, certaines moins chères, d'autres en meilleur état. Nous pouvons également avoir différentes éditions (certaines en livre de poche, d'autres à couverture rigide, souvent des éditions internationales). Si vous ne voyez pas ce que vous voulez, veuillez nous contacter et demander. Nous sommes heureux de vous envoyer un résumé des différentes conditions et prix que nous pouvons avoir pour le même titre.
DESCRIPTION: Relié avec jaquette : 320 pages. Éditeur : Henry Holt (2001). Récit historique magistral, « Unknown Shore » raconte l'histoire vraie de la façon dont la première colonie européenne en Amérique du Nord a été perdue dans les mémoires, puis retrouvée trois cents ans plus tard. La première tentative de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre n'a pas eu lieu à Roanoke ou à Jamestown, mais sur une île de poche en grande partie gelée dans l'Arctique canadien. La reine Elizabeth Ier a appelé l'endroit « Meta Incognita », ou « Rivage inconnu ». Soutenu par Elizabeth et ses principaux conseillers, l'ancien pirate Martin Frobisher a traversé trois fois l'Atlantique Nord, menant ainsi ce qui reste à ce jour la plus grande expédition arctique de l'histoire. Dans ce double récit brillamment conçu, Robert Ruby entremêle la saga de Frobisher avec celle de l'Américain du XIXe siècle Charles Francis Hall, dont les explorations de ce même paysage lui ont permis d'entendre l'histoire orale des Inuits, transmise de génération en génération. Ce sont ces histoires qui ont révélé le mystère de la colonie perdue de Frobisher.
 CONDITION: COMME NEUF. Couverture rigide non lue (bien que "usée en magasin") avec jaquette. Henry Holt (2001) 320 pages. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. De l'extérieur, la jaquette présente de légères traces d'usure sur les bords et les coins, de même que les couvertures en quart de tissu, sauf que la couverture présente également un "owie". Plus précisément, les traces d'usure de la jaquette se présentent sous la forme de légers froissements au niveau de la tête et du talon de la colonne vertébrale, ainsi que des quatre coins ouverts de la jaquette, ou « pointes », comme on les appelle souvent. Les "pointes" sont bien entendu formées à l'endroit où la jaquette se plie sous les couvertures pour former les rabats de la jaquette, c'est-à-dire les "coins ouverts" de la jaquette (haut et bas, avant et arrière). Et par « évanouissement », nous entendons précisément cela, littéralement. Cela nécessite que vous teniez le livre devant une source de lumière et que vous l'examiniez de très près pour discerner le léger froissement. Sous la jaquette, l'usure des couvertures en quart de tissu est principalement mise en évidence par un froissement très léger de la tête et du talon de la colonne vertébrale. C'est un peu plus facile à discerner qu'à la jaquette. Les couvertures ont tendance à être moins indulgentes que la jaquette sus-jacente en ce qui concerne les éléments de manipulation/étagères de routine qui sont les causes contributives de « l'usure des étagères ». Les bords et les coins des couvertures sont souvent victimes d'un réaménagement négligent, paresseux ou maladroit, se heurtant souvent aux bords des étagères lorsqu'ils sont rangés/remis en rayon. Lorsque vous remettez des livres en rayon, ou surtout lorsque vous effectuez un déménagement de re-merchandising en gros, il est très facile de tapoter les bords et/ou les coins du livre contre le bord de l'étagère (j'y suis allé, je l'ai fait), surtout si vous êtes remettre un certain nombre de livres sur les étagères ou les déplacer. Bien que la jaquette ne présente aucun effet néfaste d'une telle bosse légère (étant simplement du papier), les couvertures situées sous la jaquette ont tendance à ne pas "revenir en arrière", même sous un léger coup, et de tels coups ou chocs contre un bord inflexible d'une étagère " laisser une impression durable". Bien sûr, rien de tout cela n’est discerné à moins que vous ne retiriez la jaquette du livre. Et pour finir, si vous retirez la jaquette du livre, vous remarquerez une très petite bosse (environ 3/16 de pouce) sur la couverture avant à environ un tiers du bord ouvert. Encore une fois, c'est purement superficiel et cosmétique, mais nous ressentons le devoir de signaler même le plus petit défaut, même jusqu'à l'absurdité. Malgré les défauts esthétiques, l'état général du livre est tout à fait cohérent avec ce qui pourrait autrement passer pour du « nouveau » stock provenant d'un environnement de librairie traditionnel (comme Barnes & Noble, B. Dalton ou Borders/Waldenbooks par exemple), dans lequel autrement les « nouveaux » livres pourraient souvent présenter des imperfections cosmétiques superficielles et/ ou montrer une petite usure des étagères simplement en raison d'une manipulation de routine et de l'épreuve continue d'être constamment mis sur les étagères, remis sur les étagères et mélangés. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE LOURDEMENT REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #1362g.
CONDITION: COMME NEUF. Couverture rigide non lue (bien que "usée en magasin") avec jaquette. Henry Holt (2001) 320 pages. Les pages sont vierges ; propre, net, non marqué, non mutilé, étroitement relié, sans ambiguïté non lu. De l'extérieur, la jaquette présente de légères traces d'usure sur les bords et les coins, de même que les couvertures en quart de tissu, sauf que la couverture présente également un "owie". Plus précisément, les traces d'usure de la jaquette se présentent sous la forme de légers froissements au niveau de la tête et du talon de la colonne vertébrale, ainsi que des quatre coins ouverts de la jaquette, ou « pointes », comme on les appelle souvent. Les "pointes" sont bien entendu formées à l'endroit où la jaquette se plie sous les couvertures pour former les rabats de la jaquette, c'est-à-dire les "coins ouverts" de la jaquette (haut et bas, avant et arrière). Et par « évanouissement », nous entendons précisément cela, littéralement. Cela nécessite que vous teniez le livre devant une source de lumière et que vous l'examiniez de très près pour discerner le léger froissement. Sous la jaquette, l'usure des couvertures en quart de tissu est principalement mise en évidence par un froissement très léger de la tête et du talon de la colonne vertébrale. C'est un peu plus facile à discerner qu'à la jaquette. Les couvertures ont tendance à être moins indulgentes que la jaquette sus-jacente en ce qui concerne les éléments de manipulation/étagères de routine qui sont les causes contributives de « l'usure des étagères ». Les bords et les coins des couvertures sont souvent victimes d'un réaménagement négligent, paresseux ou maladroit, se heurtant souvent aux bords des étagères lorsqu'ils sont rangés/remis en rayon. Lorsque vous remettez des livres en rayon, ou surtout lorsque vous effectuez un déménagement de re-merchandising en gros, il est très facile de tapoter les bords et/ou les coins du livre contre le bord de l'étagère (j'y suis allé, je l'ai fait), surtout si vous êtes remettre un certain nombre de livres sur les étagères ou les déplacer. Bien que la jaquette ne présente aucun effet néfaste d'une telle bosse légère (étant simplement du papier), les couvertures situées sous la jaquette ont tendance à ne pas "revenir en arrière", même sous un léger coup, et de tels coups ou chocs contre un bord inflexible d'une étagère " laisser une impression durable". Bien sûr, rien de tout cela n’est discerné à moins que vous ne retiriez la jaquette du livre. Et pour finir, si vous retirez la jaquette du livre, vous remarquerez une très petite bosse (environ 3/16 de pouce) sur la couverture avant à environ un tiers du bord ouvert. Encore une fois, c'est purement superficiel et cosmétique, mais nous ressentons le devoir de signaler même le plus petit défaut, même jusqu'à l'absurdité. Malgré les défauts esthétiques, l'état général du livre est tout à fait cohérent avec ce qui pourrait autrement passer pour du « nouveau » stock provenant d'un environnement de librairie traditionnel (comme Barnes & Noble, B. Dalton ou Borders/Waldenbooks par exemple), dans lequel autrement les « nouveaux » livres pourraient souvent présenter des imperfections cosmétiques superficielles et/ ou montrer une petite usure des étagères simplement en raison d'une manipulation de routine et de l'épreuve continue d'être constamment mis sur les étagères, remis sur les étagères et mélangés. Satisfaction garantie sans condition. En inventaire, prêt à livrer. Aucune déception, aucune excuse. EMBALLAGE LOURDEMENT REMBOURRÉ ET SANS DOMMAGE ! Vente en ligne de livres d'histoire ancienne rares et épuisés depuis 1997. Nous acceptons les retours pour quelque raison que ce soit dans les 30 jours ! #1362g.
VEUILLEZ VOIR LES IMAGES CI-DESSOUS POUR LA DESCRIPTION DE LA VESTE ET POUR LES PAGES DE PHOTOS DE L’INTÉRIEUR DU LIVRE.
VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS DES ÉDITEURS, DES PROFESSIONNELS ET DES LECTEURS CI-DESSOUS.
AVIS: Une île gelée de poche dans l'Arctique canadien détient les secrets des premières tentatives de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre. Sur cette Meta Incognita, ou rivage inconnu, comme l'appelait la reine Elizabeth Ier, l'Angleterre a fait ses premiers efforts majeurs d'exploration et de colonisation de l'Ouest. Dans Unknown Shore, l'auteur Robert Ruby découvre l'histoire de Meta Incognita dans une histoire regorgeant de personnages riches et de rêves encore plus fantastiques. Unknown Shore est l'histoire des voyages de deux hommes et de ce que ces hommes ont partagé à trois siècles d'intervalle. En fin de compte, c'est l'histoire d'hommes motivés par la cupidité et l'ambition, du dur travail d'exploration, des Inuits et de leurs terres, et de grands paris qui ont mal tourné.
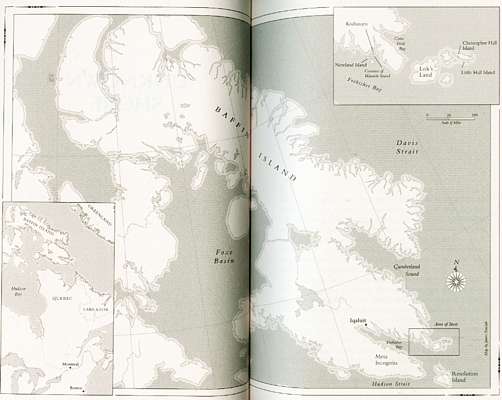 AVIS: L'histoire vraie de la façon dont la première colonie anglaise du Nouveau Monde a été perdue dans l'histoire, puis retrouvée trois cents ans plus tard. La première tentative de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre n'a pas eu lieu à Roanoke ou à Jamestown, mais sur une petite île en grande partie gelée de l'Arctique canadien. La reine Elizabeth Ier a appelé cet endroit Meta Incognita – le rivage inconnu. Soutenu par Elizabeth I et ses principaux conseillers, dont le maître-espion légiste Sir Francis Walsingham et le sombre Dr John Dee, l'ancien pirate Sir Martin Frobisher a traversé trois fois l'Atlantique Nord, menant ainsi ce qui est encore la plus grande expédition dans l'Arctique. dans l'histoire.
AVIS: L'histoire vraie de la façon dont la première colonie anglaise du Nouveau Monde a été perdue dans l'histoire, puis retrouvée trois cents ans plus tard. La première tentative de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre n'a pas eu lieu à Roanoke ou à Jamestown, mais sur une petite île en grande partie gelée de l'Arctique canadien. La reine Elizabeth Ier a appelé cet endroit Meta Incognita – le rivage inconnu. Soutenu par Elizabeth I et ses principaux conseillers, dont le maître-espion légiste Sir Francis Walsingham et le sombre Dr John Dee, l'ancien pirate Sir Martin Frobisher a traversé trois fois l'Atlantique Nord, menant ainsi ce qui est encore la plus grande expédition dans l'Arctique. dans l'histoire.
Dans cet endroit inhospitalier, Frobisher croyait avoir découvert de grandes quantités d'or, le légendaire passage du Nord-Ouest menant aux richesses de Cathay et un endroit propice à une colonie permanente. Mais le rêve de Frobisher s'est transformé en cauchemar et sa colonie a été perdue dans l'histoire pendant près de trois siècles. Dans ce double récit brillamment conçu, Robert Ruby entremêle la saga de Frobisher avec celle de l'Américain du XIXe siècle Charles Francis Hall, dont les explorations de ce même paysage lui ont permis d'entendre l'histoire orale des Inuits, transmise de génération en génération. Ce sont ces histoires qui ont révélé le mystère de la colonie perdue de Frobisher.
« Unknown Shore » est l'histoire des voyages de deux hommes et de ce que ces hommes ont partagé à trois siècles d'intervalle. En fin de compte, c'est l'histoire d'hommes motivés par la cupidité et l'ambition, du dur travail d'exploration, des Inuits et de leurs terres, et de grands paris qui ont mal tourné.
AVIS: Robert Ruby, auteur de Jericho, a travaillé comme chef du bureau du Baltimore Sun à Paris et au Moyen-Orient. Il vit maintenant à Baltimore et est rédacteur en chef du journal.
 TABLE DES MATIÈRES:
TABLE DES MATIÈRES:
Prologue : Nord.
Chapitre 1. Différentes orientations.
Chapitre 2. "Une terre de glace".
Chapitre 3. Une dépendance au froid.
Chapitre 4. Île au trésor.
Chapitre 5. Rêves colonisateurs.
Chapitre 6. Kodlunarn.
Chapitre 7. Batailles.
Chapitre 8. Destinations.
Remarques.
Bibliographie choisie.
Remerciements.
Indice.
 AVIS PROFESSIONNELS:
AVIS PROFESSIONNELS:
AVIS: S'appuyant sur des documents originaux, des archives publiques et des recherches antérieures, Ruby raconte méticuleusement les voyages de Martin Frobisher et les voyages anthropologiques de Charles Francis Hall, qui s'est rendu dans l'Arctique canadien pour des raisons très différentes. Cette histoire fascinante s'étend en douceur de la cour d'Elizabeth I aux baleiniers du XIXe siècle, en passant par les descendants modernes des Inuits que Frobisher et Hall ont rencontrés. Frobisher cherchait à l'origine une route navigable vers la Chine vers 1576 après JC, mais les voyages ultérieurs en 1577 et 1578 étaient strictement destinés à l'approvisionnement en or et à l'établissement d'une colonie britannique, « Meta Incognita ». Hall a été « appelé » dans le nord en 1860 pour sauver les survivants imaginaires de l'expédition condamnée de Sir John Franklin en 1845. Hall ne parvient pas à atteindre les navires désertés, mais passe trois ans à vivre avec les Inuits de l'île de Baffin, qui le conduisent finalement aux vestiges des voyages de Frobisher. Il revint en 1864, endurant d'incroyables épreuves pour ensuite apprendre le sort horrible des hommes de Franklin (famine, exposition et cannibalisme), éliminant ainsi le besoin pour Hall d'être le « sauveur » de qui que ce soit. [Université d'Evansville].
AVIS: Un récit de deux explorateurs de l'Arctique et de la Meta Incognita (Rive inconnue) qu'ils ont tenté de s'installer lors de la première tentative de colonisation du Nouveau Monde par l'Angleterre. En 1576, Martin Frobisher a quitté l'Angleterre à la recherche d'une route commerciale vers le nord vers l'Asie, le légendaire « passage du Nord-Ouest » que les marins européens ont perdu des siècles à rechercher. Lors de son premier voyage, des « glaces monstrueuses » ont empêché son navire d'explorer le « détroit de Frobisher », et il est arrivé à la conclusion, à contrecœur, que le détroit était en réalité une baie, et donc pas la route qu'il recherchait. Cependant, comme preuve d'avoir atteint la terre ferme, Frobisher rapporta en Angleterre un Inuit captif et une pierre noire de la taille d'une brique. Des morceaux de roche furent dûment envoyés aux essayeurs, et l'un d'eux rapporta qu'ils contenaient de l'or. Peu de temps après, Elizabeth Ier accorda une charte à la société Cathay (lui donnant des droits exclusifs d'exploration dans la région), approuva les deuxième et troisième voyages là-bas et détermina que la colonisation avait un sens financier et devait se poursuivre immédiatement.
 En conséquence, 15 navires et 400 hommes partirent pour l'Arctique en 1578. Frobisher a perdu 40 hommes au cours du voyage, mais il a réussi à ramener chez lui 1 136 tonnes de roche noire, pour finalement découvrir qu'elle rapportait si peu d'or qu'elle ne valait rien. L'entreprise s'est rapidement effondrée et la réputation de Frobisher s'est effondrée avec elle. Ruby, rédacteur en chef du Baltimore Sun, associe le récit de Frobisher à celui de l'éditeur de journaux américain devenu explorateur Charles Francis Hall, qui s'est rendu dans l'Arctique en 1860. Hall fut profondément surpris d'apprendre (par un couple d'Inuits anglophones de l'île de Baffin) les voyages de Frobisher, et il devint obsédé par la découverte de l'ancienne colonie, dont il ne restait plus rien. Une histoire provocatrice d’aventure et de colonisation arctique. L'ouvrage est augmenté de 21 illustrations et 2 cartes).
En conséquence, 15 navires et 400 hommes partirent pour l'Arctique en 1578. Frobisher a perdu 40 hommes au cours du voyage, mais il a réussi à ramener chez lui 1 136 tonnes de roche noire, pour finalement découvrir qu'elle rapportait si peu d'or qu'elle ne valait rien. L'entreprise s'est rapidement effondrée et la réputation de Frobisher s'est effondrée avec elle. Ruby, rédacteur en chef du Baltimore Sun, associe le récit de Frobisher à celui de l'éditeur de journaux américain devenu explorateur Charles Francis Hall, qui s'est rendu dans l'Arctique en 1860. Hall fut profondément surpris d'apprendre (par un couple d'Inuits anglophones de l'île de Baffin) les voyages de Frobisher, et il devint obsédé par la découverte de l'ancienne colonie, dont il ne restait plus rien. Une histoire provocatrice d’aventure et de colonisation arctique. L'ouvrage est augmenté de 21 illustrations et 2 cartes).
AVIS: Au cours des années 1576 à 1578, la reine Elizabeth I d'Angleterre a envoyé trois expéditions sous la direction de Martin Frobisher pour trouver le légendaire passage du Nord-Ouest qui menait à la Chine. Ruby, rédactrice en chef du Baltimore Sun, raconte dans une prose vivante une incroyable saga de l'homme contre la nature dans la quête ratée de l'implantation d'une colonie dans le Grand Nord. Lors des premières expéditions, encouragé par des essayistes anglais incompétents ou malhonnêtes, l'ancien pirate Frobisher croyait avoir découvert de la roche aurifère. Rêvant de richesses fabuleuses, il espérait que la troisième expédition établirait une colonie pour extraire de l'or. Ils échouèrent cruellement (quelques hommes furent accidentellement laissés sur place lorsqu'un coup de vent soudain les força à retourner précipitamment en Angleterre), après avoir ramené des tonnes de roches inutiles et kidnappé quelques Inuits. L’histoire, enfouie dans des documents et des données techniques archéologiques, est restée inconnue de la plupart des passionnés d’histoire. L'excellent récit popularisé de Ruby sur Frobisher et ses hommes s'inspire de l'expédition des années 1860 de l'Américain Charles Francis Hall, qui a enregistré des histoires orales d'Inuits au sujet de Frobisher, ainsi que de découvertes archéologiques plus récentes. L’entrelacement de ces fils en un seul récit rend la lecture passionnante et comble une lacune dans les premiers efforts de colonisation du Nouveau Monde. [Hebdomadaire de l'éditeur].
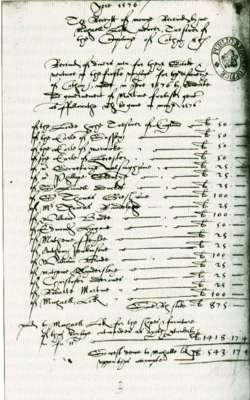 AVIS: Robert Ruby a habilement entrelacé l'histoire du fiasco Frobisher et la découverte par Hall de ses traces. « Unknown Shore » a plus que sa part de détails piquants. Pirates, ours polaires, avarice, soif d'aventure. De plus, un auteur dont la perspective engageante fait de lui un personnage aussi convaincant que les explorateurs obsédés qu'il traque à travers la glace. Pensez que « Undaunted Courage » rencontre « Into the Wild ». Ce récit finement tressé est à la fois une œuvre d’érudition miraculeuse et une bonne lecture passionnante.
AVIS: Robert Ruby a habilement entrelacé l'histoire du fiasco Frobisher et la découverte par Hall de ses traces. « Unknown Shore » a plus que sa part de détails piquants. Pirates, ours polaires, avarice, soif d'aventure. De plus, un auteur dont la perspective engageante fait de lui un personnage aussi convaincant que les explorateurs obsédés qu'il traque à travers la glace. Pensez que « Undaunted Courage » rencontre « Into the Wild ». Ce récit finement tressé est à la fois une œuvre d’érudition miraculeuse et une bonne lecture passionnante.
AVIS: Les univers polaires sont souvent et indiciblement vagues et mythologiques. C'est peut-être la raison pour laquelle, pendant tant d'années, ils ont exercé une surveillance aussi minutieuse à l'égard des explorateurs potentiels qui franchissaient les dernières frontières de la Terre. Ce qui est étrange, cependant, c'est que le récit de Ruby sur deux explorations arctiques parallèles à trois siècles d'intervalle donne l'impression que l'Arctique est plus désirable que le Nouveau Monde (édition du sud) de la Haute Renaissance ou que l'Amérique industrialisée beaucoup plus tard.
Martin Frobisher et Charles Francis Hall servent de serre-livres au récit de Ruby, qui sont montrés de manière assez experte comme des hommes différents d'abord et des explorateurs différents en dernier. Tous deux sont à la recherche de quelque chose, et Ruby nous montre heureusement qu'il s'agit bien d'eux-mêmes. Frobisher, sous le poids d'atteindre un passage vers Cathay et de remplir ensuite les coffres de la Renaissance anglaise avec du « minerai noir » alchimique, est en réalité un homme vautré dans la tourmente du rôle de second violon.
Hall, quant à lui, recherche l'Arctique non pas pour la richesse mais pour la reconnaissance, non pas pour ses exploits personnels, mais pour jouer le rôle de héros auprès d'un groupe d'hommes déjà réduits en poussière par le gel arctique. On se demande si Hall avait trouvé les hommes de Franklin et s'il aurait vraiment apprécié leur révélation au monde moderne. Ruby le rend certainement assez romantique pour essayer.
Alors que les régions polaires reçoivent de plus en plus d’attention dans les années à venir en raison de leur destruction plutôt que de leur mérite frontalier, des livres comme celui de Ruby sont essentiels pour rappeler que l’Arctique est plus qu’une simple tache en train de fondre dans le sillage du réchauffement climatique. En effet, des endroits comme la baie Frobisher et l'île de Baffin doivent être redécouverts non seulement pour leur beauté naturelle, mais aussi pour leur intersection humaine.
 Ainsi, d’une certaine manière, Ruby écrit une histoire environnementale qui, bien qu’imprégnée de supériorités occidentales, cherche à saper l’idée selon laquelle l’homme n’a jamais vraiment habité l’un des endroits les plus froids de la planète. Les Inuits sont véritablement les héros de ce récit, qu’il est facile de ressentir lorsqu’ils meurent un à un dès qu’ils se heurtent à des foyers européens ou américains.
Ainsi, d’une certaine manière, Ruby écrit une histoire environnementale qui, bien qu’imprégnée de supériorités occidentales, cherche à saper l’idée selon laquelle l’homme n’a jamais vraiment habité l’un des endroits les plus froids de la planète. Les Inuits sont véritablement les héros de ce récit, qu’il est facile de ressentir lorsqu’ils meurent un à un dès qu’ils se heurtent à des foyers européens ou américains.
Sur une note plus spéculative, Ruby nous dit par inadvertance, ou peut-être un peu ouvertement, qu'à chaque partie de la terre se trouve un ensemble d'hommes, et cet ensemble est limité. C'est agréable, en fin de compte, de croire encore que la nature peut gagner. Ruby nous fait croire pendant quelques centaines de pages que cela est toujours vrai.
AVIS: Unknown Shore: The Lost History of England's Arctic Colony de Robert Ruby est une histoire populaire de l'expiration de l'Arctique britannique. Il y a trois fils narratifs. Le premier est une discussion des trois voyages de Martin Frobisher. La seconde est l'histoire d'une tentative de journalistes américains du XIXe siècle de retrouver l'expédition Franklin. Le troisième est le voyage de l'auteur dans l'Arctique. En fait, il n'y a pas grand-chose ici sur la supposée colonie et étant donné qu'ils n'ont pas essayé de l'habiter lorsque les navires n'étaient pas présents, je pense que c'est un peu exagéré de l'appeler une colonie. L’auteur a évidemment effectué de nombreuses recherches dans les archives britanniques. Recommandé.
AVIS: Aventure, pirates, histoire, alchimistes et Inuits. Il s'agit de l'histoire d'un pirate anglais devenu explorateur dont peu de gens ont entendu parler et de l'établissement d'une colonie britannique sur une île arctique qui est peut-être encore moins connue ; mais cela ne change rien à cette véritable aventure élaborée. J'ai acheté celui-ci parce que j'ai aimé le dernier livre de l'auteur, "Jéricho", qui était l'histoire d'un lieu, mais aussi de l'archéologie elle-même et de vagues après vagues de scientifiques excentriques venus étudier les ruines de la célèbre ville. Ce nouveau livre a une portée encore plus large, depuis la puissance pré-navale de Londres où la moralité passait toujours au second plan au profit de la quête de fortune, jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Ouest où l'équipage d'un navire valait moins pour les investisseurs que quelques tonnes de poivre, jusqu'à le palais du tsar à Moscou, l'Atlantique Nord agité et les passages déroutants et remplis de glace au-dessus de l'Amérique du Nord.
 C'est un conte orné de personnages dessinés avec précision. L’érudition est si manifestement fiable que vous savez que vous n’obtenez pas les caricatures des magazines pop, par exemple « The Perfect Storm » de Sebastian Junger. De plus, avec le style de Ruby qui examine un lieu à travers les yeux de plusieurs aventuriers de plusieurs époques, vous obtenez un récit profondément texturé qui donne l'impression que "Into Thin Air" de Krakauer est unidimensionnel. À la fin, je m'étais non seulement amusé, mais j'avais absorbé une quantité extraordinaire de la SENTIMENT d'une époque, ou deux, et d'un lieu. En ce sens, il est également comparable à la série maritime Maturin et Aubrey de Patrick O'Brien.
C'est un conte orné de personnages dessinés avec précision. L’érudition est si manifestement fiable que vous savez que vous n’obtenez pas les caricatures des magazines pop, par exemple « The Perfect Storm » de Sebastian Junger. De plus, avec le style de Ruby qui examine un lieu à travers les yeux de plusieurs aventuriers de plusieurs époques, vous obtenez un récit profondément texturé qui donne l'impression que "Into Thin Air" de Krakauer est unidimensionnel. À la fin, je m'étais non seulement amusé, mais j'avais absorbé une quantité extraordinaire de la SENTIMENT d'une époque, ou deux, et d'un lieu. En ce sens, il est également comparable à la série maritime Maturin et Aubrey de Patrick O'Brien.
AVIS: Un exemple malheureusement rare d’ouvrage d’histoire éminemment lisible. Ruby fait un travail remarquable en plaçant son histoire dans le contexte de son époque avec la vision d'un historien moderne de l'histoire sociale et culturelle. C’est bien plus qu’un simple article d’une série de récits d’exploration de l’Arctique les plus en vogue . Grâce à une utilisation habile de ses sources, l'auteur donne vie à ses protagonistes européens et inuits. Le lecteur se retrouve avec l’image obsédante de fragments d’une île isolée de l’Arctique parsemant le paysage d’une banlieue prosaïque de Londres, témoignage à la fois de la folie et de la ténacité impressionnante des explorateurs du XVIe siècle. Il s’agit d’une lecture complémentaire fascinante pour les étudiants de la colonisation d’autres régions du monde.
AVIS: Super livre. Deux histoires entremêlées d’exploration de l’Arctique. Le premier concerne les voyages malheureux de colonisation, d'exploration et d'exploitation minière de Martin Frobisher au XVIe siècle. La seconde est celle des voyages de Charles Francis Hall dans la même région (au XIXe siècle) pour tenter de percer le mystère des cinq marins disparus lors du premier voyage de Frobisher. C'est une histoire d'avidité, de passage du Nord-Ouest, de colonisation malheureuse et de difficultés de voyage et de vie dans l'Arctique (à moins, bien sûr, que vous prêtiez attention aux Inuits). Le livre est méticuleusement documenté et très bien écrit pour le lecteur « commun ». Il est essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire « peu racontée » et pour ceux qui ont envie de voyager. Un critique l'a appelé "Into the Wild" et "Undaunted Courage"... Je pense que c'est une évaluation juste. Indispensable pour les passionnés d'histoire - en particulier ceux de « l'ère de l'exploration », car beaucoup n'ont jamais entendu parler de Frobisher et de son expédition malheureuse. Méfiez-vous du pouvoir aveuglant de la cupidité et faites toujours attention aux locaux. Lisez-le si vous le rencontrez.
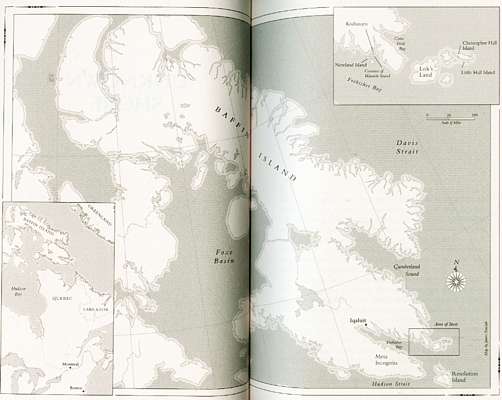 AVIS: C'est une excellente lecture sur l'Arctique. Il y a en fait deux histoires ici. Le premier tourne autour de l'explorateur et pirate anglais Martin Forbisher et le second sur un Américain Charles Francis Hall. Forbisher cherchait le passage du nord-ouest vers la Chine et a trouvé ce qu'il pensait être un passage et une pierre noire. Les essayeurs estimaient que la pierre pouvait rapporter une fortune en or.
AVIS: C'est une excellente lecture sur l'Arctique. Il y a en fait deux histoires ici. Le premier tourne autour de l'explorateur et pirate anglais Martin Forbisher et le second sur un Américain Charles Francis Hall. Forbisher cherchait le passage du nord-ouest vers la Chine et a trouvé ce qu'il pensait être un passage et une pierre noire. Les essayeurs estimaient que la pierre pouvait rapporter une fortune en or.
Le passage trouvé par Forbisher était une baie et la pierre contenait peu de métaux précieux. Hall recherchait les survivants d'une précédente expédition de Franklin dans l'Arctique. Il était déçu aussi. Ce qu'il a trouvé, ce sont les traces de l'expédition de Forbisher. Les deux explorateurs cherchaient quelque chose qui n’existait pas.
Le livre intéresse les historiens qui aiment les explorations de l'Arctique et de l'Antarctique. Ce qui est fascinant, c'est la vie des Inuits ou des peuples autochtones qui habitent cette terre inhospitalière. C'était intéressant de lire comment ces personnes se sont adaptées à leur environnement. L’homme blanc les a peut-être pris pour des sauvages. Ils étaient bien plus civilisés que les Blancs. Comme indiqué, une excellente lecture sur une expédition peu connue.
AVIS: Eh bien, c'était certainement surprenant. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire avant de trouver ce livre et l'exploration de l'Arctique et de l'Antarctique est mon truc. Il s’avère qu’il y a une bonne raison à cela. C'était un rodéo de chèvres depuis le début ! (Note de l'éditeur : « Goat rodeo » est un terme généralement utilisé dans l'armée américaine pour décrire le désordre d'une situation.)
Martin Frosbisher, pirate et méchant à tous les niveaux, est parti à la recherche du passage du Nord-Ouest. Il a trouvé des Inuits et ce qu'il pensait être des tonnes d'or. Il est revenu et a vendu l'histoire à Elizabeth I qui a profité de tout le monde. L'hilarité s'ensuit.
Ruby écrit deux histoires parallèles différentes. Le premier, sur le voyage de Frosbisher et le second sur l'expédition de Charles Francis Hall pour découvrir ce qui est arrivé à l'expédition Franklin.
Une bonne lecture. Ruby a un esprit sec que j'ai trouvé personnellement hilarant. Sauter entre Hall et Frosbisher était un peu distrayant. Les deux histoires sont dignes des livres qui leur sont consacrés mais peut-être pas simultanément.
 AVIS: C'était une bonne chose ! Exploration de l'Arctique, sans mourir de faim ni mourir de froid ! Ce livre retrace l'histoire des séries de voyages de Martin Frobisher de l'Angleterre à l'île de Baffin en 1576. Il est toujours vaguement mentionné dans les livres sur l'Arctique, mais celui-ci l'a couvert. (Il extrayait de l'or. Non, vraiment.) À cela s’ajoute l’histoire de Charles Francis Hall, qui s’est intéressé à l’Arctique et a décidé de s’y rendre. Et peut-être trouver John Franklin, mais surtout pour y aller. Et c’est ce qu’il a fait. Et j'ai découvert que les Inuits avaient encore des histoires sur l'expédition Frobisher. Une lecture agréable, qui met en lumière certaines des premières explorations de l'Arctique et ne m'a pas donné de cauchemars. Recommandé!
AVIS: C'était une bonne chose ! Exploration de l'Arctique, sans mourir de faim ni mourir de froid ! Ce livre retrace l'histoire des séries de voyages de Martin Frobisher de l'Angleterre à l'île de Baffin en 1576. Il est toujours vaguement mentionné dans les livres sur l'Arctique, mais celui-ci l'a couvert. (Il extrayait de l'or. Non, vraiment.) À cela s’ajoute l’histoire de Charles Francis Hall, qui s’est intéressé à l’Arctique et a décidé de s’y rendre. Et peut-être trouver John Franklin, mais surtout pour y aller. Et c’est ce qu’il a fait. Et j'ai découvert que les Inuits avaient encore des histoires sur l'expédition Frobisher. Une lecture agréable, qui met en lumière certaines des premières explorations de l'Arctique et ne m'a pas donné de cauchemars. Recommandé!
AVIS: Conte intéressant sur les trois expéditions anglaises du 16e siècle sur l'île de Baffin et les enquêtes des 19e, 20e et 21e siècles sur cette histoire peu connue. Ce qui me surprend le plus, c'est l'incroyable incuriosité et surtout le mépris total envers les Inuits de la part de Martin Frobisher et de la plupart de son groupe d'explorateurs de l'ère élisabéthaine. Explorateurs n'est probablement pas le bon mot car ils étaient moins intéressés à trouver le passage du nord-ouest qu'à s'enrichir en rapportant du minerai qu'ils pensaient contenir d'importantes quantités d'or. Les Anglais de ces expéditions et des expéditions ultérieures n'ont pas compris que les Inuits avaient élaboré une stratégie qui leur permettait de survivre dans ce monde hostile. Considérer les autochtones comme de grossiers sauvages garantissait que les leçons que les Inuits devaient enseigner ne seraient pas apprises.
AVIS: Ceci est le récit de l'un des explorateurs/aventuriers/pirates les moins connus, Martin Frobisher, qui a tenté de trouver le passage du Nord-Ouest et, sans y parvenir, a tenté d'établir la première colonie anglaise dans le nouveau monde. L'histoire est intéressante pour les passionnés d'histoire en raison de l'éloignement de l'époque et du courage, de la cruauté et de la futilité de l'effort. Comment les choses se passaient sous le règne de la reine Elizabeth C'est fascinant, l'auteur est clairement un maître de l'époque et sait aussi raconter une histoire. Cela fait plaisir de ne pas avoir vécu à cette époque.
AVIS: Le livre est assez divertissant car il reconstitue l'histoire de Martin Frobisher et ses aventures malheureuses dans l'Arctique élisabéthain et la découverte toujours fascinante de Charles Francis Hall de l'emplacement de la Meta Incognita de Frobisher au XIXe siècle. Pour un récit merveilleux et complet de Hall, voir le très beau Weird and Tragic Shores de C. Chauncey Loomis. Les deux histoires se mélangent assez bien et l’auteur fait perdurer le récit dans un clip divertissant. C'était une bonne lecture sur l'Arctique pour ceux qui sont accros à ces livres et un bon point de départ pour quelqu'un qui veut apprendre ce qu'est la dépendance à ces livres sur l'Arctique à partir d'un livre qui montre des hommes dont la dépendance à ce monde froid était bien plus profonde. que de simplement lire à ce sujet.
 AVIS: J'étais très intéressé par la base aérienne Frobisher, maintenant l'aéroport d'Iqaluit. Mon intérêt s'est concentré sur le rôle qu'il a joué dans les plans de guerre nucléaire américains, l'alerte précoce, les communications et la localisation stratégique au cours des années 80 et 90. Je devais d’abord en apprendre davantage sur l’histoire de la région et son exploration. Unknown Shore a fourni ce premier aperçu des débuts de la vie et de l'exploration. La distribution des personnages et la manière dont leurs noms sont devenus des emplacements géographiques sont cependant expliquées dans une moindre mesure. Si vous aimez lire sur les régions reculées et difficiles du monde, vous aimerez ce livre.
AVIS: J'étais très intéressé par la base aérienne Frobisher, maintenant l'aéroport d'Iqaluit. Mon intérêt s'est concentré sur le rôle qu'il a joué dans les plans de guerre nucléaire américains, l'alerte précoce, les communications et la localisation stratégique au cours des années 80 et 90. Je devais d’abord en apprendre davantage sur l’histoire de la région et son exploration. Unknown Shore a fourni ce premier aperçu des débuts de la vie et de l'exploration. La distribution des personnages et la manière dont leurs noms sont devenus des emplacements géographiques sont cependant expliquées dans une moindre mesure. Si vous aimez lire sur les régions reculées et difficiles du monde, vous aimerez ce livre.
AVIS: J'ai lu beaucoup de non-fiction historique. C'était une excellente lecture, une bonne histoire d'aventure et, surtout, elle a mieux retenu mon attention que les six derniers livres que j'ai lus. J'ai été fasciné, bien que toujours largement intrigué par les aventures arctiques depuis des années - mettez celle-ci aux côtés de tous les trucs de Shackelton et Franklin comme valant votre temps. Le livre contenait quelques petites informations intéressantes sur la vie de cour élisabéthaine et bien sûr sur les Inuits d'hier et d'aujourd'hui. Je ne savais pas que le gouvernement canadien les identifiait avec une série de numéros et de noms de famille, triste. Je suppose que notre gouvernement n’est pas le seul à déshumaniser et à asservir les populations autochtones.
AVIS: L'auteur a fait beaucoup de recherches. D'après les exemples d'écriture manuscrite des années 1500, je peux imaginer qu'il a fallu un certain temps pour comprendre quels sont les mots manuscrits. Le livre est en réalité une histoire en trois parties : celle de Frobisher, celle de Hall et celle des Inuits modernes. L'auteur fait du bon travail en mêlant tout cela ensemble.
AVIS: Un gâchis incroyable. Une mise en garde sur ce qui peut arriver lorsque les plus grands scientifiques contrôlent la politique gouvernementale. L'histoire de Martin Frobisher était intéressante.
AVIS: J'ai trouvé les faits assez intéressants, mais leur récit est peut-être un peu inégal. Mais je dois admettre qu'il y avait des parties vraiment fascinantes. Martin Frobisher était vraiment un gars intrigant !
AVIS: C'était un livre intéressant sur un peu d'histoire que je connaissais peu. Comme le territoire qu'il décrit, il est cependant un peu clairsemé. Mais j'ai aimé le lire et je le recommanderais à d'autres.
CONTEXTE SUPPLÉMENTAIRE:
La vie quotidienne dans l'Europe de la Renaissance: Comment définir la vie quotidienne à une époque du passé ? Pour ce faire, il faut examiner une grande variété de facteurs. Comment les gens s’habillaient-ils et que mangeaient-ils ? Qu'ont-ils fait pour s'amuser ? Les riches et les pauvres ont-ils fait les mêmes choses ? Pour comprendre la vie quotidienne, nous devons examiner ces questions ainsi que la politique, la guerre, l’art, l’économie, la religion et les effets de la maladie sur les familles et les groupes sociaux. Tout examen des différentes régions de l’Europe de la Renaissance inclura nécessairement les coutumes des différents peuples du début et de la fin de la Renaissance. Il comprendra également un examen des facteurs sociaux et économiques qui affectent la vie quotidienne des gens.
 L’Europe de la Renaissance n’était pas une société unifiée unique avec les mêmes traditions dans tout le pays. Chaque région avait des langues, des compositions ethniques et des facteurs géographiques distincts qui façonnaient la vie quotidienne. D’une manière générale, les sociétés méditerranéennes ont connu des étés chauds et secs et des hivers frais et pluvieux. Les pays d’Europe du Nord ont connu des étés doux et tempérés et des hivers longs et froids. La région méditerranéenne possédait des chaînes de montagnes arides (sèches) ou semi-arides. L'Europe du Nord était caractérisée par de vastes étendues de plaines fertiles et de forêts. La mer Méditerranée reliait le Sud aux cultures et aux peuples plus anciens d’Afrique du Nord et d’Asie.
L’Europe de la Renaissance n’était pas une société unifiée unique avec les mêmes traditions dans tout le pays. Chaque région avait des langues, des compositions ethniques et des facteurs géographiques distincts qui façonnaient la vie quotidienne. D’une manière générale, les sociétés méditerranéennes ont connu des étés chauds et secs et des hivers frais et pluvieux. Les pays d’Europe du Nord ont connu des étés doux et tempérés et des hivers longs et froids. La région méditerranéenne possédait des chaînes de montagnes arides (sèches) ou semi-arides. L'Europe du Nord était caractérisée par de vastes étendues de plaines fertiles et de forêts. La mer Méditerranée reliait le Sud aux cultures et aux peuples plus anciens d’Afrique du Nord et d’Asie.
Les exceptions étaient les villes hanséatiques. Ces villes appartenaient à un réseau commercial appelé la Ligue Hanséatique. La ligue était composée de l’Allemagne du Nord et des villes industrielles cosmopolites des « Pays-Bas ». Les « Pays-Bas » faisaient référence à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Partout ailleurs, la population européenne était dispersée dans les zones rurales. Dans ces régions, paysans et nobles côtoyaient parfois les bergers des plaines. Cela se produisait chaque année lorsque les bergers descendaient leurs troupeaux des hauts pâturages à l'automne et cherchaient du travail en hiver.
Les Européens étaient souvent en déplacement. Ils allaient au marché, se rendaient dans les centres politiques pour payer leurs impôts ou se lançaient dans des pèlerinages religieux. Les populations méditerranéennes se déplaçaient d'une ville portuaire à l'autre à bord de navires. Par voie terrestre, ils se déplaçaient à pied ou inconfortablement à dos d'âne. Les Européens du Nord se déplaçaient à pied, mais au fil du temps, de plus en plus en bateau sur les canaux et les rivières. De nombreuses auberges, tavernes et établissements religieux accueillaient les voyageurs. Le genre et la classe sociale façonnaient également la vie quotidienne. Les femmes des classes supérieures étaient confinées à la maison ou au tribunal. Lorsqu'ils se rendaient au marché, soit ils étaient escortés, soit ils voyageaient en groupe. Il en était de même lorsqu’ils se rendaient à l’église ou à des événements civiques ou religieux spéciaux. Les femmes de la classe moyenne et les femmes pauvres consacraient beaucoup de temps à travailler.
Les femmes de la classe moyenne étaient artisanes ou commerçantes. Les femmes des couches économiques inférieures travaillaient dans les champs si elles étaient paysannes ou dans les ménages si elles étaient servantes. Les femmes des classes élites supervisaient un personnel domestique et surveillaient l'éducation de leurs enfants. Les nobles passaient leur temps à la cour, à la guerre ou à gérer leurs domaines. Dans les zones urbaines, certains hommes exerçaient des activités commerciales. Cela était particulièrement vrai en Italie. La vie politique était ouverte à quelques privilégiés. Cependant, les possibilités pour les nobles d'avoir un impact significatif sur la politique ont diminué à mesure que les princes et les rois gagnaient en pouvoir.
Dans les petites zones urbaines, les nobles de rang moyen dirigeaient la politique locale. Parfois, ils gouvernaient de manière indépendante s’ils n’avaient pas encore fait partie de la structure politique d’un État régional. Mais le plus souvent, leur autorité était subordonnée à l’autorité des capitales des États territoriaux. Quel que soit le contexte, la vie politique était presque entièrement le domaine des hommes des classes supérieures. Les hommes ruraux participaient aux affaires du village par l'intermédiaire des conseils paroissiaux ou villageois. Ceux-ci étaient à leur tour dirigés par des prêtres ou des seigneurs locaux.
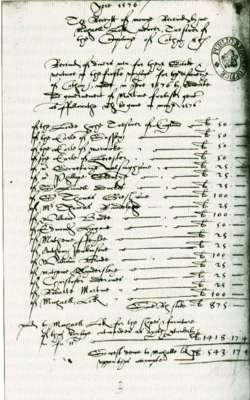 Dans l’Europe de la Renaissance, le cycle économique qui a duré de 1450 à 1550 a commencé et s’est terminé par une crise. Aux premiers stades du cycle, l’Europe se remettait des pertes de population et de la dépression économique qui avait suivi l’épidémie calamiteuse et généralisée connue sous le nom de « peste noire ». À mesure que les niveaux de population commençaient à se rétablir, les gens devenaient plus prospères. Les salaires des travailleurs permettaient d'acheter une nourriture plus abondante et de meilleure qualité. À partir de cette époque et jusqu’en 1550, le salaire d’un ouvrier moyen était suffisant pour fournir une bonne nourriture et une maison chaude et propre à la famille. Puis les prix ont commencé à augmenter rapidement. Vers 1600, les augmentations cumulées des prix avaient atteint 200 à 300 pour cent de plus qu’elles n’avaient été cinquante ans plus tôt.
Dans l’Europe de la Renaissance, le cycle économique qui a duré de 1450 à 1550 a commencé et s’est terminé par une crise. Aux premiers stades du cycle, l’Europe se remettait des pertes de population et de la dépression économique qui avait suivi l’épidémie calamiteuse et généralisée connue sous le nom de « peste noire ». À mesure que les niveaux de population commençaient à se rétablir, les gens devenaient plus prospères. Les salaires des travailleurs permettaient d'acheter une nourriture plus abondante et de meilleure qualité. À partir de cette époque et jusqu’en 1550, le salaire d’un ouvrier moyen était suffisant pour fournir une bonne nourriture et une maison chaude et propre à la famille. Puis les prix ont commencé à augmenter rapidement. Vers 1600, les augmentations cumulées des prix avaient atteint 200 à 300 pour cent de plus qu’elles n’avaient été cinquante ans plus tôt.
Dans une certaine mesure, cette hausse des prix que nous appelons « inflation » était due à de grandes quantités d’or provenant des colonies européennes des Amériques. La gravité de l’inflation variait d’une région à l’autre. De même, la capacité des travailleurs à vivre de leur salaire variait également d'une région à l'autre. Les zones rurales au cours de ce cycle économique ont connu une expansion d’une économie monétaire. Cela signifie une économie qui fonctionne sur l’argent liquide comme moyen d’échange, et non sur le crédit ou les biens troqués. Au départ, cette économie monétaire créait un problème à la fois pour les seigneurs et les paysans. Ce problème était simplement de savoir comment convertir la richesse en terres et en biens en espèces de plus en plus nécessaires.
La classe noble a résolu ce problème en forçant simplement les paysans à payer en espèces. Autrefois, les paysans « s'acquittaient » de leurs obligations féodales envers le seigneur d'un manoir. Les paysans devaient d'abord donner de leur travail pour travailler la terre du seigneur. Ensuite, ils étaient tenus de donner à leur seigneur un pourcentage des récoltes et autres produits que les paysans produisaient sur les terres qui leur étaient attribuées. Dans la nouvelle économie monétaire, les paysans devaient trouver des moyens d’obtenir de l’argent pour payer le seigneur. Certains trouveraient un emploi supplémentaire et travailleraient contre un salaire. D’autres produiraient des biens excédentaires, comme cultiver de la nourriture supplémentaire ou fabriquer de la poterie. Ils revendaient ensuite ces produits sur le marché local. Certains ont été contraints de devenir des criminels et ont commencé à faire de la contrebande de marchandises pour gagner de l'argent supplémentaire. Entre-temps, le fossé entre riches et pauvres se creusait. Les classes supérieures et marchandes ont profité de l’économie monétaire pour créer des banques et des entreprises prospères. Ces entreprises constituaient la base du capitalisme moderne caractérisé par la propriété privée ou corporative des biens.
La parenté occupait une place importante dans la vie de la Renaissance. On y faisait référence par divers termes. Parmi ces termes figuraient la lignée, la maison, la race, le sang et la famille. La parenté était définie par les interdictions de l'inceste de l'Église catholique romaine. Celles-ci ont été codifiées dans des lois interdisant les relations sexuelles avec les membres de la famille. La parenté comprenait toute personne ayant une ascendance commune remontant à quatre générations. En d’autres termes, la notion de « parenté » s’étendait aux cousins au troisième degré. Sont également inclus les conjoints de ces parents et certains liés par une filiation divine. Un parrain est bien entendu celui qui parraine le baptême d'un enfant. Certaines lois laïques ou non religieuses accordaient des droits d'héritage aux descendants d'ancêtres communs encore plus éloignés.
En réalité, la parenté était généralement considérée de manière plus étroite. Le concept commun de « parenté » se limitait aux individus dont les noms étaient connus et qui se voyaient de temps en temps. La notion de parenté variait également selon la position sociale et la richesse. La manière standard de compter la filiation passait par les pères. Les mères étaient invisibles dans la plupart des généalogies, c'est-à-dire dans les documents retraçant les générations de familles. En tant que membre d'une lignée familiale, un individu appartenait à un groupe d'agnats ou de personnes liées par le sang par des parents mâles. Cependant, les parents de sang maternel étaient également importants. Retracer l'ascendance par les deux parents était très pratiqué à l'époque, malgré l'accent mis davantage sur les lignées paternelles.
Les proches sans lien de sang pourraient également être importants. L'Église incluait à la fois l'affinité et la consanguinité dans sa définition de la parenté. L'affinité était une parenté par mariage. La consanguinité était la parenté d'individus de même sang ou de même origine. Des liens de parenté avantageux constituaient l'objectif premier de nombreux mariages. La parenté était différente pour la noblesse que pour la majorité des gens. Les gens ordinaires n’avaient pas les ressources nécessaires pour connaître une multiplicité de relations différentes. L’élite, en revanche, pouvait revendiquer la connaissance d’ancêtres même lointains. Les familles les plus nombreuses et les plus étendues appartenaient aux couches supérieures de la société. La Renaissance était une époque de dynasties, définies comme des familles qui détiennent le pouvoir pendant plusieurs générations. Ces dynasties n'étaient pas seulement des dynasties royales, mais aussi des dynasties nobles, patriciennes ou aristocratiques, marchandes ou marchandes.
Les noms de dynasties étaient au moins aussi importants que les noms d’individus. En fait, les principaux acteurs politiques de l’Europe de la Renaissance n’étaient pas des individus mais des familles. Parmi les familles les plus puissantes de l'Europe de la Renaissance figuraient les Colonna et les Orsini de Rome, en Italie ; les Médicis et Strozzis de Florence, Italie ; la famille élargie Contarini de Venise, Italie ; les Fugger d'Augsbourg, en Bavière ; la Maison des Habsbourg en Autriche et en Espagne ; la Maison Tudor en Angleterre ; et la Maison des Valois de France. Le premier parmi les symboles des familles puissantes était le nom de famille, c'est-à-dire le nom de famille. L'utilisation d'un nom de famille était relativement nouvelle au début du XVe siècle. Il fut d'abord associé à des familles importantes qui prenaient les noms d'ancêtres importants ou les noms de territoires qu'ils contrôlaient. Les symboles les plus visibles étaient les armoiries, c'est-à-dire les emblèmes avec des symboles familiaux.
Ces armoiries décoraient les maisons, les meubles, les vêtements des serviteurs et divers autres objets. Les œuvres publiques d’un pape en tant que chef suprême de l’Église catholique romaine étaient même marquées des armes de sa famille. Les maisons étaient aussi des symboles familiaux. La taille et l’apparence d’une maison proclamaient pouvoir et richesse. L'héritage était la clé du pouvoir familial dans les familles modestes comme dans les familles aisées. La propriété était transmise par une succession d'individus censés préserver et mettre en valeur ce qu'ils recevaient. Il n'y avait pratiquement aucun aspect de la vie d'un individu qui ne soit affecté par la parenté. Cela était particulièrement vrai pour quelqu’un appartenant à une famille importante. Les nobles et les patriciens étaient parfaitement conscients de leurs ancêtres.
Les nobles construisaient des généalogies parfois en partie fictives. Ils pourraient peut-être nommer un héros de l’Antiquité comme étant à l’origine de la lignée familiale. Préserver la mémoire des ancêtres est devenu important pour les familles chrétiennes. Des cérémonies funéraires élaborées, des monuments et des chapelles familiales ont conservé les noms de certaines grandes familles jusqu'à nos jours. Chaque membre d'une grande famille partageait la réputation de la famille. Il est cependant difficile de savoir s’il en va de même pour les individus des classes inférieures. Les grandes familles éclipsaient les autres. Cela était particulièrement vrai en matière d’État. Parfois, ces grandes familles semblaient être les seules, ou du moins complètement dominantes, dans une région particulière.
La perte de l'honneur familial était un fardeau collectif. Un individu reconnu coupable d’un crime grave ne fait pas seulement honte à ses proches. Cela pourrait également leur faire perdre pendant des générations les privilèges légaux dont ils jouissaient en tant que membres de la noblesse. Les femmes avaient une responsabilité particulière dans le maintien de l'honneur de la famille de leur mari en étant sexuellement irréprochables. Les femmes devaient être vierges au moment du mariage et rester fidèles à leur mari. Tous les parents étaient impliqués dans des rivalités avec d'autres familles. Les querelles et les rancunes de longue date étaient une caractéristique de la culture de la Renaissance.
Les désirs individuels n’ont jamais été aussi importants que les besoins de la famille. Les choix de mariage et de carrière étaient basés sur ce qui était bon pour la famille. Les membres de la famille en position de pouvoir ont l’obligation d’aider leurs proches. Les parents les plus riches étaient censés venir au secours des membres de la famille. Même dans les classes les plus basses, la première source d'aide pour les pauvres était la famille. Les lois anglaises obligeaient les parents proches tels que les grands-parents, les tantes ou les oncles à subvenir aux besoins des parents. Les membres des grandes familles pensaient qu'ils avaient le droit de demander de l'aide à des parents éloignés. Le système des obligations familiales et du pouvoir familial peut se résumer dans le mot « népotisme ». Le terme est défini comme la pratique consistant à favoriser les membres de sa famille par rapport aux autres.
Loin d'être considéré comme corrompu, le népotisme ou le favoritisme envers sa famille était admiré. Les exemples les plus célèbres se trouvent dans la papauté de la Renaissance, la fonction du pape. Au cours d'un règne généralement court, un pape agissait rapidement pour faire progresser la carrière et le statut de ses proches. À la lumière du célibat imposé par l’Église, cela serait le plus souvent en faveur de la famille immédiate d’une sœur. Le pape décernait des titres honorifiques, distribuait des biens et organisait des mariages puissants. Le pape élèverait également les neveux au poste de cardinal, une fonction officielle située directement en dessous du pape.
Les papes faisaient à grande échelle ce que faisaient les autres membres de la noblesse s’ils en avaient l’occasion. Les dames d'honneur royales, c'est-à-dire les servantes de la cour des reines, par exemple, « prenaient soin » des maris, des frères et des enfants. Dans la mesure du possible, l'objectif était de mettre un proche dans une position où la famille bénéficierait de faveurs futures. Plus particulièrement, un objectif complémentaire était de mettre les proches dans une position leur permettant d'acquérir quelque chose de précieux qui pourrait être transmis aux générations futures. À la Renaissance, le mot le plus souvent utilisé pour désigner une maisonnée était « famille ». Même si le terme « famille » avait également d’autres connotations, il était avant tout synonyme de ménage.
Comme c'est le cas aujourd'hui, le ménage de loin le plus courant était la famille nucléaire, ou ménage conjugal. Celui-ci était composé d'un couple marié et de leurs enfants. Un autre type de ménage courant parmi les paysans est appelé la « famille souche ». Ce ménage est basé sur un système d'héritage dans lequel les biens sont transmis à un seul héritier. L'héritier des biens familiaux reste dans le ménage avec ses parents après son mariage. Cela formait ainsi un foyer familial élargi qui pourrait produire une troisième génération de foyer. Les ménages appelés « ménages conjoints » étaient moins courants. C'était basé sur un couple marié et leurs fils. Tous les fils, leur épouse et leur progéniture sont restés dans la maison après leur mariage.
Un développement important à la Renaissance fut le concept de vie privée. Cette notion impliquait un changement général dans la mentalité qui provenait de l'accent mis par les humanistes sur l'individualisme. Au Moyen Âge, les sphères publique et privée étaient indissociables et étroitement liées. Les besoins de l’individu n’ont jamais été aussi importants que ceux de la communauté ou du groupe. La situation change au XVe siècle, et même avant en Italie. Avec le développement du commerce, des villes et des richesses, certains ont alors les moyens et l’envie de se distinguer des autres. De plus, les monarques et les princes qui s’occupaient d’accumuler des richesses et du pouvoir politique ont créé un État dans lequel les individus se définissaient par ce qu’ils possédaient. Les changements dans la vie religieuse ont également affecté la société. Les individus ont commencé à regarder à l’intérieur et à se concentrer sur la communion avec Dieu.
Les changements dans le rôle de la famille ont également eu une influence importante sur cette évolution. Dans certaines régions de l'Europe de la Renaissance, dès le XVIIe siècle, la maison est devenue un lieu où l'on pouvait se cacher des commérages et du jugement du public. Le ménage conjugal était généralement le plus petit en taille. Les ménages regroupés étaient parfois assez nombreux. Par exemple, une famille toscane du début du XVe siècle comprenait 47 membres, tous liés par le sang ou par alliance. Il s’agissait cependant d’un ménage inhabituellement nombreux. La principale détermination de la taille d’une famille était la richesse. Quelle que soit la manière dont un « ménage » est structuré, il existe des différences entre la majorité des ménages les moins privilégiés et les ménages des privilégiés économiquement et socialement.
La plupart des ménages comptaient en moyenne cinq ou six membres. Certains comptaient un ou deux membres, mais les ménages aux moyens modestes pouvaient atteindre neuf ou dix. Les ménages d'élite étaient nombreux même s'ils étaient de structure conjugale, car les parents et les enfants n'étaient pas les seuls habitants. Les ménages de la Renaissance comprenaient presque toujours des personnes qui n'avaient aucun lien de parenté entre elles. C'étaient généralement des domestiques. Une maison paysanne pouvait compter au maximum deux ou trois domestiques. Cependant la maison d'un seigneur pouvait compter quarante serviteurs, voire plus. Les foyers d’élite se sont développés aux XVe et XVIe siècles, puis ont progressivement diminué. Mais même alors, ils restaient énormes par rapport à ce qui était typique des ménages aux moyens plus modestes.
Certains membres des ménages étaient difficiles à catégoriser, même pour les contemporains. Les orphelins qui vivaient avec des oncles et des tantes étaient parfois considérés comme des serviteurs. Les proches âgés pourraient se trouver dans une situation similaire. Les belles-mères, les demi-frères et sœurs et les enfants nés hors mariage compliquent encore davantage la structure des ménages. Les locataires qui payaient des frais pour vivre dans la maison d'une autre famille compliquaient encore davantage la catégorisation facile d'un ménage, car ils n'étaient ni des serviteurs ni des parents. Cependant, quelle que soit leur composition, les ménages étaient des centres de production. À tous les niveaux sociaux, la plupart étaient engagés dans des activités agricoles. Les ménages nobles étaient organisés pour l'utilisation de la terre. Les terres étaient généralement gérées par les officiers des seigneurs. C'étaient des serviteurs d'un statut relativement élevé.
Les paysans appelés métayers produisaient à la fois pour le seigneur et pour eux-mêmes. Ils vendaient les marchandises excédentaires contre de l'argent sur le marché local lorsqu'ils le pouvaient. Qu'ils soient locataires, métayers ou propriétaires directs, les paysans utilisaient le travail de toute leur maisonnée. Tout le monde a participé au monde nécessaire pour subvenir à ses besoins. Cela comprenait les enfants, les épouses et les serviteurs s'ils en avaient. Les grandes maisons étaient aussi les centres du pouvoir politique. Cela comprenait les maisons des rois et des princes jusqu'aux maisons des seigneurs des petits manoirs. Différents niveaux de justice étaient administrés par des officiers de maison des seigneurs seigneuriaux et territoriaux, y compris des seigneurs d'église comme les abbés. La principale fonction politique des petits ménages était de constituer des unités gouvernées.
Les chefs de famille étaient imposés plutôt que les particuliers. La consommation de biens était différente d’aujourd’hui. La consommation des ménages les plus pauvres pouvait difficilement être séparée de la production, puisque la production elle-même garantissait les moyens de subsistance du ménage. En revanche, la consommation des grands ménages était abondante. La taille même des maisons était un indicateur de richesse. L’apparence extérieure était censée transmettre puissance et importance. La décoration intérieure était censée impressionner, souvent avec des rappels des ancêtres distingués du propriétaire. Un grand nombre de serviteurs proclamaient également le statut de propriétaire. Tout cela était généralement affiché lorsque les ménages recevaient des invités, un phénomène fréquent dans la plupart des foyers riches.
La qualité du logement, tant urbain que rural, s'est progressivement améliorée au cours de la Renaissance. Parmi les civilisations et les cultures des principaux continents, les Européens étaient les mieux logés et nourris. Ceux de la classe noble qui n'avaient pas connu des moments difficiles vivaient relativement confortablement dans des châteaux ou des manoirs en bois ou en pierre. Le mouvement vers la construction en pierre s'accentue à partir de 1400. L'accent a été particulièrement mis sur le remodelage des structures médiévales en pierre. Cela était particulièrement vrai en France. Le remodelage améliorerait la structure pour répondre aux normes architecturales établies dans l'Italie de la Renaissance. Les paysans vivaient dans des maisons en bois ou en terre avec des toits de chaume et des sols en terre battue. Les améliorations majeures apportées à ces habitations sont venues de la pratique du carrelage, abondant et peu coûteux.
Cependant, dans les habitations des paysans, il n'y avait pas grand-chose à part un écran pour diviser une pièce d'une autre et/ou pour séparer les occupants humains de leurs animaux de ferme. Les puces et autres insectes constituaient un problème constant, surtout en été. Les salles de bains et les cheminées étaient inconnues jusqu'au XVIIe siècle. Le mobilier des maisons différait selon le statut social et économique. Dans les maisons des seigneurs, les lits, les tables et les chaises étaient confortables et élaborés. Les plaques de métal étaient à la mode en Italie au XVe siècle. La vaisselle en céramique était une spécialité de la région Romagne. Il s’agissait de poteries cuites à haute température dans un four. Parmi les pauvres, les matelas de paille, les chaises ou les tables fabriquées à partir de moitiés de tonneaux étaient monnaie courante. La cuisine et les repas étaient généralement centrés sur une cuisinière en métal, avec une marmite et une tasse en cuivre.
La plupart des écrits de la Renaissance sur la gestion des ménages approuvaient une structure de pouvoir dans laquelle le maître, ou chef de famille, était l'autorité suprême à laquelle tous les autres membres étaient censés obéir. Les très grands ménages étaient censés être organisés en différents niveaux d'autorité. Les notions de ménage affectaient la manière dont de nombreuses autres institutions étaient gérées. Une monarchie était censée être peu différente d’une maison bien gérée. Un reproche majeur au roi Richard II d'Angleterre (qui régna de 1377 à 1399) était qu'il ne gérait pas ses finances comme une bonne gouvernante. Les institutions monastiques étaient organisées comme des ménages. Les écoles et les collèges étaient également organisés. Cela s'explique en partie par le fait que certaines d'entre elles étaient des maisons de maîtres d'école, et en partie par le fait que ce modèle semble avoir été incontournable.
Seules les classes d’élite des villes bénéficiaient du style, du confort et de la beauté en matière de logement, de mobilier et de nourriture. L'Italie était à l'avant-garde en matière de qualité de vie parmi les classes aisées. Les villes du nord de l’Europe, par exemple, n’ont remplacé le bois par la pierre qu’au XVIe siècle. Les Italiens ont commencé à construire en pierre au Moyen Âge. Ils ont porté le processus à un niveau élevé avec la construction de palais Renaissance au XVe siècle. À cette époque, une vaisselle en céramique élaborée et magnifique remplaçait les plaques de métal de la période antérieure. La vaisselle en céramique était non seulement moins chère que la vaisselle en métal, mais elle améliorait également le goût des aliments. Les bonnes manières à table sont apparues pour la première fois chez les Italiens. À cela s’ajoutait une cuisine relativement plus raffinée. Ces techniques de restauration et de préparation des aliments plus raffinées ont ensuite fait leur chemin vers la France à partir de 1550 environ.
Les pauvres des villes vivaient moins bien. Cela témoigne de l’écart croissant entre les riches et les pauvres dans les villes. Les pauvres des villes vivaient dans des conditions terribles. Ceci est relaté dans les registres d'inventaire établis de leurs biens après le décès. Au moment de sa disparition, une personne pauvre typique possédait quelques ustensiles de cuisine de mauvaise qualité, une marmite en métal noirci, des poêles à frire, des lèchefrites et une planche pour pétrir le pain. D'autres effets personnels peuvent inclure quelques vieux vêtements, un tabouret et une table. Certains possédaient peut-être un banc faisant également office de lit ainsi que quelques sacs de paille servant de matelas. Des objets comme ceux-ci meublent la vie dans des chambres louées bondées. Ces pièces étaient généralement sombres et sales et situées aux étages supérieurs des immeubles. Ces étages étaient souvent spécifiquement réservés aux pauvres.
Les pauvres sans abri vivaient dans des bidonvilles, des congrégations de petits foyers temporaires. En 1560, à Pescara, en Italie, par exemple, quatre cents personnes sur une population de deux mille habitants vivaient dans de telles conditions. À Gênes, en Italie, chaque hiver, les pauvres se vendaient comme galériens. Ils équipaient et ramaient les rames sur de grands navires commerciaux appelés galères. A Venise, les indigents vivaient dans de petites embarcations sous les ponts des canaux ou le long des quais. Dans chaque ville, les pauvres vivaient avec des puces, des poux et d'autres parasites. La pauvreté et la misère étaient visibles partout.
Dans la société de la Renaissance, le mariage était le fondement du foyer et de la parenté. Ces ménages constituaient à leur tour les fondements de la société et de l’État. Dans la plupart des régions d’Europe, fonder un foyer et commencer la vie conjugale étaient essentiellement la même chose. La plupart des célibataires ne créent pas de foyer avant de se marier. Les parents étaient très conscients de leurs liens de sang et de mariage. Ces liens étaient considérés comme un moyen d’étendre et de renforcer la parenté. Les alliances matrimoniales entre les familles dirigeantes scellaient les traités de paix et créaient parfois des empires.
Toutes les religions s’accordent sur la valeur du mariage pour prévenir les comportements sexuels pécheurs. Le mariage était une institution spirituelle et respectée. En 1439, l’Église catholique romaine a officiellement déclaré le mariage un sacrement ou une obligation religieuse. Même les protestants croyaient que le mariage était une relation singulièrement bénie par Dieu. Même les ministres protestants étaient encouragés à se marier. Et ce, malgré le fait que les prêtres catholiques ne pouvaient pas se marier et prononçaient vœux de chasteté. Jusqu’à la Réforme, c’était l’Église, et non l’État, qui définissait et supervisait légalement le mariage.
Même si un assez grand nombre de personnes restaient célibataires, le mariage était considéré comme le sort normal des gens ordinaires. Les célibataires comprenaient ceux qui n’avaient pas les moyens de se marier. Parmi eux figuraient également ceux qui étaient exclus de la société, peut-être en raison d'un handicap ou d'une difformité physique ou mentale. Parmi les célibataires figuraient également les célibataires religieux qui choisissent de ne pas avoir de relations sexuelles afin de plaire à Dieu. Les mariages avaient tendance à avoir lieu entre personnes de milieux sociaux et financiers similaires et étaient généralement limités aux partenaires de la région. Dans les villages ruraux et les quartiers urbains, les fréquentations se sont développées à partir des contacts de la vie quotidienne.
Le mariage était différent pour les très riches. Les jeunes de statut supérieur étaient plus étroitement encadrés. Le bassin de mariage pour eux a été considérablement élargi afin de garantir qu'ils soient judicieusement assortis. Les membres des plus hauts niveaux de la noblesse étaient parés aux partenaires d'autres régions, voire d'autres pays. Pour eux, la cour n'avait lieu qu'après qu'un partenaire avait déjà été présélectionné par les parents ou d'autres proches. De tels mariages arrangés pouvaient faire l’objet de protestations et être annulés. Cependant, dans la pratique, cela se produisait rarement. Dans les classes inférieures, le choix du conjoint était parfois fait par les jeunes. Cependant, la sélection et/ou la « cour » étaient soumises à l’approbation parentale. Ces sélections étaient rarement rejetées par les parents. Cependant, l'Église avait souvent son mot à dire dans l'approbation d'un futur mariage.
Pour les membres de la noblesse, les alliances politiques par le mariage étaient importantes. Cependant, en raison de la nature très unie de la noblesse, il y avait souvent le danger d'épouser un proche dans la lignée. L'Église protestante a réduit le nombre de mariages interdits tant par le sang que par les liens matrimoniaux. Cependant, l'Église catholique a conservé toutes ses limites traditionnelles. Cependant, des exceptions et des autorisations étaient souvent accordées aux couples éloignés. Même si l’intimité sexuelle avant le mariage n’était pas tolérée, il n’était pas rare que des femmes des classes inférieures soient enceintes au moment de leur mariage. Les groupes de jeunes du village avaient également un certain contrôle sur les choix de mariage et décourageaient ce qu'ils considéraient comme des mariages inappropriés.
Les mariages susceptibles d'être contestés étaient le plus souvent ceux dans lesquels il existait une grande différence d'âge ou dans lesquels l'une des parties était étrangère. En règle générale, même ces mariages seraient convenus si les deux parties souhaitaient sérieusement se marier. Dans les classes supérieures, la mariée était rarement enceinte au moment du mariage et les rituels de parade nuptiale étaient très formels. Des cadeaux traditionnels étaient échangés et l'homme devait assumer le rôle de « serviteur » auprès de la femme, qui était sa « maîtresse ». Ces termes faisaient simplement partie de la formalité de la cour et du mariage lui-même. Cependant, après le mariage, l'homme devenait le maître de la maison et la femme possédait généralement très peu de pouvoir.
La cour a conduit aux fiançailles. Les fiançailles étaient une étape importante dans le processus de mariage. Ce n'est que vers la fin du XVIIe qu'elle commence à perdre sa place centrale. Il s'agissait souvent d'une cérémonie formelle qui pouvait être célébrée devant un prêtre à la porte de l'église. Les fiançailles liaient le couple dans une relation qui ne pouvait être rompue que par consentement mutuel. Le consentement mutuel pour mettre fin aux fiançailles était un événement aussi public que les fiançailles elles-mêmes. La différence juridique entre fiançailles et mariage n’était pas facile à comprendre. Les avocats de l’Église ont longtemps lutté contre cette question. Dans la plupart des cas, les fiançailles aboutissaient directement au mariage après un intervalle d’un mois ou deux. Il y avait quelques exceptions. Par exemple, les fiançailles duraient parfois des années. Parfois, l'une des parties à des fiançailles informelles peut revenir sur sa parole.
Cependant, lors de fiançailles formelles, une partie peut refuser de les rompre à la demande de l'autre. Une femme enceinte pourrait insister sur le fait qu’elle était réellement mariée puisqu’elle était fiancée à l’homme avec qui elle avait conçu son enfant à naître. Le cas le plus difficile est peut-être celui dans lequel une femme a poursuivi en justice un homme qui, selon elle, avait promis de l'épouser. Les tribunaux devaient décider si des fiançailles avaient eu lieu. De tels cas étaient connus sous le nom de « mariages clandestins » et occupaient une grande partie du temps devant les tribunaux religieux. Au XVIe siècle, après la scission entre les églises catholique et protestante, les deux églises se sont davantage concentrées sur les vœux échangés lors du mariage. Mais les fiançailles restent une étape importante vers le mariage.
L’idée de se marier par amour était rarement la raison du mariage à la Renaissance. S'il existait probablement des couples romantiques comme Roméo et Juliette, le mariage était avant tout un arrangement commercial. Pendant des siècles, dans toutes les cultures du monde, le mariage était une décision de la famille. Le décideur était généralement le père, même si la mère avait généralement son mot à dire. La décision n’appartenait pas aux individus qui se mariaient. Les négociations de mariage entre familles peuvent s’étendre sur des semaines ou des mois. Ces négociations étaient de plus en plus compliquées entre les classes sociales supérieures. Les préoccupations les plus fréquemment évoquées lors de ces négociations concernaient la dot apportée par la mariée. Un autre point clé des négociations était la manière dont les biens du couple seraient répartis après le décès.
La dot était une offrande financière faite par les parents de la mariée ou du marié. La tradition est presque aussi ancienne que l’histoire elle-même. La famille de la mariée serait particulièrement soucieuse de son soutien financier en cas de décès du mari. La plupart des veuves dont le mari est décédé recevaient une contribution connue sous le nom de « dot » en Angleterre du côté du mari de la famille. Les détails étaient précisés dans un contrat. Si la mariée et sa famille ne concluaient pas d’accords spécifiques sur ces questions et que le mari décédait, les conséquences pourraient être graves. La mariée pourrait éventuellement devoir retourner chez ses parents et être soutenue par sa famille biologique. Pour ses parents, cela pourrait être une situation indésirable et économiquement difficile. Si les parents étaient décédés, la situation pourrait être tout aussi difficile pour les frères et sœurs survivants de la veuve, vers qui elle pourrait être obligée de se tourner pour obtenir du soutien.
Les cérémonies de mariage variaient considérablement. Certaines ont eu lieu à l'église. Le plus souvent, ils se trouvaient à la porte de l'église. Certains étaient détenus dans des maisons privées. Dans une grande partie de l'Italie, le « mariage » comportait tellement d'étapes qu'il est difficile de savoir avec certitude laquelle a réellement abouti à un mariage légal. Il s'agit peut-être de la comparution devant un notaire qui a enregistré ce dont il a été témoin. Chaque région avait sa propre version des mots traditionnellement prononcés. En général, le couple acceptait d'être mari et femme. Dans de nombreuses versions, le père de la mariée confiait sa fille à la garde du marié. Il y avait des symboles comme la bague et des gestes comme le baiser. Un geste courant était de serrer les mains. Ce geste était synonyme de mariage ou de fiançailles dans de nombreux endroits et ce depuis l'époque romaine et avant.
Jusqu'au milieu et à la fin du XVIe siècle, les conditions légales du mariage étaient une combinaison confuse de canons ou de lois de l'Église, de décrets de l'Église et de lois civiles locales. L’église est alors devenue un élément légal de la cérémonie de mariage. La plupart des villes et gouvernements protestants ont adopté des ordonnances exigeant qu'un mariage ait lieu dans une église reconnue en présence d'un ministre. De même, l'Église catholique a défini un mariage valide comme un mariage dans lequel le consentement a été échangé devant un prêtre et d'autres témoins. Il se peut que de tous les changements religieux de la période de la Réforme, ceux qui ont le plus affecté les gens ordinaires aient été les pratiques matrimoniales.
De nombreuses coutumes et celebrations de mariage dans l’Europe de la Renaissance sont restées inchangées aujourd’hui. Lorsqu'il y en avait un, la signature du contrat de mariage précédait ou suivait de près l'échange des vœux. Il y avait des processions vers ou depuis l'église. Des repas communs étaient organisés avec des plats traditionnels. Et il y avait des danses, de la musique et des chants. Toutes ces activités se déroulaient souvent en extérieur avec de nombreux participants. Aux niveaux sociaux supérieurs, on note une tendance vers des mariages plus privés et plus sobres. Les autorités ecclésiastiques étaient généralement favorables à l'élimination de tous les éléments païens ou non religieux d'un mariage. L’Église considérait celebrations de mariage comme une superstition. Les autorités protestantes ont notamment tenté d'interdire le bruit, la musique et la danse. Pourtant, l’Église catholique romaine désapprouvait depuis longtemps les mariages trop privés. Cela décourageait également les pratiques aristocratiques telles que les cérémonies de minuit dans les chapelles privées.
Les différences de classe dans l'Europe de la Renaissance en ce qui concerne les cérémonies et les coutumes de mariage se sont poursuivies. Cependant, les pratiques populaires les plus offensantes pour les responsables de l’Église ont progressivement disparu. Un petit nombre de couples se sont enfuis, se mariant à l'insu de leurs parents, l'incitation étant généralement la désapprobation parentale. Étant donné que l'Église catholique romaine n'a jamais exigé le consentement des parents, une fugue était acceptable au sens religieux et juridique. Pourtant, elle était souvent méprisée dans la société. De nombreuses ordonnances protestantes exigeaient le consentement des parents. Cela était particulièrement vrai pour les personnes inférieures à un certain âge. Même si les réglementations devenaient plus strictes, il y avait toujours des couples qui parvenaient à les éviter.
Selon la vision commune de la vie conjugale qui prévalait dans l’Europe de la Renaissance, le mari était supérieur à la femme. Après la période de cour pendant laquelle le prétendant était le serviteur de la femme, l'homme devenait le maître de la maison au moment du mariage. Les femmes avaient peu de droits légaux. Les spécialistes s’accordent cependant généralement sur le fait que les femmes étaient généralement bien traitées et bénéficiaient d’un certain degré d’égalité avec leurs maris. Un homme peut avoir eu autorité sur sa femme. Mais il devait également subvenir à ses besoins, la protéger et la traiter avec gentillesse. Il avait également la responsabilité de veiller à ce qu'elle soit prise en charge en cas de décès.
De plus, les relations individuelles créaient différents types de mariages. Si un homme était beaucoup plus âgé que sa femme, les inégalités tendaient à être plus grandes. C'était le cas dans de nombreux mariages de la classe supérieure. Dans les classes inférieures, l’écart d’âge était probablement moindre. En général, le mari et la femme travaillaient tous deux comme domestiques avant de se marier. Ils avaient donc une base pour une relation. En pratique, de nombreux mariages étaient des partenariats économiques. Les épouses rurales en particulier effectuaient un travail domestique et sur la terre qui complétait le travail de leur mari. Les hommes dépendaient souvent plus du jugement et des capacités de leur femme qu'ils ne pourraient l'admettre. Certains hommes lettrés de la classe supérieure exprimaient leur admiration pour leurs femmes. Plus d'un mari a avoué être perdu dans les affaires du ménage après le décès de sa femme. Les testaments des maris donnaient aussi souvent un pouvoir considérable à leurs veuves.
L’amour n’était généralement pas considéré comme une base appropriée pour le mariage. Cependant, il était tout à fait naturel que des sentiments se développent entre une femme et un homme une fois mariés. Quelles que soient les circonstances qui ont conduit au mariage, le mari et la femme ont ensuite vécu ensemble et partagé les responsabilités. Leur relation mutuelle en venait souvent à inclure l’amour et l’affection. De nombreux couples travaillaient ensemble, étaient des parents actifs et étaient également compagnons de lit. Le plaisir sexuel était un aspect important du mariage. Mais les conventions sociales et religieuses imposaient de le maintenir dans certaines limites. Les maris et les femmes étaient censés se satisfaire sexuellement, ce qu'on appelle la « dette conjugale ». Parfois, des cas étaient portés devant les tribunaux ecclésiastiques par des époux qui se plaignaient du non-paiement de la dette.
À l’époque de la Renaissance et de la Réforme, l’homme était considéré comme le maître de maison. Une femme était donc soumise à son mari, et les lois et coutumes religieuses soutenaient cette inégalité. Quelle que soit l’importance de la dot qu’une femme avait apportée à son mariage, le mari en assumait le contrôle. D'une manière générale, les épouses ne pouvaient agir pour elles-mêmes ni en droit ni en commerce. Cependant, il est important de noter que si cela était vrai pour les mariages chrétiens, cela ne l’était pas pour les mariages musulmans. Comme le montre le Coran, selon la loi islamique, les femmes gardaient leur dot et disposaient d'un plus grand contrôle économique que leurs sœurs chrétiennes. Bien entendu, l’islam n’était pas toléré dans la majeure partie de l’Europe. Cela était particulièrement vrai après les croisades du Moyen Âge. Et en Espagne surtout après les expulsions de musulmans et de juifs d’Espagne en 1492.
Les écrivains religieux de la Renaissance européenne ont averti que trop de relations sexuelles dans le mariage était tout aussi dangereuse que l'adultère. L'adultère était bien entendu défini comme le fait pour une personne mariée d'avoir une relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint. L'adultère était considéré comme un péché grave dans l'Europe de la Renaissance. Les maris et les femmes étaient capables de tromper leur conjoint. Mais l’infidélité d’une femme était considérée comme le plus grand des deux maux. Les lois laïques et civiles reflétaient cette attitude. Le double standard est devenu une partie importante de la culture chrétienne à cette époque. Les épouses des maris qui trichaient devaient endurer l'infidélité tant qu'elle se déroulait en privé. Cependant, les maris qui se laissaient trahir par leur femme étaient publiquement moqués et méprisés. L'une des pires insultes sociales était d'être traité de « cocu », terme péjoratif désignant un homme dont la femme est infidèle.
D’après toutes les indications historiques, les épouses étaient rarement infidèles. Les quelques coupables furent sévèrement punis. L’improbabilité qu’une femme commette l’adultère n’empêche pas la jalousie masculine d’être l’un des thèmes les plus courants de la littérature de la Renaissance. La plupart des mariages ne prenaient fin qu’au décès de l’un des partenaires. Pourtant, les mariages duraient rarement longtemps en raison du taux de mortalité très élevé. Il n’était pas rare que des hommes mariés à la fin de la vingtaine meurent avant la quarantaine. De nombreuses femmes meurent en couches après seulement quelques années de mariage. Certains couples se sont séparés avant la mort. Le divorce n'était pas une véritable option, même si certaines juridictions protestantes l'autorisaient. L'Église catholique a autorisé la séparation légale (« divorce »). La plupart des autorités protestantes préféraient la séparation au divorce pur et simple. Bien entendu, en cas de divorce, le remariage était autorisé.
Le motif habituel de séparation était l’adultère. Peu de gens croyaient qu’une personne ayant commis un adultère devait se remarier. Parmi les autres motifs figuraient les abus. Cependant, il n’était pas facile pour les gens ordinaires d’obtenir une séparation permanente. Les gens au pouvoir avaient plus d’options. Cela était particulièrement évident lorsque la politique semblait exiger une nouvelle alliance matrimoniale. Dans ces circonstances, un dirigeant pourrait demander l’annulation. Une annulation a déclaré qu'un mariage légal n'avait jamais existé. L'annulation était souvent accordée pour divers motifs. Parmi eux figurait le manque de consentement de la part d’une partie. Un autre motif était le manque de liberté de se marier en premier lieu en raison des liens de sang entre les époux.
Cependant, l'annulation d'un mariage qui existait déjà depuis plusieurs années et qui avait donné naissance à des enfants était toujours un problème. L'annulation la plus célèbre de cette période fut le « divorce » d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, roi et reine d'Angleterre. Lorsque le pape n'a pas accédé à la demande d'annulation d'Henri, celui-ci s'est séparé de l'Église catholique et a fondé l'Église d'Angleterre. La séparation entre les Églises s'est avérée permanente. Certains mariages de personnes de moindre importance étaient annulés assez facilement. Cela était généralement dû au fait que le mariage n'avait jamais été « consommé », c'est-à-dire que le couple n'avait pas eu de relations sexuelles. Cependant, dans l’ensemble, les gens avaient tendance à rester dans des mariages malheureux. Néanmoins, certains ont emprunté la voie la plus directe vers le divorce, la désertion.
C'étaient généralement des hommes qui désertaient. Une femme se retrouvait dans la situation d’une femme qui avait perdu son mari mais qui était toujours mariée et incapable de se remarier. Le manque de communication entre les différentes régions permettait au mari d'aller ailleurs et de se remarier sans que sa femme ne le sache. Parfois cependant, on découvrait effectivement que l'une des parties était mariée à deux personnes. Dans ces circonstances, le mariage ultérieur a été annulé et le conjoint fautif a été sévèrement puni. La manière normale de considérer le mariage était qu’il s’agissait d’une union de jeunes qui n’avaient jamais été mariés auparavant. Pourtant, de nombreuses personnes se sont mariées pour la deuxième ou la troisième fois en raison du décès d’un précédent mariage.
Les estimations basées sur des documents historiques indiquent qu'environ 20 pour cent de la population a été mariée plus d'une fois. Un homme dont la femme est décédée, c'est-à-dire un « veuf », était susceptible de se remarier après un intervalle assez court. Une femme dont le mari est décédé, c'est-à-dire une « veuve », était un peu moins susceptible de se remarier. Toutefois, la probabilité de se remarier ou non dépend dans une large mesure de l'âge et des circonstances. Les familles étaient souvent désireuses d’utiliser les jeunes veuves pour former de nouvelles alliances souhaitables. D’un autre côté, de nombreuses veuves plus mûres s’accrochaient à une autonomie dont elles n’avaient jamais bénéficié auparavant dans leur vie de famille ou de dépendance de leurs parents. Les seconds mariages étaient généralement beaucoup moins festifs. En fait, les cérémonies de mariage elles-mêmes éliminaient même certaines paroles solennelles. Les seconds mariages étaient également souvent la source de moqueries sociales, notamment en France.
La naissance et l'enfance étaient évidemment communes à tous à la Renaissance. Cependant, les historiens disposent de très peu d’informations de première main. Les femmes n’écrivaient tout simplement pas sur le sujet et les hommes étaient rarement témoins. Des sources jusqu’alors inexploitées, telles que les registres paroissiaux et les sépultures, ont récemment fourni des informations précieuses sur les expériences des gens ordinaires. Ce qui est clair, c’est que la naissance et l’enfance étaient pleines de dangers, surtout pour l’enfant. L’accompagnatrice la plus importante lors d’un accouchement était la sage-femme. La sage-femme a aidé à l'accouchement.
Les sages-femmes appartenaient généralement à un rang social proche de celui de la mère et étaient généralement des femmes plus âgées qui avaient déjà donné naissance à plusieurs enfants. Leurs compétences étaient grandement respectées, même par les médecins. Une apprentie sage-femme était formée par une sage-femme en exercice. Cela n'était pas sensiblement différent du processus axé sur les hommes par lequel les maîtres formaient des apprentis, c'est-à-dire des jeunes hommes qui apprenaient un métier auprès d'un artisan. La sage-femme la plus expérimentée transmettait son savoir à la sage-femme « stagiaire ». Cela n'empêche pas les sages-femmes d'être souvent la cible de soupçons des hommes concernant des activités secrètes impliquant des femmes. On les craignait parfois en tant que sorcières susceptibles de donner l'âme de l'enfant au diable avant que l'enfant ne puisse être baptisé. Le baptême impliquait bien sûr l'initiation à la religion chrétienne en étant oint d'eau par un prêtre.
Les techniques de base des sages-femmes semblent avoir bien fonctionné lors de la plupart des accouchements. La femme en travail était encouragée à s'asseoir et à appuyer pour faciliter le passage du bébé dans le canal génital. Ceci était souvent réalisé à l’aide d’une chaise d’accouchement. Certaines naissances problématiques ont été gérées efficacement. Les sages-femmes savaient comment retourner les nourrissons mal positionnés. Les complications qui ne pouvaient être traitées qu'à l'aide d'instruments nécessitaient l'intervention d'un chirurgien. Malheureusement, cela signifiait généralement que l'enfant ne survivrait pas. Si le canal génital était bloqué, un chirurgien utilisait des crochets et des couteaux pour retirer le nourrisson en morceaux. Les césariennes étaient rares, impliquant le retrait d'un enfant de l'utérus en pratiquant une incision dans l'abdomen de la mère. Celles-ci n'étaient pratiquées que si la mère décédait et qu'il y avait une chance de sauver l'enfant.
Les femmes accouchaient en compagnie de nombreuses femmes. C'était l'occasion de réunir parents et voisins. Leur présence visait à la fois à apporter aide et réconfort, mais constituait également un événement social. Cette coutume s'étendait à travers la géographie et la classe sociale. Même les médecins étaient généralement exclus du processus d’accouchement. Ainsi, leur connaissance de l’accouchement était principalement tirée de livres plutôt que d’observations. Même s’il était généralement interdit aux hommes de participer à l’accouchement, les peintres masculins représentaient fréquemment des scènes de naissance. Généralement, le tableau ferait partie d'un cycle relatif à la vie des saints. Un cycle ou une série de peintures couvrirait la naissance, la vie, les miracles et la mort d'une figure sainte.
Ces peintures ne peuvent pas nécessairement être considérées comme entièrement exactes. Cependant, ils témoignent de la présence de nombreuses femmes assistant à l'accouchement. Bien que les hommes n'aient pas assisté à l'accouchement, de nombreux médecins ont tenté d'améliorer la sécurité du processus. Le premier ouvrage médical sur l’accouchement écrit depuis l’Antiquité était un manuel destiné aux femmes enceintes et aux sages-femmes. Il a été écrit par le médecin allemand Eucharius Rosslin et publié pour la première fois en 1513. Il a été imprimé en Angleterre trois décennies plus tard sous le titre « The Burth of Mankynde ». L'ouvrage fut traduit dans d'autres langues et réédité à plusieurs reprises jusqu'à la fin du XVIIe siècle. L'objectif de Rosslin était de combiner les connaissances médicales tirées de l'Antiquité classique avec ce qu'il était capable de déduire des méthodes des sages-femmes. Son objectif était d’améliorer le processus d’accouchement et non de remplacer les sages-femmes.
L’émergence des sages-femmes et/ou obstétriciens masculins est arrivée beaucoup plus tard. Le danger de mort en couches pour la mère était grand. Néanmoins, la plupart des femmes ont survécu et ont accouché à plusieurs reprises. Néanmoins, de nombreux écrivains, pour la plupart des hommes, ont exprimé leur peur de l'accouchement. Ils parlaient de maladies, de douleurs, de tourments, voire de « douleurs de l'enfer » et de « pièges de la mort ». La principale cause de décès infantile était probablement une infection. C'était généralement la conséquence de l'insertion d'une main ou d'un instrument dans le canal génital. Par exemple, une sage-femme pourrait tenter de retirer un placenta qui n’a pas été expulsé. Le placenta est un organe qui relie le fœtus à l'utérus de la mère. Ce type de contact est probablement à l’origine de la plupart des cas de maladies et de décès post-partum. Dans de tels cas, une femme ayant accouché apparemment normalement pourrait développer une fièvre prolongée. La mort survenait généralement dans un délai d’un mois.
L’aliment normal des nouveau-nés était le lait maternel. La plupart des mères allaitaient leur bébé. Cela était particulièrement vrai pour les classes socio-économiques inférieures. Quelques bébés des classes inférieures ne pouvaient pas être allaités par leur mère. Peut-être que leurs mères étaient décédées ou étaient malades. Certains nourrissons étaient ensuite nourris avec du lait animal ou du blé. Quelle bouillie était une substance liquide composée de grains de blé et d'eau ou de lait. Cependant, l'allaitement maternel par la mère a reçu l'approbation enthousiaste des autorités respectées. Le corps médical l'a recommandé. Le clergé y était fortement favorable. Parmi tant d’autres, le théologien italien du XVe siècle, saint Bernadin de Sienne, prêchait contre les femmes qui négligeaient leur devoir d’allaiter. Sa condamnation présumait que cette négligence était en faveur d'un comportement pécheur, tel que la vanité et la sensualité.
C'étaient des thèmes communs dans de nombreux sermons de l'époque. L'image de la Madone allaitante est devenue un thème central de l'art de la Renaissance. Il s’agissait de représentations de la « Vierge » Marie allaitant Jésus de Nazareth. Malgré l'approbation massive de l'allaitement maternel, de nombreuses mères des classes socio-économiques supérieures ont embauché des nourrices pour allaiter leurs bébés. La nourrice était une activité florissante et constitue peut-être en fait la partie la mieux documentée de l’enfance à la Renaissance. La nourrice typique était une paysanne mariée dont le propre enfant était décédé. Si son enfant n'était pas mort, elle pourrait décider de le allaiter avec un autre bébé. Toutefois, un tel arrangement était une situation hautement improbable et indésirable.
Les nourrices restaient généralement chez elles. Par conséquent, il arrivait fréquemment qu'un nourrisson soit envoyé vivre dans une maison étrangère avec sa nourrice. Bien entendu, cette maison était le plus souvent beaucoup plus modeste que celle de ses parents. Quelques familles exceptionnellement riches gardaient au moins certains de leurs enfants à la maison avec une nourrice vivant avec la famille. Cet arrangement serait le plus souvent destiné à la progéniture mâle et non femelle. Dans les deux cas, cet arrangement garantissait que le nourrisson recevrait toute l'attention de l'infirmière. Vraisemblablement, le nourrisson serait alors mieux reposé et bien nourri.
La société de la Renaissance a exprimé des sentiments mitigés à l'égard de la nourrice. Les auteurs qui recommandaient aux mères d'allaiter leur propre bébé donnaient également des conseils sur la manière de sélectionner les nourrices. Les raisons du recours aux nourrices étaient assez complexes. Les moralistes chrétiens pensaient que les nourrices pouvaient empêcher l'infidélité conjugale du mari. Le fait que le mari ait des relations sexuelles avec une autre personne que sa femme représente un risque réel. En effet, dans l’Europe de la Renaissance, il était largement admis que les mères qui allaitaient n’étaient pas censées être sexuellement actives. La perspective de relations sexuelles ininterrompues comme bénéfice indirect de l’emploi d’une nourrice séduisait les couples. Mais naturellement, cela signifiait aussi que les femmes tombaient enceintes plus souvent.
Bien que cela soit rarement exprimé ouvertement, il semble y avoir eu le sentiment qu'une femme qui allaitait était réduite à un statut de sous-humain. Même si l’allaitement était acceptable pour les femmes ordinaires, il n’était pas approprié pour les femmes de statut supérieur. Bien entendu, les femmes des classes socio-économiques inférieures ne pouvaient de toute façon pas se permettre d’avoir recours à des nourrices. On ne sait pas si ces idées étaient consciemment largement ou même universellement partagées par tous les membres des classes privilégiées. Mais les documents historiques montrent clairement qu’ils évitaient systématiquement d’avoir à traiter de telles questions.
De nombreuses femmes de la classe supérieure avaient des sentiments mitigés quant à l’embauche d’une nourrice. La pratique consistant à employer une nourrice semblait contraster fortement avec les images artistiques montrant la Vierge Marie allaitant l'enfant Jésus. Il existe également d’autres sources d’ambivalence. On pensait que le lait était porteur de traits de caractère et de personnalité. Il s’ensuit donc que le caractère et la personnalité d’un bébé sont formés autant par le lait maternel que par l’environnement de l’utérus. L'artiste italien du XVIe siècle Michel-Ange a plaisanté en disant qu'il était devenu sculpteur parce que sa nourrice était la femme d'un tailleur de pierre. Les classes sociales supérieures pensaient bien sûr qu'un bébé pouvait adopter des caractéristiques indésirables de la part d'une nourrice paysanne.
Le commerce des nourrices fonctionnait à peu près de la même manière dans toute l’Europe occidentale. Le père a choisi l'infirmière et a passé un contrat avec son mari, qui a reçu des paiements réguliers. Certaines villes disposent de registres d'infirmières, dans lesquels les nourrices s'inscrivent en tant que prestataires de services. Les registres pourraient être gérés soit par des intérêts privés, soit sous le contrôle du gouvernement. Le registre le plus connu a été fondé à Paris avant 1350. Comme un père prudent, un registre était censé vérifier que les nourrices étaient de bonne moralité et avaient des dispositions agréables. Leur lait a été testé et jugé quant à son épaisseur, sa couleur et son goût. L'une des fonctions des registres était de fournir des nourrices aux enfants trouvés, c'est-à-dire aux bébés abandonnés et aux orphelins confiés aux soins d'institutions religieuses ou de municipalités.
La vie était précaire pour les nouveau-nés. Le taux de mortalité infantile est resté plus ou moins constant tout au long de la Renaissance. Entre 20 et 40 pour cent de tous les bébés meurent avant leur premier anniversaire. S’ils parvenaient à atteindre leur premier anniversaire, ils n’avaient encore que 50 pour cent de chances de survivre au-delà de l’âge de dix ans. Ces chiffres s'appliquaient à toutes les classes. La principale raison de cette tragédie généralisée était simplement due au fait que les nourrissons avaient des difficultés à lutter contre la maladie. De plus, les systèmes digestif et respiratoire des nourrissons sont moins capables de résister aux risques environnementaux tels que les conditions météorologiques extrêmes et l'eau impure. La pauvreté ajoute encore plus de dangers, comme la malnutrition des mères qui allaitent.
Les orphelins pauvres étaient exposés aux pires dangers dans les maisons bondées de nourrices surmenées et inattentives. Même les meilleures conditions de vie des riches ne pouvaient empêcher les dangers écrasants des maladies infantiles. Il est difficile de déterminer comment les nourrissons ont été traités. Certains experts estiment que le taux de mortalité élevé est dû au fait que les parents n’investissent que peu ou pas d’émotions dans leurs enfants. D'autres affirment qu'il est difficile de savoir ce que ressentaient spécifiquement les parents, car les documents historiques donnent peu d'indications sur les sentiments personnels des parents en deuil. De nombreux enfants ont certainement été comblés d’amour et d’attention. Il ne fait aucun doute que les parents étaient accablés par le chagrin en cas de décès. Ce qui reste de l’histoire, c’est ce que ressentait la mère. Cela est dû au manque de témoignages de première main sur la vie des femmes.
Les gens de la Renaissance européenne semblent avoir accepté dans une large mesure le caractère inévitable de la mort infantile fréquente. Certaines familles ont même réutilisé le nom d’un enfant mort pour un autre enfant. La tendresse montrée dans les images artistiques de l'enfant Jésus aurait pu refléter une attitude envers les bébés en général. On souhaitait beaucoup qu'un bébé soit baptisé le plus tôt possible. Cela a été fait pour éviter le risque que son âme reste dans les limbes ou au purgatoire pour l'éternité si elle mourait prématurément sans être baptisée.
Peu de temps après sa naissance, un bébé était enveloppé dans des langes. Il s’agissait d’un arrangement complexe de tissus enveloppés qui maintenaient les bras et les jambes droits et le corps au chaud. Il était également facile à manipuler, un peu comme transporter une grosse miche de pain emballée. Pour la plupart des enfants, les langes étaient changés de temps en temps. Cependant, les bébés changeaient beaucoup plus fréquemment leurs langes sous la garde d'infirmières résidantes dans les foyers aisés. L'allaitement durait au moins un an, parfois plus de deux ans. L'aliment préféré pour le sevrage était un mélange de blé blanc fin et d'eau. Ce mélange a été donné à l'enfant avec une cuillère jusqu'au moment où l'enfant a commencé à suivre un régime alimentaire normal pour adultes.
La surveillance des nourrissons n’était pas aussi concentrée qu’elle l’est aujourd’hui. La plupart des enfants vivaient dans de petites maisons et étaient placés dans des berceaux près du feu. Jusqu'à ce qu'ils puissent se déplacer seuls, c'est là que se trouvaient généralement les nourrissons de la maison. La mère, une servante ou un enfant plus âgé gardait un œil sur le bébé tout en vaquant à d'autres tâches. Les nourrissons emmaillotés étaient souvent victimes d'accidents mortels. Ils ont été brûlés après avoir été placés trop près de feux non surveillés. Ils étaient parfois étouffés lorsqu'ils dormaient dans de grands lits avec des adultes. Les pauvres dormaient souvent dans le même lit que leurs nourrissons, par souci de commodité et de chaleur. Dans les documents historiques, la « superposition » était souvent citée comme une cause de décès infantile. « Superposition » était le terme utilisé pour décrire les personnes se tournant vers des bébés.
Dans les grandes maisons, il y avait généralement des domestiques pour s'occuper des enfants. Riche ou pauvre, aucun document historique ne suggère que le foyer était centré sur l'enfant. Les enfants les plus riches étaient mieux nourris et plus en sécurité, mais ils n'étaient plus visibles. Les enfants des riches comme des pauvres passaient la plupart de leur temps dans un monde de femmes dans lequel les hommes n’avaient que peu de relations. Les enfants les plus pauvres étaient probablement soumis à moins de contrôle et de surveillance. Qu'ils soient riches ou pauvres, une fois débarrassés de leurs langes, les bébés n'étaient pas encouragés à ramper librement. Une fois que les tout-petits savaient marcher, ils n'étaient pas non plus encouragés à le faire sans walkers ni ficelles, semblables à des laisses. Les enfants laissés sans surveillance et capables de marcher pourraient se renverser et être brûlés par des liquides bouillants, tomber dans des fossés ou être attaqués par des animaux.
La vie des enfants de la Renaissance n’est entrée dans les archives historiques que lorsqu’ils étaient plus âgés. Même dans ce cas, les descriptions survivantes de la vie des enfants concernent généralement des garçons et non des filles. Il nous est donc presque impossible d’en savoir beaucoup sur leurs premiers stades de vie. Les enfants étaient importants avant tout parce qu’ils étaient nombreux. À la Renaissance, plus de la moitié de la population avait moins de vingt-cinq ans. Il s’agit là d’une répartition par âge qui n’est pas sans rappeler celle de nombreux pays en développement aux XXe et XXIe siècles. Les enfants étaient aussi l’instrument d’un des principes organisateurs fondamentaux de la société de la Renaissance : l’héritage. Les jeunes sont souvent traités de manière contradictoire. On attendait d’eux qu’ils soient obéissants et respectueux. Cependant, une fois qu'ils ont survécu à l'enfance, la difficulté de dompter leur rébellion et de les transformer en êtres moraux s'est avérée un défi constant.
On pensait généralement que « l’enfance » dans l’Europe de la Renaissance commençait à sept ans et se terminait à quatorze ans. Les enfants de moins de sept ans étaient considérés comme étant au stade connu sous le nom de « petite enfance ». En tant qu'enfants, ils appartenaient au monde des femmes. Dès l'âge de sept ans, les enfants étaient considérés comme capables d'être instruits. Dans certains pays, les lois considèrent que les enfants de moins de quatorze ans sont capables de commettre des crimes contre les adultes. La confirmation et la première communion avaient lieu entre sept et quatorze ans. La confirmation était la cérémonie religieuse conférant symboliquement le don du Saint-Esprit. La première communion était la première participation à la cérémonie religieuse au cours de laquelle les participants prenaient du pain et du vin. Le pain et le vin symbolisent bien sûr le corps et le sang du Christ.
De nombreux enfants ont commencé à travailler avant l'âge de quatorze ans. Certains garçons ont été légalement déclarés « émancipés », c'est-à-dire libérés du contrôle parental, dès l'âge de neuf ans. Certains garçons étaient même obligés de porter les armes en temps de guerre, à un âge encore plus jeune. Les historiens ne sont pas d’accord sur l’expérience de l’enfance à cette période. À l’époque, on pensait qu’il fallait contrôler étroitement les enfants pour les empêcher d’agir selon leurs impulsions. Les moralistes de la Renaissance affirmaient qu'il fallait de grands efforts pour apprivoiser la sauvagerie des enfants. La sauvagerie qu'ils croyaient provenait du péché originel, c'est-à-dire de la condition humaine d'être pécheur à la naissance. S'occuper des enfants était considéré comme une bataille de volontés. La seule issue acceptable dans cette bataille était la capitulation de l’enfant devant l’autorité.
Les enfants ont également besoin d’être protégés contre les forces du mal. Le mal, c'est-à-dire l'œuvre du diable, était étroitement associé à la sexualité. Certains chercheurs contemporains notent que les enfants n'étaient pas protégés contre l'exposition à un langage grossier et blasphématoire, ni au jeu et à la consommation excessive d'alcool. Un tel comportement était impossible à éviter dans la vie ordinaire du village et de la ville et dans la plupart des maisons. Malgré cet environnement, l’activité sexuelle hors mariage était considérée comme le comportement le plus coupable. Hormis le foyer, la plupart des institutions destinées aux enfants étaient séparées selon le sexe.
Même s'il existe de nombreuses variantes selon la classe sociale de la famille d'un enfant, le jeu fait partie de l'enfance à tous les niveaux sociaux. Les quelques jouets qui ont survécu ressemblent beaucoup aux balles, bâtons, cerceaux, poupées et billes des temps ultérieurs. Il y avait des références occasionnelles aux jeux dans les écrits historiques, et il est peu probable que les enfants jouaient seuls. Les enfants des pauvres qui vivaient dans de très petites maisons jouaient probablement la plupart de leur temps à l'extérieur. Certains experts contemporains ont affirmé que les enfants étaient élevés dans des foyers où ils recevaient peu d’amour et d’attention. Au contraire, de nombreux écrivains de la Renaissance conseillaient fréquemment aux parents de cesser de gâter leurs enfants. On pensait que les enfants devaient être élevés de manière disciplinée et contrôlée.
Il était communément admis que les classes inférieures étaient les plus susceptibles de gâter les enfants avec amour et attention. Néanmoins, un éminent humaniste anglais du XVIe siècle constitue un exemple de personne cultivée admettant dans ses écrits aimer tendrement ses enfants. Mais d’un autre côté, de nombreux enfants étaient sans mère, sans père ou complètement orphelins. Les proches ont accueilli les orphelins chez eux, parfois même s'ils ne le voulaient pas. On ne sait toujours pas si la vie des orphelins était plus difficile que celle des autres enfants. Les enfants les plus démunis étaient ceux qui étaient abandonnés et élevés dans des foyers pour enfants trouvés. Certaines de ces maisons étaient gérées par des ordres religieux, tandis que d'autres étaient sous le contrôle du gouvernement local.
Une formation sérieuse commençait vers l’âge de sept ans et se déroulait généralement au sein d’un foyer. Les enfants des paysans des deux sexes ont commencé à aider à la maison avant même l’âge de sept ans. Une des premières formes de travail consistait à s'occuper des jeunes enfants. Dans les ménages aisés, les enfants passaient souvent des nourrices aux mains de gouvernantes et de tuteurs. Les gouvernantes étaient des femmes engagées pour s'occuper des enfants. Les tuteurs étaient généralement des enseignants de sexe masculin. Comme dans les ménages paysans, la formation dans les ménages riches était déterminée par les différences entre les sexes. Les filles ont appris des travaux d’aiguille et des compétences de base en matière de gestion du ménage. Les garçons apprenaient l'équitation et la chasse. En fonction des différences régionales, à l'âge de cinq, six ou sept ans, certains garçons et filles ont commencé une scolarité formelle. Cela peut prendre la forme d’un enseignement à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer. La forme de l'enseignement, qu'il soit en latin ou dans une langue maternelle, et l'étendue de l'éducation dépendaient d'un certain nombre de variables. Ces variables pourraient inclure le statut économique et social de la famille, le sexe de l'élève, les attentes des parents et la disponibilité de la scolarité.
Dans le nord-ouest de l’Europe, les enfants des zones urbaines et rurales quittaient généralement la maison. Les enfants des paysans des deux sexes allaient souvent vivre dans d'autres ménages paysans. Parfois, ils étaient envoyés dans de grandes maisons de campagne ou dans des maisons urbaines plus aisées. Certains enfants sont devenus apprentis chez des artisans. S'ils appartenaient au rang social approprié, d'autres devenaient apprentis chez des marchands de professionnels comme des médecins et des avocats. Aux niveaux sociaux les plus élevés, les enfants entraient dans les maisons des grands nobles ou des princes. Il n’y avait pas d’âge fixé pour que les enfants quittent la maison. La durée du temps passé hors du domicile dépend de divers facteurs. Les enfants des paysans pourraient revenir après un an ou deux. Ensuite, ils pourraient passer du temps à travailler à la maison, puis repartir.
Les apprentissages duraient généralement plusieurs années et impliquaient généralement une séparation permanente du foyer. Les personnes qui accueillaient des enfants assumaient également le rôle éducatif et disciplinaire des parents des enfants. Les arrangements avec les maîtres artisans étaient généralement pris par les parents des enfants. Sous une forme ou une autre, cette expérience était courante de haut en bas de l’échelle sociale. En Italie, les familles des classes supérieures étaient moins susceptibles de renvoyer leurs enfants loin de chez eux. Même les apprentis artisans en Italie avaient tendance à travailler avec leur propre père ou avec des maîtres de la même ville. Cela a permis à l'enfant de continuer à vivre à la maison. Les enfants ont commencé à apprendre la religion dès leur plus jeune âge. Le plus souvent, cela provenait des femmes de leur vie. Les chefs de famille les plus nombreux dirigeaient régulièrement les prières du matin et du soir. Dans les foyers aisés, un aumônier dirigeait les prières.
La pression pour que la religion fasse partie de la routine domestique est devenue encore plus forte après la Réforme. Beaucoup pensaient que les histoires de la Bible devraient remplacer les contes fairy et les histoires traditionnelles habituellement racontées aux enfants. Les conseillers humanistes des femmes estimaient que la lecture d'histoires détournait l'attention de la religion et de la moralité. Après la Réforme, la désapprobation des histoires basées sur la superstition s'est intensifiée tant chez les catholiques que chez les protestants. Cependant, cette critique n’a guère changé la tradition. Les parents se souviendraient de la façon dont les histoires les avaient émus ou même effrayés lorsqu'ils étaient enfants et les transmettraient à leurs propres enfants.
Il y avait de nombreux livres écrits sur le thème de la courtoisie et de l'étiquette, ou des bonnes manières. Ils donnent une idée du code de conduite élaboré attendu des nobles qui fréquentaient les cours des puissants. Ces livres s'adressaient aux jeunes garçons et soulignaient l'importance des bonnes manières et les compétences nécessaires pour servir un noble seigneur à table. Les fils et filles des gentilshommes apprenaient beaucoup à la cour. Ils ont également tissé des liens entre leurs familles et les familles qu'ils servaient et ont noué des contacts précieux pour leur propre carrière ultérieure. On pensait que les pères qui choisissaient de ne pas faire vivre cette expérience à leurs fils leur avaient rendu un très mauvais service.
Le passage de l'enfance à la jeunesse à la Renaissance est difficile à définir. Presque tout ce qui a été dit sur l’enfance concerne aussi la jeunesse. On attendait toujours des jeunes qu'ils respectent les aînés et obéissent à l'autorité. Malgré cela, les signes de maturité physique ont fait la différence. Ces signes semblent être généralement apparus assez tardivement, au-delà de l'âge conventionnel de quatorze ans. Les recherches suggèrent que cela était vrai non seulement pour les menstruations chez les filles, mais aussi pour le développement des changements de voix et de la pilosité faciale chez les garçons. La force, la santé et la beauté étaient des caractéristiques de la jeunesse louées et enviées. Les adultes ont tendance à être nostalgiques de leur propre jeunesse. Beaucoup s’en souviennent comme d’une période d’insouciance plutôt que d’obéissance et de travail acharné.
En réalité, la plupart des maîtres artisans faisaient réaliser à leurs apprentis des projets difficiles et de grande envergure sans les payer. Une autre caractéristique de la jeunesse était l'irresponsabilité. Sports et les jeux sont devenus plus turbulents. Cela était particulièrement vrai lorsque sports et les jeux étaient combinés avec la boisson et les jeux de hasard. Bien entendu, la consommation d'alcool et le jeu étaient des activités spécifiquement interdites dans les contrats d'apprentissage. Des groupes de jeunes organisaient celebrations saisonnières, souvent selon la tradition. Les mêmes groupes surveillaient le comportement de cour de leurs membres. La cour était semblable aux fréquentations modernes. Cependant, dans l’Europe de la Renaissance, les « règles » et les coutumes étaient beaucoup plus élaborées. L'adhésion à ces groupes était généralement limitée aux hommes célibataires, ce qui était la définition de « jeunesse ».
Pour la plupart des gens des deux sexes, être serviteur était assimilé à la jeunesse. L’opinion conventionnelle était que les domestiques étaient à la fois jeunes et célibataires. S’ils n’avaient pas quitté la maison avant l’âge de quatorze ans, ils le feraient probablement peu de temps après. Surtout dans les zones rurales, la période de service peut durer de nombreuses années. Ces années de servitude consistaient généralement en une série de séjours relativement courts chez différents maîtres. Les serviteurs pouvaient se déplacer librement de village en village, de ville en ville. Les femmes, en particulier, ont quitté les foyers ruraux pour devenir servantes en milieu urbain. Les domestiques n'étaient pas indépendants mais étaient toujours contraints de dépendre de leurs employeurs. L'apprentissage des jeunes se poursuit parfois jusqu'à la vingtaine et constitue la forme de service aux règles les plus précises.
Les stéréotypes des apprentis reproduisaient les stéréotypes de la jeunesse en général. Ces stéréotypes incluaient le fait que les jeunes serviteurs étaient maltraités par leurs maîtres ou qu'ils étaient difficiles à contrôler. Appliqués à certains jeunes, les stéréotypes étaient sûrement vrais, mais pas pour la plupart. La fin de la jeunesse ne s'est produite qu'avec un changement de statut juridique. Il n’est pas surprenant que la jeunesse soit la période des fréquentations. La première entrée dans l’âge adulte était le mariage. Bien entendu, le mariage apportait un certain degré d’autonomie, ou d’indépendance. Cela coïncidait généralement avec la fin de l'apprentissage et d'autres types de services, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Les femmes n’ont cependant pas obtenu la même autonomie juridique. Elles sont passées de l'enfance au statut de servante, puis à la dépendance du statut d'épouse. Certains hommes ont choisi de ne pas se marier et sont passés de l’enfance à l’âge adulte dans une dépendance partielle dans les monastères. Les monastères étaient bien sûr des foyers religieux pour hommes. Certains hommes devenaient techniquement autonomes sans se marier si leur père choisissait de les émanciper. L’âge à lui seul ne définit pas l’âge adulte. Mais le mariage a certainement mis fin à l’enfance et à la jeunesse.
Les grandes lignes du régime Renaissance seraient familières à toute personne vivant aujourd’hui. Cependant, la manière dont les Européens de la Renaissance considéraient la nourriture et les boissons était très différente. Les modèles de jeûne et de festin étaient fixés par le calendrier chrétien. Bien entendu, jeûner signifiait s’abstenir de manger. Un système de médecine originaire des Grecs anciens a été adopté. Le système se concentrait sur les « humeurs », qui étaient des fluides corporels tels que le sang, la bile ou l'urine. Le système a informé les idées européennes de la Renaissance sur les aliments sains à manger. Le banquet était l’idéal courtois du dîner. D’un autre côté, les masses des classes inférieures mangeaient des repas simples et de la nourriture ordinaire.
Le pain était l’aliment le plus important de l’alimentation européenne pour toutes les classes sociales. Elle était au cœur de la religion chrétienne sous la forme de l'Eucharistie ou de la sainte communion. C'était aussi le principal produit agricole et un aliment de base de tous les repas. Les Européens les plus riches préféraient le pain fin fait de farine de blé soigneusement « boulonnée » ou tamisée. Du pain brun moins raffiné contenant plus de son et comprenant parfois de l'orge ou du seigle était consommé par les classes inférieures. En période de pénurie de blé, des haricots ou des châtaignes peuvent également être mélangés au pain brun. Avant l'utilisation d'assiettes individuelles, le pain servait généralement de plateau pour contenir d'autres aliments.
Les céréales cuites étaient également au cœur de l’alimentation. Ils étaient plus faciles et moins chers à préparer que le pain car ils ne nécessitaient pas de four. Dans le sud, diverses formes de bouillie étaient préparées à partir d'orge ou de millet cuit. Le millet était un type d’herbe contenant de très petites graines utilisées comme céréale. Dans le Nord, la farine d'avoine ou d'épeautre était utilisée pour faire du porridge. L'épeautre était une variété de blé. Les personnes vivant dans une extrême pauvreté utilisaient des vesces ou des lupins pour préparer du porridge. Les letches étaient des plantes roselières qui pouvaient être cueillies à l'état sauvage. C'est une légumineuse, un peu comme la luzerne. Les lupins étaient un type similaire d’herbe à fleurs faisant partie de la famille des légumineuses. Le riz n’était pas un ingrédient très courant dans la bouillie car il n’avait été introduit que relativement récemment dans l’alimentation européenne.
La boisson la plus répandue dans le sud de l’Europe était le vin. Des régions entières étaient consacrées à la production et au commerce du vin. Les monastères entretenaient bon nombre des vignobles les plus anciens. Les moines produisaient du vin destiné à la messe catholique. La majorité des vins étaient fabriqués et consommés localement. Cependant, il existait un important commerce d'exportation en provenance de régions comme Bordeaux, dans le sud de la France. Plusieurs types coûteux de vins doux ont également été importés. Un vin populaire a été importé de Crète, une île méditerranéenne au large des côtes grecques. Un autre vin doux coûteux a été importé des îles de Madère dans l'Atlantique Nord, qui appartenaient au Portugal.
Des spiritueux plus forts tels que le brandy, le whisky et l'aqua vitae étaient également disponibles. L'aqua vitae était un liquide alcoolique destiné à des fins médicinales. En Europe du Nord, la bière ou la bière était la boisson la plus courante. De nombreux foyers d’Europe du Nord de l’époque de la Renaissance brassaient leur propre bière ou bière. Dans certaines régions, comme la Normandie en France et le sud-ouest de l'Angleterre, le cidre pressé à partir de pommes était la boisson habituelle. En Europe de l’Est, l’hydromel était fabriqué à partir de miel fermenté. L'hydromel est l'une des boissons alcoolisées originales les plus anciennes. L'eau était rarement consommée seule, probablement par crainte d'être contaminée. Cependant, la pratique consistant à mélanger de l’eau avec du vin était très répandue. La question de savoir si l’eau était destinée à diluer le vin ou si le vin était destiné à améliorer l’eau était un sujet de débat à la Renaissance.
La forme préférée de graisse constitue une autre distinction majeure entre les régimes alimentaires du sud et du nord de l’Europe à la Renaissance. L'huile d'olive dominait au sud et le beurre au nord. Cependant, comme il s’agit d’un produit animal, le beurre n’était pas censé être utilisé pendant le Carême. Le Carême est une période de quarante jours séparant le mercredi des Cendres et le dimanche de Pâques. Il était quarante ans jours de la semaine. Dans les deux cas, la période était celle pendant laquelle les chrétiens sont censés jeûner et prier. Il y a eu un effort conscient pour imposer l'utilisation de l'huile d'olive dans le nord pendant le Carême. Dans certaines régions, les graisses animales, comme celles du porc ou de l'oie, constituaient également un élément central de l'alimentation.
Les Européens de la Renaissance étaient uniques par rapport au reste des peuples du monde en raison de la quantité de viande et de poisson qu'ils consommaient. La population humaine relativement faible de l'Europe laissait suffisamment d'espace pour élever des troupeaux de bovins, de porcs, de chèvres et de moutons. La chair animale était consommée par toutes les classes. Comment il était consommé en plus grande variété et en plus grande quantité par les riches. Les ouvriers de la Flandre du XVIe siècle (aujourd'hui une région de Belgique) mangeaient du pain de seigle, des pois, des haricots et du hareng salé. Lorsque les pauvres mangeaient de la viande, celle-ci était généralement salée afin de la conserver. Le thon était également disponible. Les très pauvres pourraient survivre avec un régime de deux ou trois livres de pain par jour et rien d’autre.
Les riches mangeaient toutes sortes de viandes et de poissons. Et cela a été préparé de diverses manières ; rôti, grillé ou cuit au four. Les viandes étaient entassées sur des plaques métalliques appelées « mets » en France. Les convives se servaient alors eux-mêmes. Le dîner peut comprendre jusqu'à huit plats. Généralement, le dîner commençait par des viandes en bouillon et se terminait par des fruits. La présentation de la nourriture n'était importante que parmi les classes sociales supérieures et généralement uniquement lors d'occasions spéciales. Sinon, la quantité était plus importante que la présentation.
Les animaux domestiques les plus couramment élevés étaient les vaches, les moutons et les chèvres. Leur lait était utilisé pour fabriquer une grande variété de fromages frais et affinés. Lorsqu'ils étaient utilisés comme viande, ces animaux étaient généralement consommés jeunes comme le veau, l'agneau et le chevreau. Ils pourraient également être consommés à des âges plus avancés. Les porcs étaient importants dans toutes les régions d'Europe. La viande de porc était conservée toute l'année. La volaille domestique comprenait des poulets, des canards, des oies et des pigeons. La chasse au gibier sauvage était courante. Cependant le privilège de chasser le cerf pour le gibier ou le sanglier (cochon sauvage) pourrait être réservé à la noblesse. De petits oiseaux sauvages comme des tourterelles, mais aussi des lapins, des lièvres et même des hérissons étaient fréquemment servis.
Selon l'endroit, le poisson était également extrêmement important dans l'alimentation européenne. En Méditerranée, le long des côtes atlantiques et dans la région baltique, le poisson était soit consommé localement, soit conservé pour l'exportation. En Europe du Nord, le hareng et la morue faisaient partie des poissons conservés. Dans le sud de l’Europe, on préparait des anchois, des sardines et du bortago (ventre de thon salée). Ces produits étaient importants pendant le Carême lorsqu'ils étaient largement transportés à l'intérieur des terres. Les principaux réseaux fluviaux fournissaient du saumon et de la truite. Les étangs et les lacs offraient un approvisionnement constant en poisson à une communauté de l'intérieur des terres. La viande de baleine et le marsouin figuraient également parmi les aliments les plus chers et les plus « élégants ».
Les fruits et légumes faisaient partie intégrante de l’alimentation européenne. Néanmoins, ce qui est étonnant pour les diététiciens contemporains, c’est que les médecins mettent généralement en garde contre la consommation excessive de ces fruits et légumes. En général, plus une famille est pauvre, plus elle consomme de légumes en proportion et en quantité. Le XVIe siècle est une période de croissance économique. Cependant, l'inflation et la baisse des salaires réels ont resserré de plus en plus le budget du travailleur moyen. Cela a conduit les familles aux moyens économiques modestes à dépenser davantage d’argent pour acheter des aliments moins chers. Les céréales et les légumes sont devenus une partie centrale et parfois unique de l'alimentation. Ce changement signifiait que moins de viande était consommée. C’est peut-être la raison pour laquelle le régime alimentaire européen est devenu de plus en plus déficient.
Certains légumes étaient spécifiquement associés aux classes inférieures. Il s’agissait notamment de haricots, de choux, d’ail et d’oignons. Les fruits comme les pêches et les melons étaient en revanche très appréciés dans les cours européennes. Lorsqu'ils ajoutaient des épices à leurs préparations, les cuisiniers de la Renaissance dépendaient d'herbes indigènes telles que le persil, le basilic, l'origan, la marjolaine, la menthe, le thym, la sauge, l'estragon, le fenouil, l'aneth, le laurier, la coriandre, l'oseille, le safran et la moutarde. Il y avait également un commerce actif d'épices en provenance d'Asie et d'Afrique. La cuisine de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance faisait un usage libéral des épices. Les épices étaient chères car elles devaient être expédiées à travers l’Europe. Au cours du processus, ils ont été traités par de nombreux intermédiaires, chacun prenant une majoration. Au moment où les épices parvenaient au consommateur, elles étaient très coûteuses et devenaient donc un marqueur important de statut social. Plus on assaisonne un plat, plus il semble riche et impressionnant.
Le vieil adage selon lequel à cette époque les épices étaient utilisées pour masquer l’odeur de la viande rance n’a pas de sens. Quiconque pouvait s’offrir des épices pouvait également s’offrir de la viande fraîche. Outre les épices encore utilisées au XXIe siècle, il y en avait un certain nombre d’autres couramment importées dans l’Europe de la Renaissance. Les "Grains du Paradis" ou poivre melegueta ont été importés de la côte ouest de l'Afrique. Du moins, jusqu'à ce que les Portugais craignent que cela réduise leurs bénéfices en matière de poivre et en interdisent l'importation au XVIe siècle. L’importance des épices dans l’Europe de la Renaissance ne peut être surestimée. Il faut rappeler que l’explorateur italien Christophe Colomb du XVe siècle recherchait avant tout des épices lorsqu’il arriva en Amérique en 1492. Son intention n'était pas de découvrir un nouveau monde, mais une route plus directe vers l'une des principales sources d'épices d'Europe, l'Inde.
Le sucre était également largement utilisé comme épice pendant la Renaissance européenne. Le sucre a ensuite constitué l’épine dorsale de plusieurs économies esclavagistes du « Nouveau Monde », notamment dans les Caraïbes et au Brésil. « Nouveau Monde » était le terme européen désignant les Amériques. La tentative de trouver une route maritime directe vers l'Asie pour les épices a également incité les Portugais à voyager autour de la pointe sud de l'Afrique. Les Portugais ont finalement fondé des colonies en Inde, en Indonésie et en Chine pour assurer le commerce des épices. Les attitudes envers la nourriture dans la culture de la Renaissance étaient influencées par plusieurs traditions différentes. Certains régimes étaient basiques et simples. D'autres étaient extravagants et riches.
Pour l'Européen moyen à la Renaissance, les modèles de fête et de jeûne étaient déterminés par les saisons et les exigences du calendrier chrétien. Il y avait de nombreuses fêtes chrétiennes tout au long de l'année. De plus, des communautés individuelles pourraient également avoir célébré leurs propres saints patrons avec des festivals et des fêtes. Mais aucune célébration ne démontre mieux l’attitude de l’excès que le carnaval. Même l'origine du terme « carne-val », du latin « viande », laisse entrevoir ses excès. Généralement, cette fête était conçue comme un moyen de consommer toute la viande restante avant le Carême. Pendant le Carême, à l'exception du poisson, la consommation de viande était interdite. Les carnavals étaient un moyen de s'adonner à la nourriture, à la violence et au sexe. Le festival a culminé lors du Mardi Gras, ce qui est devenu connu sous le nom de mardi gras, ou mardi gras. C'était la veille du mercredi des Cendres, qui est le premier jour du Carême. Les celebrations du Mardi Gras comprenaient souvent une bataille mise en scène entre une grosse personnification du Carnaval portant des saucisses et une vieille femme mince armée de hareng. La vieille dame armée de harengs représentait bien sûr le Carême.
La plupart des produits alimentaires du « Nouveau Monde » n’ont été largement acceptés en Europe que longtemps après la Renaissance. Cependant, certaines cultures des Amériques ont été introduites avec succès dans l’Europe de la Renaissance. Ceux-ci ont fait leur première apparition en Europe après avoir été introduits par Christophe Colomb et les explorateurs ultérieurs. Ils comprenaient les tomates, les pommes de terre, le maïs (ou maïs), les poivrons, certains types de courges et de haricots, les dindes, le piment de la Jamaïque, le tabac et le chocolat. Toutes ces cultures sont originaires des Amériques. Dans de nombreux cas, ils étaient utilisés en combinaison avec d’autres aliments. Le maïs, par exemple, était généralement transformé en polenta, un type de bouillie de semoule de maïs. Les pommes de terre étaient transformées en boulettes. Cependant, dans une grande partie de l’Europe, ces aliments ont été délibérément évités. Les tomates ne se sont pas répandues en Europe pendant des siècles. De nombreux Européens pensaient que les légumes aqueux n’étaient pas destinés à la consommation humaine. Certains médecins pensaient également que le tabac était dangereux.
Les jeûnes officiels contrastaient fortement avec ces scènes. Le Carême s'étendait sur quarante jours, du mercredi des Cendres à Pâques. Avant le lapin de Pâques, c'était une commémoration de la résurrection du Christ ou de sa résurrection. Bien que ce ne soit pas la seule période, Pâques était la période la plus importante où la viande, le lait, le beurre et les œufs étaient interdits. On pouvait obtenir la permission d’enfreindre les règles, et cela se faisait apparemment assez régulièrement. Par exemple, la queue de castor et les macareux (un oiseau marin) ont été définis comme des produits de la pêche et donc adaptés au Carême. Sinon, la plupart des Européens ont survécu grâce au poisson et aux légumes pendant le Carême. Pour les classes supérieures, cela n’impliquait pas nécessairement de difficultés. Les poissons rares et exotiques ainsi que les variétés élaborées de fruits étaient courants parmi les riches. Bien sûr, cela nie essentiellement le but du Carême en tant que période de prière et d’expiation.
Les protestants n'observaient pas les rituels catholiques pendant le Carême. Néanmoins, certains dirigeants européens ont déclaré des périodes de mandat d'État. Au XVIe siècle, la reine Elizabeth I d'Angleterre a imposé la célébration du Carême afin d'éviter que l'offre de viande ne diminue et que son prix ne monte en flèche. La deuxième influence majeure sur les aliments européens à la Renaissance fut la théorie nutritionnelle. Les médecins de la Renaissance utilisaient un système hérité des Grecs et des Arabes. Ceci était basé sur ce qu’on appelait les quatre « humeurs » du corps. Selon cette théorie, la santé humaine dépend de l’équilibre des humeurs. Ces humeurs sont le sang, la bile noire, la bile jaune et les mucosités ou mucus. On pensait qu'un humour particulier dominait chez chaque individu et déterminait son teint ou son tempérament.
Ces influences prédominantes peuvent être résumées comme étant sanguines, ou joyeuses, qui étaient liées au sang. Les personnalités flegmatiques ou lentes seraient liées au flegme ou au mucus. Les personnalités mélancoliques ou tristes étaient liées à la bile noire. Les personnalités colériques ou colériques étaient, croyait-on, prédominées par l'humour biliaire jaune. Les experts en nutrition de Renaissance pensaient pouvoir classer chaque aliment en fonction de ses humeurs et de la manière dont ils pouvaient affecter l'individu. Les animaux et les plantes ont aussi leur propre teint. Même s’il y avait un large désaccord parmi les nutritionnistes sur la façon de classer certains aliments, la saveur était le facteur dominant.
Les aliments épicés, aromatiques et salés étaient tous classés comme chauds et secs. On pensait qu’ils augmentaient les humeurs chaudes et sèches ou colériques dans le corps. Ce régime était considéré comme un avantage pour les personnes présentant un excès d'humeurs flegmatiques, car l'alimentation agissait comme un contrepoids. Les aliments et condiments acides étaient considérés comme froids et secs. Ils étaient utilisés pour traiter les personnes présentant un excès de bile. Il est possible que de nombreuses combinaisons alimentaires populaires aient été conçues à l’origine dans cet esprit. Par exemple, le porc froid et moelleux pourrait être équilibré avec de la moutarde piquante et sèche. Les plats sucrés chauds et humides peuvent être équilibrés avec des condiments acides ou froids et secs.
Au-delà de leurs humeurs dominantes, les aliments individuels se voyaient également attribuer des propriétés spécifiques. Ces propriétés perçues comprenaient le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les passages du corps, de faciliter la digestion, de provoquer la transpiration et de favoriser le sommeil. Par conséquent, l’ordre d’un repas était considéré comme important. On croyait que certains aliments devaient précéder d’autres aliments. Par exemple, on pensait que les aliments qui pourrissent facilement, comme les melons et les concombres, ne devraient jamais reposer au sommet de l’estomac. Si ces aliments étaient consommés en dernier, on pensait qu’ils pourraient se détériorer avant d’être digérés. La liste des règles et des débats qui en découlent dans les milieux professionnels est interminable. De nombreuses directives diététiques ont été publiées à la Renaissance.
D’après les premiers livres de cuisine, l’alimentation du début de la Renaissance n’était pas très différente de celle des siècles précédents. Le seul changement majeur fut l’apparition de styles de cuisine nettement régionaux. Cela s’opposait au caractère plus international de la cuisine médiévale. Le premier livre de cuisine imprimé était « Dehonesta voluptate » ou « Du plaisir honorable ». Le livre a été imprimé en 1475 et son auteur était l'humaniste italien du XVe siècle Bartolomeo Sacchi, surnommé « Platina ». Le livre de recettes contenait des recettes empruntées à une compilation réalisée au Moyen Âge. Les recettes de Platina reflètent les influences médiévales. Ceux-ci comprenaient l’utilisation intensive d’épices et de sucre. Parmi les autres ingrédients uniques demandés figuraient le lait d'amande, l'eau de rose, les raisins réduits (« defrutum ») et le jus de raisins non mûrs (« verjus »).
Le travail de Platina contient également de nombreuses informations nutritionnelles et historiques. C'était le livre le plus vendu sur la nourriture à l'époque de la Renaissance. Il a été traduit du latin en italien, allemand et néerlandais. Une traduction française a connu des dizaines d'éditions tout au long du XVIe siècle. Le livre de cuisine le plus détaillé de la Renaissance était l'Opéra de Bartolomeo Scappi. Scappi était le chef du pape Pie V de 1566 à 1572. En tant que tel, Scappi avait accès aux derniers équipements de cuisine. Dans son livre, il y a des illustrations détaillées. Parmi les inventions les plus récentes au moment de la publication figurait la fourchette. Ses recettes se comptent par centaines. Ils témoignent de la période de transition au cours de laquelle la cuisine italienne de la Renaissance s'est éloignée de la cuisine médiévale. Les recettes de pâtes et de ragoûts sont similaires à celles d'aujourd'hui. Outre les livres de cuisine conçus pour un usage réel, plusieurs autres livres sur l’alimentation sont devenus populaires. Des livres sur les habitudes alimentaires des anciens Grecs et Romains, ainsi que des guides sur la gestion de la cuisine et la sculpture, sont également devenus des best-sellers dans les cours de la Renaissance.
L'habillement et la mode étaient importants à la Renaissance. Les changements économiques, sociaux et politiques de l’époque se reflétaient dans les styles populaires. Ces styles comprenaient le relèvement des ourlets pour les hommes et leur allongement pour les femmes. Il y a eu une évolution vers les uniformes militaires. La Réforme protestante a eu un impact sur la tenue vestimentaire du clergé. Les vêtements ont également évolué pour refléter plus clairement les distinctions de classe. L'habillement était central dans la formation de l'identité. La couleur, la coupe, le pliage et le drapé prennent une grande importance. Les changements vestimentaires en révélaient autant sur les distinctions de classe et le caractère national. Les vêtements reflétaient également l’évolution des perceptions de la masculinité, de la féminité et des idéaux de beauté.
Vers la fin du XIVe siècle, les conditions économiques devinrent favorables au commerce du vêtement. D’une manière générale, l’Europe connaissait une stabilité politique, une plus grande richesse et un marché en expansion. Celles-ci ont permis l’émergence d’industries en Italie et ailleurs basées sur la production, l’importation et l’exportation de produits et de tissus de luxe. Par exemple, le tissage de la soie a été introduit par la population juive au Xe siècle. À Lucques, en Italie, l'industrie de la soie s'est considérablement développée après le milieu du XIVe siècle. Venise a bénéficié de son réseau commercial et de sa flotte importante pour importer des soieries et des textiles précieux. Cela comprenait du tissu et des matériaux pour fabriquer du tissu en provenance de l'Est.
La soie en général connut une expansion en Espagne puis en France. L'Italie reste cependant centrale pour la production de soieries. Cela incluait des matériaux de luxe tels que les satins, les velours, le taffetas et finalement la dentelle. La laine et le lin resteront les tissus les plus utilisés de l'Europe de la Renaissance. Cependant, le port de vêtements de luxe est devenu une telle part de la société que des lois ont été adoptées pour limiter la fabrication et la consommation de ces tissus. Le but principal de ces « lois somptuaires » était de limiter la consommation d’articles de luxe. Les lois déterminaient également qui pouvait porter quoi et réglementaient la forme et le style des vêtements. Avec l'augmentation des importations de métaux précieux après le voyage de Colomb en Amérique, l'Italie a été confrontée à de nouveaux centres de fabrication et de commerce dans le nord. Ces développements ont conduit l'Italie à accroître sa production et son commerce de tissus et de soieries de luxe.
Dans les pays du Nord, de nouveaux équipements de fabrication, auparavant interdits par les anciennes réglementations des corporations, commencèrent à apparaître. Les guildes étaient des groupes d'artisanat et de commerce médiévaux qui formaient des apprentis et fixaient des normes pour la production de biens. Le premier sur les lieux fut le moulin à foulon, dans lequel les étoffes de laine étaient transformées. Peu de temps après, la machine à tricoter fut introduite après son invention en 1589. Dans le même temps, les innovations technologiques ont amélioré les processus de tissage et de teinture. En Angleterre, les propriétaires fonciers augmentèrent leur propre production de laine en transformant une partie de leurs terres en pâturages. Ainsi, les animaux à laine disposaient de plus d’espace pour paître.
La mode était extrêmement importante pour l’homme de la Renaissance, surtout lorsqu’il était à la cour. Chaque jour, l'homme du monde se chargeait de s'habiller avec l'aide d'un domestique. Le domestique devait accomplir la tâche fastidieuse de régler les « points » du gentleman. Les « points » étaient des morceaux de dentelle qui maintenaient un vêtement ensemble. Ensuite, il fallait que le domestique lace le pourpoint, qui était une veste ajustée. Ensuite, il lui fallait arranger le stomacker, qui était un morceau de tissu fortement orné de bijoux ou brodé, porté au centre du corsage. Enfin, vint le temps d'attacher la chemise à volants.
Le costume variait selon les nations. En général, cependant, les vêtements longs pour hommes prévalaient toujours dans les églises et les universités. Cependant, ils sont devenus beaucoup plus courts. Le surcot qui était un manteau extérieur ou un manteau, est passé de mode au profit de la jambe exposée fermée par un tuyau. Le pont verseur était attaché au tuyau. Il s’agissait d’un pourpoint ajusté à la poitrine et à la taille, fait d’un tissu riche doublé et matelassé. Le pour-pont a pris des formes et des coupes variées au fil des années et selon les régions. Les régions, à leur tour, s’influencent mutuellement. Par exemple, lorsque le roi français Charles VIII du XVe siècle envahit l'Italie en 1494, les Français et les Italiens échangèrent leurs styles vestimentaires.
Vers la fin du XVIe siècle, l’Espagne commença à établir des normes de mode qui finiraient par dominer toute l’Europe. Les Espagnols préféraient une ligne de vêtements simple et sombre. La douceur a été remplacée par une silhouette droite et raide. Le pourpoint a été conçu pour souligner la finesse de la taille et le noir est devenu la couleur préférée des Espagnols. En France, au milieu du XVIe siècle, le roi Henri II et sa cour étaient particulièrement friands de teintes sombres rehaussées d'or. Il y avait une absence de l’ornementation italienne que l’on retrouve habituellement dans les vêtements. Durant le règne ultérieur du roi de France Henri III, les Français revinrent brièvement au style italien. Au début du XVIIe siècle, à la cour du roi Henri IV, les nobles devaient porter jusqu'à trente costumes. Ils étaient censés les changer fréquemment afin de maintenir leur respectabilité.
C’est à cette époque que la collerette autour du cou devint de plus en plus prononcée. La collerette était un grand col rond en mousseline ou en lin plissé. Il est devenu très grand, en particulier dans l'Angleterre élisabéthaine. Selon un auteur de 1579, les porteurs pouvaient à peine bouger la tête. Les femmes utilisaient également une variété de produits cosmétiques, de bijoux, de couvre-chefs et d'accessoires. La reine Elizabeth I a fait du vêtement un élément central de ses stratégies politiques. Elle souhaitait conserver un teint de « reine vierge ». Le surnom de « Reine Vierge » lui avait été donné parce qu’elle n’était pas mariée. Elle a conservé un teint « vierge » en appliquant une épaisse couche de maquillage en poudre blanche sur son visage déjà pâle.
Les accessoires sont devenus plus importants que jamais, pour les hommes comme pour les femmes. Les boucles d'oreilles avaient disparu au Moyen Âge. Mais l’Europe de la Renaissance a connu un regain de popularité. Les mouchoirs sont également devenus très populaires. Les gants étaient au cœur de la mode et étaient parfois fabriqués en tissu doré incrusté de centaines de perles. Des éventails, des miroirs à main et des objets richement brodés complétaient les accessoires que les femmes jugeaient nécessaires pour les occasions sociales, en particulier sous le règne d'Elizabeth. Les prostituées disposaient de plus de liberté en matière de tenue vestimentaire et d'ornementation que leurs sœurs plus restreintes et domestiquées. Cela était particulièrement vrai dans des villes comme Venise. Leur tenue vestimentaire influençait celle des femmes respectables. Les prostituées ont souvent lancé des modes telles que le port de hautes chaussures à plateforme en bois. Les chaussures étaient si hautes qu'un commentateur a décrit le spectacle comme celui de regarder une créature moitié bois et moitié femme chanceler dans la rue.
À la Renaissance, la mode féminine devient de plus en plus élaborée. Les lois somptuaires tentaient de limiter les mesures, la quantité de bijoux et la coupe des vêtements pour femmes. Dans toute l’Europe, à la fin du XVe siècle, la robe remplaçait les autres vêtements féminins, à l’exception de l’élégant surcot. La robe et le surcoat s'ajustaient étroitement à la partie supérieure du corps tandis que la jupe flottait et traînait sur le sol. Cela allongeait la ligne et accentuait la taille et les hanches. Les décolletés des robes variaient. Le décolleté carré vient des styles italiens. Les Bourguignons préféraient les ouvertures pointues du cou, les manches des robes avaient tendance à traîner. Au XVIe siècle, tout comme les hommes, les femmes adoptèrent également la mode espagnole. Le plus remarquable était le farthingale, qui était des cerceaux portés sous une jupe pour l'élargir au niveau de la hanche.
Le farthingale était un vêtement préféré de Marguerite de Valois, la reine consort d'Henri IV, au début du XVIIe siècle. Le farthingale pouvait prendre de nombreuses variantes et nécessitait la construction de chaises hautes spéciales pour accueillir les cerceaux lorsque les femmes s'asseyaient. Les vêtements couvraient le corps, mais ils modifiaient, façonnaient, pressaient et exagéraient également la forme humaine. Pour les hommes de la Renaissance, les pourpoints bouffants donnaient l'apparence aux larges épaules d'un soldat en armure. De même, les manteaux étaient rembourrés de foin et de paille au niveau des épaules. Avec le tuyau, les jambes mâles ont reçu une nouvelle importance. La taille était également soulignée, généralement mise en valeur par un pourpoint moulant ou resserrée avec une ceinture. De plus, la braguette de plus en plus proéminente exagérait la région de l'aine masculine. La braguette était un rabat ou un sac dissimulant une ouverture sur le devant d'une culotte ou d'un pantalon. Il était originaire d'Allemagne. La forme en coquille était particulièrement appréciée.
Les femmes portaient également des vêtements qui mettaient en valeur ou exagéraient leur corps. Dans l'Italie du XVIe siècle, les femmes « pleines de chair » étaient favorisées et comparées aux tonneaux de vin. Pour souligner cet idéal, les vêtements des femmes étaient recouverts de bijoux en or, émeraudes et perles. Cependant, suite aux influences espagnoles, la taille des femmes fut progressivement resserrée. Cela a conduit à des corsages en os de baleine de plus en plus rigides et tortueux qui comprimaient également étroitement les seins. Les vêtements des classes sociales inférieures étaient simples et ne variaient pas beaucoup selon les régions. Les sous-vêtements sont apparus chez les paysans au XIIIe siècle. Les jambes pouvaient être nues et les pieds découverts, à l'exception d'une semelle plate maintenue par une lanière de cuir enroulée autour de la jambe. Certains paysans des Flandres portaient des sabots en bois, tout comme les ouvriers du tissu urbains de Florence. Les femmes portaient des jupes et des tabliers retroussés pour travailler. Ceux-ci étaient surmontés de corsages serrés et de manteaux enveloppants. Des hommes vêtus de vestes boutonnées, de culottes courtes et de chapeaux à larges bords.
Le matériau utilisé pour les vêtements était principalement constitué de laine grossière ou de lin écru. Les couleurs étaient principalement limitées au noir pour les vêtements pour femmes. Pour les hommes, les « choix » de couleurs étaient des bruns et des gris ternes. Ceux qui travaillaient dans l’industrie du luxe tentaient d’imiter les classes supérieures en portant du velours lors des grandes occasions. Cependant, en général, les vêtements ternes des ordres sociaux inférieurs étaient constitués de boutons ou de foulards argentés. Parfois, on pouvait voir un taffetas, un tissu élégant au tissage simple. On pourrait parfois aussi voir un manchon. Un manchon était un vêtement tubulaire, normalement en fourrure, utilisé pour réchauffer les mains. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que le développement de la production industrielle offrira aux classes populaires une grande variété de tissus et de couleurs. Les plus pauvres continuaient à porter des haillons usagés ou des vêtements en laine grossière donnés par des corporations commerciales ou des confréries religieuses.
La mode de la Renaissance a emprunté de nombreux éléments à l’armée. Ces modes allaient de la culotte au port de l'épée. Les épées étaient généralement portées par les nobles pour la décoration cérémonielle à la cour. Débutée en Allemagne, l’obsession des coupes courtes et des manches bouffantes s’est propagée à travers l’Europe. Cette mode a connu son apogée au XVIe siècle. Ce style proviendrait des vêtements en lambeaux des mercenaires suisses revenant d'une victoire contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, en 1476. Les Suisses avaient saisi les vêtements des soldats morts vaincus. Les soldats mercenaires qui revenaient ont trouvé les vêtements trop serrés, alors ils les ont lacérés ou ont laissé les coutures se déchirer. Bien sûr, cela faisait gonfler les vêtements.
Les Allemands qui ont été les premiers à remarquer ce look étaient à leur tour responsables de la culotte à « treillis » de type militaire. Ceux-ci étaient constitués de larges bandes de tissu et sont aujourd'hui portés par les gardes suisses pontificaux. La guerre de Trente Ans, qui a duré de 1618 à 1648, semble avoir été particulièrement influente dans la diffusion du style militaire au sein de la population. Il s'agissait notamment du chapeau souple à larges bords souvent porté par les soldats, qui devint plus tard le tricorne à trois coins. Sont également inclus un large col, ainsi que les rangées de boutons qui décorent les coutures des pantalons.
Au cours des XVe et XVIe siècles, les armures sont devenues de plus en plus inutiles face à l'évolution des modes de guerre. Une combinaison de protection métallique portée au combat donnait peu d'avantages à son porteur face à l'utilisation de troupes et d'artillerie massives, y compris des fusils et des canons. Néanmoins, les armures atteignirent de nouveaux niveaux de décoration qui remplissaient des fonctions plus cérémonielles que pratiques. Au XVIe siècle, le maître armurier le plus célèbre était Filippo Negroli de Milan, en Italie. Les casques et boucliers détaillés qu'il a produits ont été fabriqués pour des dirigeants tels que l'empereur romain germanique Charles V du XVIe siècle et le roi François Ier de France.
Negroli s'est inspiré de thèmes de l'art traditionnel grec et romain. Membre de la quatrième génération d'une dynastie de fabricants d'armures, il s'est spécialisé dans l'all'antica. Il s’agissait d’un type d’armure contemporain façonné dans le style de l’Antiquité et comportant des images de lions, de dragons et de têtes de Méduse. Méduse était bien sûr un monstre de la mythologie grecque qui avait des serpents en guise de cheveux. Parmi les créations les plus élaborées de Negroli se trouvait un casque qui était une sorte de masque de monstre. Il se composait de joues volantes en forme d'ailes de chauve-souris, de crocs sortant de la mâchoire et d'une paire de cornes en forme de bélier positionnées sur le dessus de la tête.
Après le XVIe siècle, la montée de la guerre d'infanterie impliquant des masses d'hommes a généré le besoin d'uniformes. Les premières versions d’uniformes ont été trouvées au XVe siècle. Les soldats suisses portaient des pourpoints coupés courts aux couleurs vives et des culottes serrées. Un autre exemple pourrait être trouvé au XVIe siècle, lorsque les troupes de l'armée impériale à Nuremberg, en Allemagne, portaient des manteaux rouges. À peu près à la même époque, les soldats anglais du duc de Norfolk portaient des costumes bleus bordés de rouge. Les mercenaires allemands de Landsknechten, recrutés dans les ordres inférieurs, furent les premiers à utiliser de longues culottes et des capes au combat. Ils furent également les premiers à porter des coupes larges et des manches bouffantes. Cependant, en général, les uniformes d'une variété plus simple et plus utile ne se développeront que lorsque les moyens de production de masse seront disponibles à la fin du XVIIe siècle.
Les papes, les cardinaux et autres membres du clergé n’étaient pas à l’abri d’adopter les tendances vestimentaires de l’époque. Le pape Paul II a promulgué des lois vestimentaires au XVe siècle. C'étaient des lois relatives aux vêtements ou vêtements du clergé. Elles étaient destinées à réglementer des costumes parfois outranciers. Bien que cela ne soit pas typique, le cardinal Francesco Gonzaga du XVe siècle s'est endetté en achetant des robes turques jusqu'au sol. Il s'agissait de damas cramoisi et vert, de divers velours et soies tissées, ainsi que d'autres vêtements tout aussi extravagants. Dans une autre réaction à ces expositions, le moine et prédicateur italien du XVe siècle Girolamo Savonarola a inspiré de nombreux « feux de vanités » à Florence dans les années 1490. Ces feux de joie étaient des cérémonies au cours desquelles des objets de luxe étaient brûlés pour protester contre l'extravagance du clergé et des laïcs.
Des voiles, des cosmétiques et des ornements précieux étaient jetés au feu. Ils étaient accompagnés de masses de faux cheveux, le blond étant la couleur à la mode. L'humaniste néerlandais du début du XVIe siècle, Desiderius Erasmus, a commenté les vêtements de plus en plus élaborés des ordres cléricaux. Il a noté leur obsession pour les ceintures, les capuchons (capuches sur les manteaux), les robes et les tonsures, qui étaient une partie de la tête rasée à la mode, généralement la couronne. La Réforme protestante a également eu un impact sur l'habillement. Les adeptes de la nouvelle foi se distinguaient par des foulards noirs, des robes blanches et des surplis blancs unis. Les surplis étaient de longs vêtements de dessus à manches ouvertes.
Les festivals, processions et événements spéciaux sont devenus plus fréquents à la Renaissance. Ces événements ont été encouragés par l'augmentation du pouvoir d'achat, les manifestations princières et civiques et un désir général de mise en scène. En conséquence, les vêtements sont devenus plus élaborés. Cela était particulièrement vrai au XVIIe siècle, lorsque le masque devint un genre théâtral de cour pleinement développé. C'était une forme de drame dans laquelle les acteurs utilisaient des masques. Ce phénomène est devenu si important en Angleterre que le scientifique du XVIIe siècle, Sir Francis Bacon, a écrit un traité sur le sujet.
Les représentations avaient toujours lieu la nuit et étaient généralement éclairées aux chandelles. On pensait que les couleurs vestimentaires les plus flatteuses étaient le blanc, le rouge œillet ou une sorte de vert « eau de mer ». Les costumes pouvaient également être confectionnés en « tynsell », c'est-à-dire en guirlande, un fil métallique étincelant. Les costumes étaient en outre décorés de perles et de paillettes, les paillettes étant de petits disques de métal brillant. Ils pourraient en outre être ornés de glands dorés, de cloches dorées, de franges et de dentelles argentées et dorées.
Les masques étaient généralement faits de velours et construits pour produire un effet dramatique. Les visiteurs étrangers trouvaient souvent les costumes scandaleux et bizarres. Les Français étaient surtout connus pour leurs tenues vestimentaires affichées lors d'événements judiciaires scintillants. Les Français ont acquis une réputation de spectacles d'une magnificence sans précédent. Au XVIIe siècle, en France, les ballets sont devenus un moyen pour les artistes de s'habiller en Indiens, Maures, Africains et Asiatiques. Les membres de la cour française s'adonnaient à leur propre genre de théâtre. Lors d'événements spéciaux, ils s'habillaient en shahs persans, en Turcs, en Rajas (princes indiens) et en Amérindiens.
Les fêtes de la Renaissance peuvent être utilement classées de plusieurs manières différentes. Les fêtes religieuses et civiques visaient à représenter l’ordre établi sous un jour favorable. L'intention était également de créer une impression d'harmonie et de sécurité au sein de l'empire. Certains festivals avaient lieu chaque année. D'autres étaient organisés pour des occasions uniques. D'autres étaient populaires et folkloriques. Ceux-ci célébraient une tradition basée sur un mythe populaire ou un conte populaire. Beaucoup impliquaient des participants d’élite et érudits. Certaines fêtes étaient censées défier les coutumes religieuses et sociales normales, ne serait-ce que pour une journée. Par exemple, une vieille tradition dans certaines villes permettait aux gens ordinaires de détruire le dais sous lequel un officier religieux venait de monter. À Ferrare, en Italie, en 1598, même le cheval du pape Clément VIII fut pris comme prix par la foule surexcitée.
L’apparat civique visait également à présenter une image unifiée de l’État et de la société. Les processions militaires et les cérémonies locales mettaient souvent en valeur le chef de l'État et d'autres représentants du gouvernement devant le peuple. Des ambassadeurs étrangers, des délégations de marchands étrangers et des représentants de guildes locales étaient également souvent présents. Ces manifestations publiques impliquaient une harmonie entre les différentes classes sociales et même entre les nations du monde chrétien. Le calendrier des fêtes et processions religieuses était censé donner un sentiment d’harmonie entre l’histoire humaine et l’univers. Lorsque les fonctionnaires municipaux participaient aux processions religieuses, ils montraient que la vie spirituelle et la vie quotidienne, ou non religieuse, laïque ne faisaient qu'un.
Un exemple est celui des processions du dimanche des Rameaux à Venise, le dimanche précédant Pâques. Pour les cités-États italiennes, les jours de fête étaient l’équivalent des celebrations modernes telles que le 14 juillet en France ou le Jour de l’Indépendance aux États-Unis. À Florence, un hommage symbolique a été offert à l'occasion de la fête de Saint Jean-Baptiste, le 24 juin. Saint Jean était considéré comme le dernier prophète juif et précurseur de Jésus-Christ. À Florence, la fête de la Saint-Jean était souvent célébrée par des défilés accompagnés de chars patriotiques. A Sienne, l'Assomption de la Vierge, le 15 août, était la fête nationale. Cela célébrait le jour où la Vierge Marie aurait été élevée au ciel. Venise n'a pas seulement célébré la fête de Saint-Marc. Il y avait plusieurs jours fériés supplémentaires célébrant le lien du saint avec la République de Venise. Saint Marc était bien sûr l'un des disciples de Jésus et la fête était célébrée chaque 25 avril.
Les itinéraires empruntés par les processions civiques suggéraient également une intégration de l’Église et de l’État. Ils ont également souligné le lien entre le dirigeant et le gouverné. Les monarques en visite s'arrêtaient aux portes de la ville pour recevoir les salutations des pères de la ville. Puis ils se rendirent à la cathédrale locale pour être reçus par l'évêque. Le souverain faisait, à la cathédrale, une démonstration de piété et de dévotion religieuses personnelles. Ce n'est qu'après cette cérémonie qu'ils furent libres de se rendre au palais où ils logeraient. Dans certaines villes, plusieurs escales peuvent être nécessaires. Par exemple, Naples, en Italie, comptait cinq seggi, ou sièges de gouvernements de district. Les monarques s'arrêtaient à des endroits désignés le long de la route d'entrée pour recevoir les hommages des différentes autorités locales.
Les nouveaux papes participeraient à une procession élaborée pour prendre possession de Saint-Jean de Latran, qui était une ancienne basilique ou église. Le cortège du nouveau pape s'arrêterait pour accepter l'allégeance civile de la colonie juive de Rome. Cet arrêt a également confirmé le maintien des droits civils de la colonie. Les nouveaux souverains d'Angleterre et de France ont noté les messages de divers groupes lors de leur première grande progression à Londres et à Paris. Les récits officiels de ces cortèges étaient plutôt positifs. Il semble que l’enthousiasme du public ait été énorme. La conscience des injustices a été temporairement suspendue, les gens étant pris par un sentiment de fierté civique.
L'unité civique était également favorisée par celebrations des mariages royaux et nobles. Si la mariée venait d'un autre État ou d'un autre pays, des entrées joyeuses dans la ville faisaient partie de la cérémonie. Une série de divertissements courtois avait généralement lieu également. Un exemple est le mariage du duc de Florence du XVIe siècle, Cosimo I. Cosimo s'est marié et est la fille du vice-roi espagnol de Naples en 1539. Un vice-roi était un fonctionnaire qui représentait le roi. L'union représentait une alliance politique importante entre l'Espagne et Florence. Les thèmes des décorations d'entrée célébraient cette alliance. Les divertissements courtois comprenaient des banquets, des concours en salle, des tournois ou autres concours de chevalerie et des feux d'artifice. Les divertissements comprenaient également des représentations de comédies, élément particulièrement important de tout événement de ce type en Italie.
Après le carnaval, les festivités de mariage étaient la principale occasion de mettre en scène des comédies. Par exemple, à Ferrare, en Italie, un mariage important a eu lieu en 1502 entre Lucretia Borgia et Alfonso I d'Este. Une partie des divertissements du mariage comprenait la représentation de comédies du dramaturge romain Plaute du IIIe siècle avant JC. Les comédies étaient jouées en italien. Plus tard au cours du siècle, des comédies néoclassiques originales furent jouées à Florence, Mantoue et Ferrare. Les comédies étaient jouées dans la langue vernaculaire ou locale. Les comédies étaient appelées « commedie érudite » ou « comédies savantes ». La première représentation de comédie néoclassique en France a eu lieu lors de la visite à Lyon de la reine Catherine de Médicis au XVIe siècle.
Les festivités nuptiales (mariages) élaborées sont également devenues courantes dans le nord de l'Europe. Le mariage du roi danois Frédéric II en 1572 a été célébré avec des banquets, un tournoi et un grand passage de la mariée dans les rues de Copenhague. Les celebrations du mariage du roi écossais Jacques VI du XVIe siècle avec Anne de Danemark comprenaient apparemment des comédies en latin et en danois. James VI n'a pas gouverné l'Écosse mais l'Angleterre ainsi que James I. Les comédies de célébration ont été jouées d'abord à Oslo, en Norvège, puis à la cour danoise. Les divertissements courtois d'Europe du Nord sont finalement devenus plus élaborés que ceux d'Italie, évoluant vers un style somptueux appelé « baroque ». Lors des celebrations de 1634 à Copenhague pour le mariage du prince élu Christian, il y avait un ballet, deux comédies musicales et un feu d'artifice extrêmement élaboré.
L'art des fêtes de cour devint une affaire internationale. Les Italiens étaient souvent employés dans le nord. L'architecte anglais du XVIIe siècle Inigo Jones, qui possédait une expérience italienne, a presque certainement conçu le matériel du festival pour Hambourg, en Allemagne, en 1603. Des acteurs anglais se sont produits en Allemagne et au Danemark. Professeurs et étudiants humanistes de diverses villes s'amusaient parfois à faire revivre les fêtes classiques ou à célébrer des événements de l'histoire romaine. C'est à l'université de Rome que cette pratique fut poussée le plus loin. À la fin du XVe siècle, Julius Pomponius Laetus et quelques collègues renouvelèrent l'observance de la Palilia. La célébration était à l'origine une fête agricole, mais à l'époque classique, elle commémorait également l'anniversaire de la construction de Rome.
Dans les premières années du réveil, on buvait plus qu’on ne mangeait. Un discours latin faisant l'éloge de la ville était l'élément cérémonial central de la célébration. En 1501, les festivités furent déplacées au Capitole, l'ancien Capitole, et les fonctionnaires du Vatican et du gouvernement de la ville commencèrent à y participer. En 1513, la Palilia fut l'occasion de la fête la plus remarquable et la plus savante de la Renaissance. Le nouveau pape Léon X, qui régna de 1513 à 1521, demanda au gouvernement de la ville d'accorder la citoyenneté romaine d'honneur à son frère Giuliano Médicis et à son neveu Laurent de Médicis.
Les fonctionnaires de la ville, flattés, décidèrent de diriger les débats avec autant de style que possible. Tout d'abord, les autorités municipales ont fait en sorte que la cérémonie de citoyenneté coïncide avec la Palilia. Ils commandèrent alors la construction d'un immense théâtre néoclassique. Le théâtre présentait des statues et des peintures temporaires illustrant des événements de l’histoire ancienne. Les peintures et les inscriptions se concentraient sur les relations (prétendument) amicales entre les premiers Romains et Étrusques. Les Étrusques étaient d'anciens peuples qui se sont installés dans la région du centre de l'Italie, aujourd'hui connue sous le nom de Toscane, où se trouve Florence. En fait, les Romains et les Étrusques étaient continuellement en guerre les uns contre les autres dans l’Antiquité.
Lors de la cérémonie, les Romains furent nommés ancêtres symboliques des Médicis. Les Étrusques étaient désignés comme les ancêtres symboliques des Florentins. Les débats comprenaient une messe qui était le seul élément religieux de la cérémonie. Il y eut aussi un discours latin faisant l'éloge de Rome et des Médicis. Enfin, bien sûr, il y a eu la remise d'un diplôme de citoyenneté au frère et au cousin du Pape. Un banquet élaboré de plus de vingt plats a été servi. Un spectacle complexe a été réalisé en latin. Le Poenulus de Plaute a été interprété en latin. Les rôles féminins et masculins étaient remplis par des étudiants masculins.
Par la suite, les Romains furent extrêmement fiers de ce qu’ils avaient accompli. Cet événement fut l’une des dernières fois où le latin fut utilisé comme langue principale dans une célébration publique romaine. Le pape Léon X autorisa celebrations annuelles de la Palilia, mais il n'y eut plus jamais une telle splendeur. Des festivals comme celui-ci, qui servaient de protection contre le ressentiment populaire ou de subversion de l'ordre public, ont attiré l'attention des historiens ces dernières années. Les Saturnales romaines sont l’ancêtre incontestable de nombreuses fêtes de ce genre à la Renaissance. Les Saturnales étaient célébrées au moment du solstice d'hiver. C'était au début de l'hiver, généralement vers le 22 décembre. Lors d’une représentation de la fête antique, l’ordre social fut bouleversé. Maîtres et esclaves échangeaient des vêtements. Les maîtres servaient ensuite les esclaves à table.
Cela a conduit à la « Fête des Fous » ou « Festum Stultorum », longtemps célébrée dans les communautés religieuses de la majeure partie de l’Europe occidentale. Elle avait lieu peu après Noël, à l'époque des anciennes Saturnales. La hiérarchie sociale s'est inversée. Un jeune clerc ou novice monastique était élu évêque. Les choses normalement considérées comme sacrées étaient ridiculisées, notamment lors de messes simulées. En association avec la « Fête des Fous », certaines localités observaient une « Fête des ânes » ou « Festum Asinorum ». Un âne a été amené dans l'église et le prêtre et la congrégation imitant le cri d'un âne, braient à certains moments de la liturgie. Cependant, les hauts responsables de l'Église ont pris des mesures pour mettre fin à cette coutume. Au XVIe siècle, ces celebrations étaient en déclin. Les fêtes laïques de mauvaise gestion ont cependant continué à être pratiquées.
Aux XVe et XVIe siècles, la France et d'autres pays européens possédaient des organisations parfois appelées abbayes ou royaumes de mauvaise gestion. Composées principalement de jeunes hommes, ces associations élisaient des abbés ou des rois qui les dirigeaient dans diverses activités lors de fêtes régulières comme Noël et le carnaval. Ils dirigeaient également des « charivaris ». Il s’agissait d’événements bruyants qui humiliaient les hommes dominés par leurs femmes. Les hommes étaient connus comme des « maris picorés ». Souvent, les épouses elles-mêmes participaient aux festivités. Dans l'Angleterre du XVIe siècle, un tribunal pour mauvaise gouvernance était parfois convoqué pour Noël. Ces celebrations se déroulaient principalement parmi les classes sociales supérieures pendant une période immédiatement avant et après Noël.
La fête annuelle de « transgression » de loin la plus importante était le carnaval. Elle était célébrée dans la majeure partie de l’Europe centrale et occidentale, au moins jusqu’à la Réforme. Par la suite, le carnaval a été supprimé, ainsi que le Carême, dans la plupart (mais pas toutes) des régions protestantes. Le carnaval était à l'origine célébré la « Douzième Nuit ». C'était le soir de « l'Epiphanie », ou la venue des Mages après la naissance de Jésus. Encore une fois, c'était proche de l'époque des anciennes Saturnales. A la Renaissance, elle se limitait dans la plupart des endroits aux derniers jours précédant le Carême, dont la date variait avec celle de Pâques. Le carnaval était une période de célébration autorisée et autorisée du « monde à l’envers ». Les formes de celebrations variaient selon la tradition locale. Le masquage était peut-être l’élément le plus courant. Le port du masque a cependant été périodiquement interdit en réaction à divers excès.
Dans les moments les plus difficiles, la célébration du carnaval était suspendue. Un exemple est celui de Rome, dans les années qui ont suivi le sac de 1527, l'invasion de l'armée de l'empereur Charles Quint. Le carnaval était peut-être la plus populaire de toutes les fêtes annuelles, la décision d'y renoncer n'a donc pas été légère. Les gens n’y ont pas facilement renoncé. Rome avait l'une des séries de divertissements carnavalesques les plus élaborées. L'établissement du programme annuel était le privilège et la responsabilité du gouvernement de la ville, le Campidoglio. Le programme devait être approuvé par le pape, qui contribuerait aux dépenses. Presque tous les événements ont eu lieu dans la semaine entre les deux derniers dimanches précédant le Carême. Les activités de célébration comprenaient plusieurs courses à pied. L’une était destinée aux jeunes hommes, une autre aux Juifs, une aux vieillards et parfois une aux prostituées.
Il y avait aussi des courses de chevaux, des corridas et des jeux impliquant d'autres animaux. Certains jeux impliquant des animaux peuvent sembler très cruels du point de vue moderne. Plusieurs matchs ont eu lieu le deuxième dimanche sur une colline appelée Testaccio, à l'extérieur des murs de la ville. Certains autres jours, des concours de chevalerie étaient organisés pour les jeunes aristocrates. Le jeudi gras, le principal spectacle du carnaval a eu lieu sur la Piazza Navona, alors appelée l'Agone. L'un des moments forts a été un défilé auquel participaient le sénateur unique et trois fonctionnaires (« conservateurs ») du gouvernement de la ville. Le défilé comprenait un char représentant des personnages historiques et mythologiques. D'éminents écrivains et universitaires ont planifié les chars. Des artistes de premier ordre les décoraient parfois.
Les celebrations romaines incluaient donc à la fois des éléments savants et populaires, à la fois aristocratiques et plébéiens (du peuple). Bien qu’il y ait eu beaucoup de décompression et d’apaisement des tensions, les éléments véritablement subversifs n’étaient pas très visibles. Le concours flattait souvent le pape régnant. Par exemple, le spectacle de 1536 a recréé le triomphe de Paulus Aemilius, ou pape Paul III, qui régna de 1534 à 1549. Le masquage était sans aucun doute politiquement risqué. Les papes interdisaient les déguisements qui se moquaient du clergé ou des cérémonies religieuses. Le harcèlement des Juifs pendant le carnaval était également strictement interdit. Les historiens interprètent cela comme une indication qu’une telle activité aurait probablement eu lieu autrement, et s’est probablement produite dans d’autres circonstances.
Parmi les autres carnavals italiens, ceux de Florence et de Venise étaient particulièrement élaborés. En 1513, deux compagnies de jeunes Florentins, semblables aux abbayes du mauvais gouvernement, organisèrent des défilés concurrents à travers la ville. Le défilé du premier groupe était composé de chars représentant les âges d'or du passé et du présent. L’âge d’or actuel faisait référence au récent retour au pouvoir de la famille Médicis. L’âge d’or du passé faisait naturellement référence à l’ancien Empire romain. Le deuxième défilé montrait les trois âges de l'homme. Des comédies étaient souvent jouées pour le carnaval à Florence comme dans d'autres villes italiennes. Il est né un genre lyrique spécial de chants de carnaval connu sous le nom de « canti carnascialeschi ». Ces chansons étaient les préférées de Laurent de Médicis « le Magnifique », souverain de la ville à la fin du XVe siècle.
Venise a connu un carnaval particulièrement long. Cela a commencé la Douzième Nuit. Le point culminant officiel est arrivé le jeudi gras. À ce stade, le duc (« doge ») et d’autres fonctionnaires ont supervisé une étrange célébration d’une victoire du XIIe siècle sur le patriarche d’Aquilée. Au cours de cette cérémonie, un taureau et trois cents cochons furent jugés et exécutés. Cependant, l'exécution n'a eu lieu qu'après que les animaux aient été taquinés et pourchassés autour de la place (« piazetta »). Sur la Place Saint-Marc, il y avait parfois des défilés qui se moquaient des officiels de la république. Ces festivités se déroulaient généralement sans aucune tension entre les fonctionnaires et la population. Comme à Florence, de nombreuses activités carnavalesques étaient menées par des groupes de jeunes hommes bien nés. A Venise, on les appelait « Campagnie delle Claze ».
Ces groupes organisaient parfois des spectacles sur la place sur des plates-formes spécialement construites. Ils organisaient également des représentations de comédies, généralement dans des maisons privées. De nombreux étrangers sont venus en ville pendant le carnaval vénitien. Ils venaient aussi bien pour les spectacles que pour le masquage, qui était effectué gratuitement. L'activité officielle des carnavals italiens n'était guère subversive. Il était même souvent favorable au gouvernement. Mais en Allemagne, c'était plus audacieux. Au cours des premières années de la Réforme, des défilés de carnaval et des chars allégoriques dans plusieurs villes se moquaient du pape et du clergé catholique romain. Au moment de la Réforme protestante, la cible de la gaieté avait changé. A Nuremberg, en 1539, le char principal était un navire qui se moquait des principaux prédicateurs protestants opposés aux plaisirs du carnaval.
Partout, les autorités municipales, nerveuses, ont tenté d'empêcher de tels embarras. La plupart des pièces de théâtre, comme celles jouées à Nuremberg, évitaient généralement le ridicule aux institutions gouvernementales officielles et aux fonctionnaires. Le sujet était généralement les défauts humains, tels que l'envie et la luxure. La France offre l’exemple exceptionnel d’une célébration carnavalesque qui a tourné à la violence. Dans la ville dauphinoise de Romans, les tensions sociales étaient vives depuis un certain temps. En 1580, un groupe de fêtards profita de la confusion du carnaval et massacra un grand nombre de fêtards réformateurs qui participaient également au carnaval. Les chercheurs contemporains ne savent toujours pas si l’atmosphère « à l’envers » des carnavals a jeté les bases de la révolution sociale, politique et religieuse de l’époque.
Au Haut Moyen Âge, du XIe au XIIIe siècle, les foires sont devenues un élément important de l'activité économique. À la fin du Haut Moyen Âge, ils existaient en grand nombre dans toute l’Europe du Nord-Ouest. Moins d’informations historiques sont disponibles sur de tels événements en Europe de l’Est et en Italie. La plupart des foires étaient l'expansion d'un marché hebdomadaire local en un événement annuel d'une durée de quelques jours. Souvent, les foires se tenaient en même temps que la fête d'un saint célébré localement. Un nombre beaucoup plus restreint de célébrations ont été célébrées au niveau régional ou national. Même si ces foires attiraient parfois des marchands d’un pays étranger, elles n’avaient pas le statut de célébration véritablement internationale.
Des exemples classiques en sont les foires anglaises de Saint Ives, Boston et Winchester, visitées par des marchands flamands achetant de la laine et vendant du tissu. Il y avait un cycle annuel de six foires en Flandre. Elle était composée de deux foires à Ypres et une à Bruges, Torhout, Lille et Messines. Il s'agissait de foires plus grandes, mais qui ne dépassaient pas beaucoup le statut régional que leurs homologues anglaises. Les seules véritables foires internationales comprenaient le cycle du Champagne dans le nord-est de la France avec deux chacune à Troyes et Provins, et une à Lagny et Bar-sur-Aube. À la fin du XIIe siècle, c'étaient les centres commerciaux les plus dynamiques d'Europe. Là, les Italiens échangeaient des produits contre des tissus du Nord apportés par des marchands des Pays-Bas, de France et d'Angleterre.
Les foires de Champagne peuvent également être désignées comme les seules occasions avant le XVe siècle où de telles transactions étaient monétisées. Ces transactions étaient uniques dans le sens où la monnaie était une marchandise d’échange. L’argent changeait de mains, soit sous forme de pièces de monnaie, soit sous forme de lettres de change internationales. Cette caractéristique a contribué à maintenir l'importance des foires de Champagne jusque vers les années 1320. Cependant, en tant que centres de commerce de marchandises, les foires de Champagne étaient en déclin depuis au moins quarante ans auparavant. Un ralentissement de l'économie au 14ème siècle a provoqué un déclin sévère et généralisé de l'activité des foires. Aux XVe et XVIe siècles, la reprise fut inégale et les conditions fluides. Au début, il semblait que Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, en France, pourrait survivre en tant que successeur international des foires de Champagne. Mais avant 14 heures à Genève, la Suisse avait acquis cette position.
Pendant la majeure partie du XVe siècle, les quatre foires de Genève, espacées tout au long de l'année, rassemblaient massivement des marchands de Rhénanie, des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne et de France. Généralement, ces marchands vendaient des marchandises, des lingots et/ou des pièces de monnaie et des instruments financiers. En 1420, le dauphin français créa des foires à Lyon, en Bourgogne. Une dauphine est le fils aîné d'un roi de France, en l'occurrence le futur roi de France Charles VII qui régna de 1422 à 1461. Dans un premier temps les foires de Lyon, Bourgogne bénéficient des marchands venant de Genève. Mais plus tard, les deux villes, Genève et Lyon, devinrent rivales. Le tournant se produit en 1463 lorsque le roi de France Louis XI qui régna de 1461 à 1483 modifie les dates des foires de Lyon pour qu'elles soient les mêmes que celles de Genève.
Bien entendu, à cette époque, les commerçants devaient choisir entre quelle foire ils voulaient assister. L'importance de la foire de Genève commença à diminuer. L'une des premières indications de ce changement d'importance fut le transfert d'une succursale de la banque Médicis de Genève à Lyon en 1465. Au début du XVIe siècle, la foire de Genève était largement éclipsée par celle de Lyon. Les foires trimestrielles de Lyon dominèrent l'Europe pendant la majeure partie du XVIe siècle. Les foires soutenaient un commerce prospère de marchandises, notamment de soieries et d'épices. Cependant, ils étaient surtout connus et éminents pour leur rôle sur le marché monétaire international. Des prêts y étaient organisés, des factures réglées et des taux d'intérêt établis.
Dans les années 1580, les affaires financières se déplaçaient vers Besançon. C'était une autre ville idéalement située aux frontières de la France et de l'Empire romain. Besançon a prospéré jusqu'au XVIIe siècle. Elle fonctionnait uniquement comme une foire financière, agissant en étroite collaboration avec des foires similaires à Plaisance et Gênes en Italie et à Medina del Campo en Espagne. Les grandes foires flamandes n'ont pas survécu jusqu'à la fin du Moyen Âge et celles des Pays-Bas du nord ne sont jamais devenues plus que des événements locaux. Au XVe siècle, un cycle de quatre foires importantes fut créé à Anvers, en Belgique, et dans ce qui fait aujourd'hui partie des Pays-Bas et de la Belgique. C'était à cette époque Bergen op Zoom dans le Brabant. La croissance d'Anvers en tant que centre international majeur du commerce et de la finance au début du XVIe siècle a entraîné le déclin de ces foires. Les foires existaient en partie parce qu’elles permettaient aux visiteurs et suspendaient temporairement les monopoles locaux. Cependant, dans la mesure où Anvers était habituellement une ville ouverte à cet égard, elle n'avait pas besoin de foires.
Au début des années 1560, la English Merchant Adventurers Company tenta, sans grand succès, de limiter les activités de ses membres à la structure traditionnelle des foires des deux villes. Le commerce du tissu de l'entreprise contribua grandement à stimuler les foires au XVe siècle, elles ne furent donc pas sans influence. Cependant, leurs efforts furent généralement un échec. En Angleterre, bon nombre des plus petites foires ont tout simplement disparu. D'autres ont changé de caractère et ont même augmenté leur taille en se spécialisant dans un ou deux produits ou types d'élevage. Ils combinaient souvent ces efforts de marchandisage avec une fonction annuelle de recrutement de main-d’œuvre. Certaines reliques survivent encore sous des noms régionaux, même si très peu conservent leurs caractéristiques anciennes.
Parmi les quelques foires d'importance nationale de cette période, les plus importantes étaient celles de Bristol, en Angleterre ; à Beverly dans le Yorkshire, en Angleterre ; et surtout à Stourbridge, près de Cambridge, en Angleterre. La foire de Stourbridge était inconnue autrefois. Cependant, il prospéra jusqu'au XVIIIe siècle et fut fréquenté par des clients de toute l'Angleterre. En Europe du Nord, la grande foire de Scania, dans le sud de la Suède, a survécu jusqu'au milieu du XVIe siècle. Bien qu'elle soit essentiellement considérée comme une foire au hareng ou au poisson, elle était également un point de distribution général pour une grande partie de la région occidentale de la Baltique. Hormis la Scanie, les villes hanséatiques (allemandes) avaient peu d'utilité pour les foires. Ils allèrent même jusqu'à promulguer des ordonnances civiles interdisant aux marchands anglais et hollandais en visite d'assister aux foires du nord de l'Allemagne et de la Pologne.
La foire allemande la plus importante était celle de Francfort-sur-le-Main. Les chercheurs se demandent encore s’il s’agissait d’une foire internationale ou simplement d’une foire régionale extrêmement vaste et réussie. Il est cependant clair que les textiles importés d'Italie et du sud de l'Allemagne étaient expédiés de la foire vers les Pays-Bas. Les draps anglais et hollandais étaient distribués en sens inverse, vers l'Italie et l'Allemagne. Il ne semble donc vraiment aucune raison de douter de son statut international étant donné sa portée géographique. Au XVIe siècle, la foire de Francfort-sur-le-Main devint importante pour les transferts financiers entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais l'activité n'est pas à l'échelle de Lyon et des autres foires du sud. Leipzig peut être considérée comme la deuxième ville de foire allemande et pour sa foire du livre, qui subsiste encore.
Le monde médiéval regorgeait de compétitions sportives. Celles-ci allaient des tournois chevaleresques aux jeux de ballon parrainés par l'église. Le monde de la Renaissance a également célébré de tels concours. Cependant, ils étaient imprégnés du nouveau sens de l’individualité, du genre, de l’éducation et du corps qui accompagnait la pensée de la Renaissance. Pour les humanistes comme l’érudit italien du XVe siècle Leon Battista Alberti, la pratique du sports était la rencontre parfaite du corps et de l’esprit. Il affirmait que l'érudit qui pratiquait des activités sportives atteindrait la combinaison idéale de développement mental et physique nécessaire pour devenir un « homme universel ». Un tel homme devait choisir avec soin et avoir un équilibre parfait entre ses sports : natation, course, chasse, lutte et équitation. Tous ces sports ainsi que certains sports axés sur le « jeu de balle » étaient acceptables car ils étaient pratiqués par les anciens Grecs. Cependant, tous les hommes de la Renaissance n’étaient pas d’accord. Certains, comme l'humaniste néerlandais du début du XVIe siècle, Desiderius Erasmus, estimaient que l'honnêteté et la responsabilité étaient des éléments importants du sport. Cependant, il estimait que l'objectif global de la société devrait être de former des hommes et des érudits, et non des athlètes.
Sur les terrains de jeu et parmi les classes nobles, les tournois de joute sont restés populaires malgré les appels à la cessation des universitaires et des érudits. Le roi anglais Henri VIII était un fervent partisan et participant à de tels jeux. Les compétitions de force physique et d’habileté pourraient constituer des événements diplomatiques importants. Un exemple est sûrement le match de lutte d'Henri avec le roi de France François Ier au concours du Champ du Drap d'Or en 1520. Un autre passionné de jeux chevaleresques était le roi Henri II de France. Il fut tué lors d'un concours de joute en 1559. Sa mort a laissé la France ouverte aux guerres de religion qui ont fini par déchirer le pays. Sur le terrain sports constituaient d'importants événements sociaux. Selon Baldassare Castiglione, auteur du « Livre du Courtisan » du XVIe siècle, le devoir du parfait courtisan était de maîtriser les activités sportives. En tant que membre de la cour, le courtisan doit maîtriser non seulement les joutes, mais également d'autres sports populaires et d'influence militaire tels que le tir à l'arc, le jeu d'épée, l'escrime et les courses de chevaux.
Castiglione a également encouragé la participation à la course, au saut d'obstacles, à la natation et au lancer. Selon Castiglione, la dame de la cour devait assister et cheer les démonstrations athlétiques de son homme. Un courtisan pouvait également s'engager dans des compétitions avec les paysans. Castiglione prévient cependant qu'un courtisan doit être sûr de gagner. Par exemple, il serait humiliant pour un courtisan d'être vaincu par un paysan lors d'un match de lutte. L’un des sports les plus populaires de la Renaissance parmi les classes supérieures était le tennis. Le tennis est né dans la France médiévale et s'est répandu dans d'autres pays d'Europe occidentale. Les monarques ont encore une fois donné la mode. Le roi de France Henri VIII possédait sept raquettes. Il rejoint l'empereur Charles V en 1523 pour un match de double contre les princes d'Orange et de Brandebourg.
Le tennis était pratiqué différemment selon les régions. Bien entendu, cela tendait à compliquer les règles. En 1555, un moine nommé Antonio Scaino de Salo écrivit un traité sur le tennis. Le traité était une tentative d'universaliser les règles de l'étiquette, du score et du jeu. Ce travail a permis au tennis de devenir plus populaire auprès des commerçants, des étudiants et des artisans. Tous ceux qui précèdent auraient eu accès au livre. À peu près à la même époque, le roi Jacques VI d’Écosse, qui était également Jacques Ier d’Angleterre, popularisa l’ancien sport du golf. Le golf est originaire d'Écosse et était pratiqué non seulement par le roi mais aussi par sa mère, Mary Stuart. Mary Stuart était également connue sous le nom de Mary, reine d'Écosse. La popularité éphémère du golf parmi les Anglais à la Renaissance était due à leur désir de plaire au roi. Un véritable amour pour le sport du golf existait encore dans plusieurs siècles.
Sports parmi l’élite étaient à la fois populaires et joués au-delà des frontières nationales. En revanche, sports dans les classes inférieures différaient sensiblement d'une région à l'autre. Un exemple de ce dernier était « la soule », originaire des villages français du XIIe siècle. Le jeu impliquait des équipes d'hommes réparties selon la paroisse ou peut-être selon l'état civil. Dans ce dernier exemple, ceux qui étaient mariés pourraient jouer contre ceux qui ne l’étaient pas. Ces équipes se sont ensuite battues les unes contre les autres et ont tenté de faire passer un ballon vers l'avant et au-delà d'un poteau de but avec le pied, la main ou des bâtons de diverses sortes. L'Église parrainait depuis longtemps des événements tels que « la soule ».
Cependant, l'acceptation n'était pas universelle. Certains religieux réclamaient dès le début son interdiction. Certains religieux ont même menacé d'excommunication ou d'expulsion de l'église ceux qui se livraient à un jeu qui suscitait un tel esprit de passion et de compétition. Pour la minorité, de telles passions ne devraient être dirigées que vers la religion. Tout ce qui suscitait une passion détournée vers autre chose que la religion était considéré comme un sacrilège. Le football en Angleterre dérive peut-être de la soule. Connu sous le nom de « football » en Europe, ce jeu a un long héritage. Depuis des années, une rumeur attribuait l'origine du football à un groupe d'Anglais se donnant des coups de pied dans la tête coupée d'un Danois, un « Danois » étant bien sûr quelqu'un du Danemark.
Le ballon sur tabouret était un autre jeu populaire de la Renaissance. On dit que cela a commencé parmi les laitières qui jetaient des balles vers leurs tabourets de traite, essayant de les renverser. Dans une version alternative, les laitières frappaient les balles avec des battes, avec le même objectif de renverser leurs tabourets de traite. À la Renaissance, le jeu était associé à la parade nuptiale et à la période de Pâques. Il a ensuite évolué vers les jeux anglais de balle et de batte de rounders et de cricket. Sur les places de toute l'Italie, la saison de Pâques a donné lieu à des jeux, notamment au calicot. En uniforme de calicot, des joueurs ont donné des coups de pied et lancé un ballon en cuir rempli de poils d'animaux sous les yeux d'une foule enthousiaste. Les joueurs du jeu étaient réservés aux hommes de haute naissance.
La possibilité de perturbations et de violences dans sports était le même problème que celui des jeux de hasard et de dés. Ces questions ont toujours préoccupé les autorités. Parallèlement aux objections des religieux décrites ci-dessus, les laïcs de la Renaissance ont commencé à s'élever contre les « passe-temps diaboliques ». Ces objections redoublaient lorsque sports étaient pratiqués pendant le sabbat. Les activités dominicales étaient largement considérées comme se limitant à la prière et à la contemplation). Parmi les dirigeants protestants, Martin Luther était l'un des rares religieux du XVIe siècle à soutenir publiquement les événements sportifs. Il était un partisan particulièrement enthousiaste du bowling, connu sous le nom de « Kegels ». En général cependant, les divertissements tels que les mâts de mai, les appâts d'ours et les combats de coqs étaient dénoncés comme des péchés d'oisiveté. Ils étaient généralement sévèrement restreints, voire carrément interdits. L'application de ces règles était cependant inégale. Les paysans refusaient souvent d’arrêter de participer à leurs passe-temps favoris.
Les personnes riches qui ont vécu à l’époque de la Renaissance étaient confrontées à bon nombre des mêmes maladies que celles dont nous souffrons aujourd’hui. Il s’agissait notamment de véroles ou de virus provoquant des pustules sur la peau. Également le scorbut, qui est une maladie causée par une carence en vitamines. Puis, en plus de divers cancers et fièvres, il y avait des rhumatismes. Le rhumatisme est une série de maladies dans lesquelles les muscles et les articulations sont gravement enflés et enflammés. Il y avait aussi la goutte, qui, semblable aux rhumatismes, impliquait un gonflement encore plus important des articulations et des traces d'acide urique dans le sang. Certaines familles aristocratiques comme la famille Médicis luttent contre la tuberculose. La tuberculose est une maladie pulmonaire hautement transmissible. D’autres personnes riches ont eu du mal à survivre à la syphilis, qui était une maladie sexuellement transmissible très répandue à l’époque.
À la Renaissance, de vastes épidémies de paludisme ont eu lieu. Le paludisme était une maladie bactérienne souvent transmise par les moustiques. C'était une maladie particulièrement mortelle qui sévissait en Italie. Ceux qui ont dû subir une intervention chirurgicale souffraient souvent d’ulcères et d’infections cutanées chroniques désagréables. Cela a entraîné la nécessité d’une intervention chirurgicale continue tout au long de leur vie. Pour ceux qui ont les moyens de se permettre des procédures médicales correctives, l’espérance de vie peut atteindre cinquante ou soixante ans. Cependant, la majorité des habitants de la Renaissance n’étaient pas riches. Ainsi, en plus de toutes les afflictions médicales décrites ci-dessus, ils ont également dû faire face à une faim persistante, à des infections, à la surpopulation et à la pauvreté. Ils étaient sous-alimentés et risquaient constamment d’être infectés par diverses maladies. Le plus souvent, leurs appels à l’aide tombaient dans l’oreille d’un sourd des riches.
Après que la peste noire ait ravagé l’Europe, la situation des pauvres s’est légèrement améliorée. Les prix se sont stabilisés, ce qui a entraîné une baisse du coût des denrées alimentaires, et les salaires ont augmenté en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Cependant, aux XVIe et XVIIe siècles, les sans-abri et les affamés sont devenus plus nombreux qu'auparavant. Cela était dû à une forte inflation, les prix des produits de base et des produits alimentaires augmentant une fois de plus plus rapidement que les augmentations de salaires. Pour ceux qui étaient riches, il était plus facile d’éviter la maladie que pour les pauvres. Ils ont pu rester en bonne santé grâce à une meilleure alimentation que les pauvres et à la possibilité de s'installer dans des chalets d'été à la campagne. Les maladies étaient beaucoup moins fréquentes dans les zones rurales que dans les villes sordides, infestées et encombrées. Les maladies se propagent donc plus lentement qu’en milieu urbain.
Les riches importaient souvent des vins censés aider à prévenir les maladies. Ils prenaient également de longs bains de vapeur et avaient accès aux médicaments et traitements les plus récents. D’un autre côté, les pauvres n’avaient même pas de médecins. Contrairement aux riches, ils n’avaient pas non plus de diététistes pour leur planifier des repas équilibrés et sains. Même s’ils avaient reçu de tels conseils, ils n’auraient pas pu se permettre d’acheter de la nourriture. Les riches méprisaient les pauvres parce qu’ils mangeaient des déchets, des vers, des insectes et des larves, qui étaient des larves d’insectes. Les gens qui vivaient dans la pauvreté étaient considérés par les riches comme des vagabonds et des criminels. Ils ont été traités comme s’ils n’étaient pas des humains. Cependant, il faut admettre que très peu de ce que les riches considéraient comme des stratégies et des traitements médicaux avaient beaucoup de sens pour les pauvres. Cela comprendrait les potions, les poudres, les bains et les prescriptions. Les deux côtés ont ressenti de la colère et du ressentiment envers l’autre côté (riches et pauvres). Cela n’a fait qu’aggraver le fossé déjà énorme entre les riches et les pauvres.
Au cours de la Renaissance, les médecins et les profanes ont commencé à voir de nombreuses « nouvelles maladies ». Il s’agissait de maladies dont on n’avait pas parlé dans les textes médicaux des anciens. Par exemple, après l'introduction des armes à feu au 14e siècle, les blessures infligées par les armes à feu ont d'abord été traitées avec des méthodes inefficaces utilisées à l'époque médiévale. Au XVIe siècle, la découverte de nouvelles façons de traiter la maladie pouvait rendre un médecin très prospère et riche. Parmi les maladies nouvelles ou nouvellement reconnues figurait la « grande vérole », ou syphilis, parfois appelée « maladie française ». "Grande" distinguait cette maladie de la variole, qui était une maladie contagieuse causée par un virus. La variole provoque de graves lésions cutanées. Ce sont les Arabes qui l'ont découvert pour la première fois. La variole était devenue une grave épidémie en Europe à la fin du XVIe siècle.
Les maladies des mineurs étaient des affections dont souffraient ceux qui travaillaient dans les mines souterraines. Ce sont les premières affections professionnelles décrites en détail dans les textes médicaux de l'époque. Le typhus épidémique est apparu soudainement au début des guerres du XVIe siècle. Le typhus était une maladie bactérienne véhiculée par les poux du corps, qui provoquait une forte fièvre. Le scorbut et la fièvre jaune ont été décrits pour la première fois à l’époque de la conquête et de la colonisation outre-mer. Le scorbut est une maladie des gencives provoquée par un manque de vitamine C dans l’alimentation. À la Renaissance, les explorateurs traversaient régulièrement l’Atlantique pour coloniser le « Nouveau Monde », terme européen désignant les Amériques. Dans un effort pour empêcher les marins de contracter la maladie, de nombreux navires ont commencé à transporter du citron vert. Les agrumes sont riches en vitamine C. Lors de voyages dans le Nouveau Monde, les Européens ont également commencé à contracter la fièvre jaune. Il s'agissait d'une maladie causée par un moustique porteur de virus. La maladie entraîne une forte fièvre et une jaunisse, ou un jaunissement de la peau.
Au fur et à mesure que de nouvelles terres étaient « découvertes », une grande variété de nouvelles espèces végétales étaient étudiées par les médecins et les profanes. De nombreux nouveaux médicaments et traitements basés sur l’utilisation de plantes et de minéraux sont devenus populaires. Le succès de ces médicaments a amené de nombreuses personnes à remettre en question les idées et les traitements conventionnels utilisés par les médecins. Un débat philosophique a éclaté parmi les chercheurs sur la manière dont les maladies étaient classées et sur ce qui rendait une maladie « nouvelle ». L'absence de registres complets sur la période de la Renaissance rend difficile la connaissance du nombre de personnes dans les différentes classes sociales atteintes de maladies. Ce que l’on sait, c’est que, quelle que soit la classe sociale, 25 pour cent de tous les nourrissons nés n’ont jamais atteint leur deuxième anniversaire. En outre, les fièvres de diverses natures et durées sont la principale cause de décès à toutes les étapes de la vie.
Même au XVIe siècle, lors des années d’épidémie, des taux de mortalité supérieurs à 10 pour cent étaient courants dans les zones urbaines. Les décès causés par la peste seule au cours des années de grande peste étaient répandus. Au cours des décennies 1520, 1570, 1590 et 1630, les décès causés par la peste ont atteint des niveaux de 15 à 40 pour cent. Ces taux étaient aussi élevés que ceux observés lors de la peste noire au milieu des années 1300. Les personnes riches avaient probablement de plus grandes chances de survie parce que les pratiques sanitaires de l’époque séparaient les riches des pauvres lors des années d’épidémie. Dans l’ensemble, la population de l’Europe a commencé à croître après 1460, à mesure que davantage de personnes quittaient les zones rurales pour s’installer dans les centres urbains. Pourtant, parmi les travailleurs urbains et ruraux, la maladie a entraîné une plus grande pauvreté et une dépendance accrue à l'égard de l'aide du gouvernement et des œuvres caritatives privées.
Un certain nombre de facteurs pourraient changer radicalement les conditions économiques d’une famille. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, la peste, la famine, la maladie, les accidents, l'augmentation du nombre d'enfants ou la mort de la mère en couches. Les hôpitaux et autres organisations caritatives traditionnelles étaient rarement en mesure d’aider les familles de manière significative. Ainsi, la fin de la Renaissance fut caractérisée par un écart encore plus grand entre riches et pauvres.
Du XIVe au XVIe siècle, les Européens de la Renaissance étaient fascinés par la mort, comme en témoigne l’art de l’époque. La raison en était peut-être les épidémies récurrentes de peste bubonique. Il s’agissait d’une maladie très contagieuse qui a balayé de manière inattendue une région (ou un continent) et tué de larges segments de la population. Une plus grande conscience de la mort s'est exprimée dans de nouvelles formes de rites funéraires, de pratiques de deuil et d'actes de commémoration. Ces changements s'accompagnaient d'une préoccupation pour « l'ars moriendi », ou « l'art de mourir ». C’est un sujet sur lequel certains auteurs ont commencé à abondamment écrire au XVe siècle. Les thèmes de la décadence physique et du triomphe de la mort étaient des idées centrales dans les images. Cela était particulièrement évident dans l’art funéraire du nord de l’Europe. Bien entendu, chaque société doit faire face à la perte inévitable de ses membres par la mort. La manière dont les Européens de la Renaissance ont fait face à la mort en dit long sur leurs valeurs sociales, leurs croyances religieuses et leur état de santé général.
La peste bubonique était la peste bubonique la plus meurtrière de l’Europe de la Renaissance. À la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, on l'appelait simplement la peste ou la « peste noire ». Les conditions insalubres du Moyen Âge permettaient aux puces porteuses de bacilles d'infester et d'infecter les rats noirs. Lorsque le rat est mort, à la recherche de son prochain repas, les puces ont ensuite mordu les humains. La piqûre de la puce produisait des « bubons ». Il s'agissait de morceaux de la taille d'une châtaigne (ou d'une noix), généralement situés dans l'aine et l'aisselle. L'infection a été appelée « peste noire » car elle produisait des plaies ouvertes qui devenaient noires. La peste bubonique est arrivée pour la première fois en Sicile en décembre 1347 et s'est répandue dans la péninsule italienne à l'été 1348. Elle a atteint des niveaux pandémiques dans toute l’Europe continentale à la fin de 1349. Le terme « pandémie » fait référence à l’apparition d’une maladie sur une vaste zone géographique, touchant un grand nombre de personnes. Par exemple, au 21e siècle, l’Afrique connaît un niveau pandémique de citoyens souffrant du VIH/SIDA.
La peste bubonique était particulièrement grave dans les zones urbaines. La première vague de peste a fait des ravages parmi la population. Selon des estimations contemporaines basées sur des documents historiques, entre un tiers et la moitié des populations locales sont mortes au cours de ces deux années. À partir de la deuxième apparition de la peste en 1362, la maladie est devenue une norme, récurrente dans la vie de l'Europe de la Renaissance. La peste est revenue tous les dix à douze ans jusqu'à la dernière épidémie majeure à Londres en 1661, certains épisodes étant plus contagieux que d'autres. Les Européens ne comprenaient pas pleinement les causes de la peste. Cependant, sur la base de leurs observations, ils ont déduit que certaines mesures pratiques constituaient des moyens efficaces pour réduire la propagation de la maladie. Ces mesures comprenaient principalement la quarantaine, ou le confinement des personnes malades, et l'évasion des zones infectées. La « fuite » signifiait généralement quitter les zones urbaines au profit des zones rurales.
À la fin du XVe siècle, les riches citadins fuyaient chaque été vers la campagne. C'était particulièrement le cas des riches du bassin méditerranéen. Les zones rurales vers lesquelles les riches « s’enfuyaient » étaient des zones où la peste se propageait moins facilement. Ces pratiques ont progressivement concentré les victimes parmi les pauvres. Après un certain temps, les gouvernements locaux ont adopté des politiques sévères à l'égard de ceux qui souffraient de la peste. Vers 1 500 ouvriers et artisans étaient mis en quarantaine dans des hôpitaux pour peste. À la fin du XVIe siècle, la peste est devenue une maladie fortement associée à la pauvreté et au manque d’hygiène.
Les Européens de la Renaissance ont également été confrontés à d’autres maladies épidémiques. La plus répandue d’entre elles était une souche de syphilis qui agissait comme un virus. Elle est apparue pour la première fois en 1494 et était connue sous le nom de « vérole ». La vérole était une douloureuse maladie vénérienne sexuellement transmissible qui tuait ses victimes beaucoup plus lentement que la peste. L'apparition de maladies nouvelles, puissantes et incurables, comme la « vérole », a entraîné une montée des groupes caritatifs dans toute l'Europe. La « vérole » était régulièrement imputée à des personnes extérieures à la communauté immédiate. À un moment donné, les Italiens, les Français et les Amérindiens ont tous été accusés d'avoir causé et propagé la maladie. La peste avait frappé tous les groupes d’âge et les deux sexes de manière égale. La syphilis était bien entendu limitée aux adultes sexuellement actifs. Les traités de moralité imputaient la propagation de la maladie à la prostitution. Cela a entraîné la fermeture des bordels gérés par l'État à la fin du XVIe siècle.
Les Européens souffraient également fréquemment de maladies respiratoires mortelles telles que la tuberculose. Les hommes étaient régulièrement victimes d'accidents lors de leurs voyages d'affaires ou lors de travaux agricoles. De nombreuses femmes sont mortes en couches. La mortalité était extrêmement élevée chez les enfants de moins de deux ans. Cela était principalement dû à la maladie. En période de difficultés économiques, l’infanticide est devenu un problème social notable. Il se pourrait que cette pratique se soit développée simplement en tant que méthode de limitation de la taille des familles. Mais cette pratique a attiré davantage l’attention du public en tant qu’activité criminelle. Les dossiers des tribunaux italiens montrent que les petites filles étaient soit tuées, soit abandonnées dans un taux environ deux fois plus élevé que les bébés garçons. Cela s'explique en partie par le fait que les filles ne peuvent pas gagner des salaires aussi élevés que ceux des garçons. Les filles ont également besoin de davantage de ressources économiques pour financer la dot requise pour le mariage. Une fois que les enfants ont survécu à leurs premières années critiques, ils ont eu une chance raisonnable d’atteindre l’âge adulte.
Les Européens de la Renaissance avaient une vision complexe de la mort. Les croyances sur l’au-delà étaient une combinaison d’influences chrétiennes et de traditions classiques grecques et romaines. La source qui révèle le mieux ce mélange culturel est peut-être « l’ars morendi », ou « l’art de mourir ». Dès le début du XVe siècle, des écrits en langues latines et vernaculaires ont commencé à enseigner à un public profane comment un bon chrétien devait aborder la mort imminente. Ces tracts soulignaient que la mort devait être accueillie plutôt que redoutée, car on affirmait que c'était la mort qui donnait un sens à la vie. En fait, la vie sur Terre était considérée comme une préparation à l’au-delà. Puisque n'importe qui peut tomber soudainement malade, les écrits de l'ars morendi soulignaient l'importance de faire une « bonne mort ». Il a été conseillé à la personne malade de se confesser à un prêtre. Aussi pour pardonner aux amis et à la famille rassemblés autour du lit de mort. L'individu avait également pour instruction de disposer de ses effets personnels et de ses richesses. Ce dernier devait également faire des dons de charité ou d'autres compensations financières pour ses péchés passés.
Ces œuvres littéraires populaires mettaient l'accent sur l'acceptation de la mort et la planification de celle-ci comme moyen de contrôler le moment imprévisible de sa disparition. Faire une bonne mort aidait l’individu à entrer au purgatoire plutôt que d’être condamné à l’enfer. À la Renaissance, l’Europe était perçue comme une région entre le paradis et l’enfer. L’imagerie visuelle du nord de l’Europe mettait l’accent sur un sentiment de mort plus sombre que la représentation artistique de l’Italie et de l’Espagne. En France et aux Pays-Bas, la « danse de la mort », avec ses faucheuses et ses squelettes, est devenue populaire au XVe siècle. Les artistes d'Europe du Nord ont également développé une forme de sculpture funéraire qui représentait l'image d'une personne vivante placée sur un cadavre en décomposition. Ce type de représentation mettait l’accent sur la croyance selon laquelle la mort triomphait de toutes les personnes, quels que soient leur richesse ou leur statut. Cela a rappelé aux téléspectateurs que les organismes physiques du corps ne duraient pas aussi longtemps que l'âme.
Au cours de cette période, les attitudes et les croyances tirées des philosophes anciens furent à nouveau reprises par les Européens de la Renaissance. Ces attitudes étaient généralement interprétées d’une manière qui soutenait les croyances chrétiennes traditionnelles. Les enseignements chrétiens étaient mélangés à l’ancienne philosophie stoïcienne. La philosophie stoïcienne mettait l'accent sur l'importance de remplir son devoir envers les vivants. Il mettait également l'accent sur un comportement discipliné. Les penseurs de la Renaissance affirmaient que les personnes en deuil devaient contrôler leur chagrin grâce à l'autodiscipline. Le réconfort de leur perte pouvait provenir du travail, du devoir, de l’expression littéraire et de la foi chrétienne. Tout au long du XVe siècle, les humanistes en particulier ont soutenu des formes de deuil plus sobres, tant pour les femmes que pour les hommes.
Le testament ou « testament » était un document juridique attesté par un notaire qui donnait des instructions sur les volontés d'une personne après son décès. Le testament permettait à une personne d'exprimer ses souhaits concernant la répartition de ses biens personnels, ainsi que des instructions concernant l'inhumation. Les « ars morendi » suggéraient que la rédaction d'un testament était une étape importante dans la planification d'une bonne mort. Malgré ce conseil, la grande majorité des Européens sont morts sans laisser de testament. Les coutumes locales déterminaient donc ce qui arriverait à leurs restes mortels et à leurs biens matériels. Normalement, les épouses étaient enterrées dans les tombes de leurs maris et les proches parents héritaient des biens. L'inhumation dans l'église paroissiale ou le cimetière local était la norme en l'absence d'autres instructions.
Néanmoins, plusieurs milliers de testaments subsistent de la période de la Renaissance. Ces documents juridiques constituent des sources importantes pour examiner les valeurs sociales de l’époque. Par exemple, des études sur les testaments urbains français et italiens révèlent que plus d’hommes que de femmes ont laissé un testament. En Italie, aux XIVe et XVe siècles, les testaments rédigés par les femmes concernaient principalement des veufs dont les maris étaient déjà décédés. Néanmoins, les testaments des femmes représentaient moins de 30 pour cent des documents historiquement survivants. La transmission des biens dans ces testaments variait selon la situation géographique, la classe sociale, le sexe, les croyances religieuses et la période. Au cours de la Renaissance, de nombreuses personnes ont laissé de grosses sommes d’argent pour acheter un tombeau ou financer une messe commémorative afin de garantir que les générations futures se souviendront d’eux. Une messe commémorative spéciale était un service religieux catholique commémorant le défunt.
Dans certaines villes du centre de l'Italie, les hommes préféraient faire des dons importants à une institution plutôt que plusieurs petites contributions à des œuvres caritatives. La plupart de ces institutions aidaient les jeunes filles pauvres à trouver un mari. Cependant, dans d’autres villes, on a observé une tendance opposée en matière de dons. Les hommes préfèrent répartir leurs contributions en plusieurs dons. Les femmes, et en particulier les veuves, aimaient donner leur argent aux couvents. Ils ont légué à ces maisons religieuses des sommes d'argent pour les femmes à un taux bien supérieur à celui des hommes. Elles l'ont peut-être fait parce qu'elles étaient liées à des religieuses dans des couvents particuliers ou parce qu'elles voulaient soutenir les institutions. Les chercheurs doivent encore évaluer toutes les informations disponibles dans ces documents.
Entre 1300 et 1600, il y avait deux directions principales dans les rituels entourant la mort, le deuil et le souvenir. La première tendance était vers une augmentation des cérémonies dans les rites funéraires. Cela était particulièrement prononcé dans les régions restées catholiques après les réformes religieuses du XVIe siècle. Cette tendance a en fait commencé au début du XIVe siècle, avant la première épidémie de peste en 1348. Cependant, le nombre élevé de morts dues à la peste a donné une plus grande importance aux nouvelles formes de cérémonies et de rituels. Les riches marchands, les propriétaires fonciers et les aristocrates dépensaient des sommes toujours plus importantes en cortèges funéraires. Ils ont acheté des articles tels qu'un tissu coûteux pour draper la bière, qui était le support sur lequel un cercueil est placé. Ils ont également dépensé de grosses sommes d’argent pour acheter une riche tenue ou un vêtement dans lequel ils seraient enterrés. Les largesses s'étendirent même jusqu'à financer un grand nombre de payé des personnes en deuil, une multitude de bougies et des vêtements de deuil élaborés pour les proches.
La pompe funèbre déclarait le statut social d'une personne et pouvait avoir aidé certains à accepter leur propre mortalité. Les funérailles des gens ordinaires comme les artisans, les petits commerçants et les commerçants sont également devenues plus élaborées. Cette nouvelle flamboyance s'exprime également par un plus grand nombre de messes commémoratives célébrées en l'honneur des défunts. On pensait qu’une telle messe écourtait le séjour au purgatoire. Les belles chapelles funéraires familiales décorées dans le nouveau style Renaissance faisaient partie de cette nouvelle importance accordée à la cérémonie. La deuxième grande tendance des rites de mort au cours de la Renaissance allait exactement à l’encontre de la première. Après la montée du protestantisme au XVIe siècle, un style cérémonial plus réservé est apparu. Cela s’est principalement produit dans les régions d’Europe qui avaient rejeté le catholicisme.
Les protestants ont dû développer de nouvelles pratiques liturgiques et cérémoniales mieux adaptées à leurs croyances. Les protestants anglais ont essayé d'équilibrer une démonstration appropriée et digne de leur statut social sans le faste des cérémonies catholiques. Les prédicateurs protestants mettaient l’accent sur des cérémonies funéraires simples qui concentraient l’attention sur l’au-delà. Ils ont également conseillé aux personnes en deuil de ne s'engager que dans de brèves périodes de deuil et de messes commémoratives rejetées ainsi que le concept de purgatoire. Vers 1600, la manière dont les Européens enterraient leurs morts et se souvenaient de leurs morts fournissait des indices importants sur leurs croyances religieuses les plus profondes. Ces normes sociales et religieuses ont également contribué à distinguer les catholiques des protestants dans la vie quotidienne [Encyclopedia.com].
: Nous expédions toujours des livres au niveau national (aux États-Unis) via USPS ASSURÉ courrier des médias (« tarif livre »). Il existe également un programme de réduction qui peut réduire les frais de port de 50 à 75 % si vous achetez environ une demi-douzaine de livres ou plus (5 kilos et plus). Nos frais de port sont aussi raisonnables que les tarifs USPS le permettent. ACHATS SUPPLÉMENTAIRES recevez un TRÈS GRAND
Votre achat sera généralement expédié dans les 48 heures suivant le paiement. Nous emballons aussi bien que n'importe qui dans le secteur, avec de nombreux rembourrages et conteneurs de protection. Le suivi international est fourni gratuitement par l'USPS pour certains pays, d'autres pays entraînent des frais supplémentaires.
Nous proposons le courrier prioritaire du service postal américain, le courrier recommandé et le courrier express pour les envois internationaux et nationaux, ainsi que United Parcel Service (UPS) et Federal Express (Fed-Ex). Merci de demander un devis. Veuillez noter que pour les acheteurs internationaux, nous ferons tout notre possible pour minimiser votre responsabilité en matière de TVA et/ou de droits. Mais nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour les taxes ou droits qui pourraient être perçus sur votre achat par le pays de votre résidence. Si vous n'aimez pas les systèmes de taxes et de droits imposés par votre gouvernement, veuillez vous plaindre auprès d'eux. Nous n'avons aucune capacité à influencer ou à modérer les systèmes fiscaux/droits de votre pays.
Si à la réception de l'article vous êtes déçu pour quelque raison que ce soit, je propose une politique de retour de 30 jours sans poser de questions. Nous n'avons évidemment aucune possibilité d'influencer, de modifier ou de renoncer aux politiques d'eBay.
À PROPOS: Avant notre retraite, nous voyageions plusieurs fois par an en Europe de l'Est et en Asie centrale à la recherche de pierres précieuses et de bijoux anciens provenant des centres de production et de taille de pierres précieuses les plus prolifiques du monde. La plupart des articles que nous proposons proviennent d'acquisitions que nous avons réalisées au cours de ces années en Europe de l'Est, en Inde et au Levant (Méditerranée orientale/Proche-Orient) auprès de diverses institutions et revendeurs. Une grande partie de ce que nous générons sur Etsy, Amazon et Ebay est destinée à soutenir des institutions dignes d'Europe et d'Asie liées à l'anthropologie et à l'archéologie. Bien que nous ayons une collection de pièces de monnaie anciennes se comptant par dizaines de milliers, nos principaux intérêts sont les bijoux anciens et les pierres précieuses, reflet de notre formation universitaire.
Bien qu’elles soient peut-être difficiles à trouver aux États-Unis, en Europe de l’Est et en Asie centrale, les pierres précieuses antiques sont généralement démontées des anciennes montures cassées – l’or est réutilisé – les pierres précieuses sont recoupées et réinitialisées. Avant que ces magnifiques pierres précieuses antiques ne soient retaillées, nous essayons d’acquérir les meilleures d’entre elles dans leur état d’origine, antique et fini à la main – la plupart d’entre elles ont été fabriquées il y a un siècle ou plus. Nous pensons que le travail créé par ces maîtres artisans disparus depuis longtemps mérite d'être protégé et préservé plutôt que de détruire ce patrimoine de pierres précieuses antiques en découpant l'œuvre originale de l'existence. En préservant leur travail, d’une certaine manière, nous préservons leur vie et l’héritage qu’ils ont laissé aux temps modernes. Il vaut bien mieux apprécier leur métier que de le détruire avec une coupe moderne.
Tout le monde n’est pas d’accord : au moins 95 % des pierres précieuses antiques qui arrivent sur ces marchés sont retaillées et l’héritage du passé est perdu. Mais si vous êtes d'accord avec nous que le passé mérite d'être protégé et que les vies passées et les produits de ces vies comptent toujours aujourd'hui, envisagez d'acheter une pierre précieuse naturelle antique, taillée à la main plutôt qu'une pierre précieuse taillée à la machine produite en série (souvent synthétique). ou « produites en laboratoire ») qui dominent le marché aujourd’hui. Nous pouvons sertir la plupart des pierres précieuses antiques que vous achetez chez nous dans votre choix de styles et de métaux allant des bagues aux pendentifs en passant par les boucles d'oreilles et les bracelets ; en argent sterling, en or massif 14 carats et en or 14 carats. Nous serions heureux de vous fournir un certificat/garantie d’authenticité pour tout article que vous achetez chez nous. Je répondrai toujours à chaque demande, que ce soit par e-mail ou par message eBay, alors n'hésitez pas à écrire.

| Publisher | Henry Holt (2001) |
| Length | 320 pages |
| California Prop 65 Warning | California wishes you to know that the book is not intended for human consumption. |
| Dimensions | 9¾ x 6½ x 1¼ inches; 1½ pounds |
| Format | Hardcover w/dustjacket |